Succès complet, aussi marqué auprès du lecteur moyen (beaucoup plus cultivé, soulignons-le, qu’ici) que dans l’intelligentsia. Succès assez explicable si l’on considère une jeune génération que la grande liberté sexuelle de ses premiers livres, l’attention portée à la musique, celle de jazz notamment, dont cet ancien gérant d’un club tokyoïte est un connaisseur averti, l’éloge d’une vie libre, insoucieuse des contingences matérielles, volontiers bohème, ont pu séduire.
Mais le reste du public a plus ou moins suivi, malgré le caractère souvent cryptique d’une prose plus influencée par la tristesse ironique d’un romancier japonais dépressif et désabusé comme le grand Sôseki que par les romanciers américains (Salinger excepté) auxquels on l’a trop souvent mesuré. Quant au fantastique inhérent à son œuvre et à son obsession des univers non point parallèles (ce n’est pas un auteur de science-fiction) mais bien emboîtés – le fantastique, chez lui, c’est ici et maintenant –, il fascine naturellement tout citoyen d’un pays où les fantômes ne sont jamais loin, embusqués dans le bruit de fond des feuilles de roseaux froissées.
Pourquoi donc, après tant de beaux livres profonds (Chronique de l’oiseau à ressort, Kafka sur le rivage, Saules aveugles, femme endormie étant nos préférés), éprouver le besoin de se lancer dans un feuilleton démesuré (le 3e volume, sorti au Japon, paraîtra en 2012 à Paris, chez le même éditeur attitré) ? Les critiques japonais, qui apprécient et c’est normal plus sereinement la production locale que nous, l’ont nettement souligné : 1Q84 ressemble d’abord à une entreprise commerciale, parfaitement programmée et réussie d’ailleurs, puisqu’elle a d’ores et déjà donné à l’écrivain de 63 ans, avec quelques millions d’exemplaires vendus, une place honorable dans Le Livre des Records – et compromis peut-être ses chances pour le Nobel, dont on le murmure lauréat possible depuis des années… Roman commercial, donc assez décevant ? On peut effectivement le penser. Le modèle canonique du feuilleton du XIXe siècle, des Mystères de Paris d’Eugène Sue (que jalousa Balzac, qu’imita Hugo en l’écrasant de son génie), voire de Chéri-Bibi de Gaston Leroux, informe bien en profondeur la construction d’une intrigue très simplement fondée sur l’alternance de deux personnages, une femme et un homme, qui se partagent avec une égalité de match de tennis deux fois 24 chapitres dotés de titres (comme chez Hugo ou Jules Verne) où affleure le ton de la parodie. Un tel dispositif permet au lecteur de progresser à son aise dans l’imbroglio de situations moins aventureuses que proprement rocambolesques. Qu’on en juge : Aomamé, l’héroïne principale, est une tueuse professionnelle de trente ans, qui exécute des contrats impeccables dans leur précision efficace pour le compte d’une vieille idéaliste (?) un peu spéciale et persuadée qu’il faut purger la planète des mâles pervers qui maltraitent leurs épouses ou violent des petites filles impubères. Tengo, pendant masculin d’Aomamé, a le même âge qu’elle. Sous l’influence d’un éditeur plus filou que nature, il est amené à remanier l’ébauche romanesque d’une gamine de 17 ans, Fukaéri, échappée d’une secte, recueillie par un éminent ethnologue, et qui a vu, dans le monde de 1Q84, à peine démarqué de celui du 1984 jadis monté en épingle par George Orwell (mais cet univers comporte tout de même deux lunes et la topographie de Tokyo y est un peu différente), des sortes de démons (ou de kami dévoyés, bien qu’ils soient les clones des 7 nains de Disney), façonner une manière d’ectoplasme blanchâtre, la chrysalide de l’air.
Est-ce là tout ? Hum ! pas le moins du monde. Ce scénario bourré de ficelles mélodramatiques ne constitue qu’un point de départ. Son traitement se révèle plus ahurissant encore. Car le 1984 historique verse peu à peu dans le 1Q84 fantasmatique. Aomamé et Tengo, qui se sont épaulés un court moment dans une vie antérieure comme deux enfants solitaires et exploités, se liguent, sans pourtant s’être physiquement retrouvés, pour s’attaquer à une secte idéologiquement proche, sous certains de ses aspects coercitifs, des Témoins de Jéhovah. Des événements étranges s’accumulent. Le danger rôde. Des personnages sortis du policier classique, majordome coréen taillé en armoire mais d’une délicatesse improbable, gardes du corps engoncés dans leur rôle de seconds couteaux de cinéma, font de-ci de-là de la figuration intelligente ou stupide selon les besoins de la mise en scène. Aomamé, qui jadis s’est enfuie de chez elle et vit depuis en orpheline, supprime le gourou de la secte puis se suicide. Tengo ignore qui est sa véritable mère et échoue à renouer avec un père qu’il n’a pas aimé, etc.
On reconnaîtra que, nonobstant la couleur à l’évidence parodique de cet amoncellement de stéréotypes, le lecteur est en droit de se demander parfois si les deux Q (ou 9) successifs des deux tomes – la lettre Q se prononce « kyou » en japonais, comme le chiffre 9 – ne font pas un peu QQ la praline en bon français, et si le Murakami triomphant avec ce livre est vraiment le même que celui des textes marqués par « l’inquiétante étrangeté » et dépourvus d’effets faciles de pyrotechnie amusante qui ont précédé.
Ce lecteur, surtout, s’inquiète. En vieillissant, Murakami se prendrait-il, en fait, au grand sérieux, tendance dangereuse (irrésistible ?) de ceux qui ont été trop adulés ? Qu’on nous entende bien : Proust, Beckett, Claude Simon sont « sérieux » en ce qu’ils assument sérieusement l’œuvre qui s’est imposée à eux. Mais ils restent modestes et peu assurés bien qu’ils ne soient pas sans orgueil. Sinon, ils seraient Jules Romains, ou Sartre, des écrivains estimables, sans plus.
Or Murakami prête peut-être déjà le flanc à cette critique. Depuis quelques années, il a commencé à s’installer dans la position périlleuse du maître à penser, intervenant désormais dans les débats de politique ou d’éthique. Citons seulement un extrait d’une interview récente par le quotidien Yomiuri : « Nous vivons à une époque où il est très difficile d’avoir un jugement sur ce qui est juste ou non… (…) Dans un monde plus chaotique, les fondamentalismes gagnent du terrain. C’est le rôle de l’écrivain de créer des fictions qui les contrent. »
On pense immédiatement à Hugo. Lui aussi se sentait investi d’une mission, et cela n’empêche pas Les Misérables, relus aujourd’hui, d’être un chef-d’œuvre littéraire. Mais c’est qu’il bénéficie, en dépit du caractère labyrinthique de ses intrigues enchevêtrées, d’une rigueur absolue dans l’intention sociopolitique, et d’un refus non moins absolu du schématisme psychologique et de la surcharge dramatique. Ces éminentes qualités esthétiques manquent en revanche souvent à 1Q84, notamment dans les dialogues où une certaine inflation verbeuse peut ruiner le secret d’un récit qui s’efforce de mettre les points sur les i (je pense à l’interminable échange entre le gourou et la tueuse avant qu’elle ne se décide enfin à l’occire), et tombe alors dans un excès démonstratif auquel le cinéma japonais de la Nouvelle Vague des années 60 (Teshigahara, Hani, Ôshima même) n’a que rarement su échapper.
Concluons néanmoins d’une façon ouverte. Il reste dans 1Q84 suffisamment de beautés pour qu’on ne désespère pas de Murakami. La sûreté presque miraculeuse avec laquelle il sait restituer le contenu sui generis d’un lieu et d’un climat (Aomamé en marche vers la demeure de la vieille dame, sa commanditaire, dans le quartier un peu endormi des ambassades, Azabu, à Tokyo, en été), la qualité d’exceptionnelle retenue de nombre d’épisodes (la visite de Tengo à son père mourant, dans une clinique de soins palliatifs au bord de la mer), d’une manière générale le traitement du passage des saisons (ici, d’avril à septembre), si caractéristique de l’obsession météorologique présente en toute sensibilité japonaise : il y a des plages d’écriture, dans 1Q84, qui sont de parfaites réussites.
Mais rien ne réveille mieux l’intérêt du lecteur pour qui Murakami reste le meilleur romancier du Japon actuel, que l’insertion inattendue, dans la trame d’une histoire dont chaque fin de chapitre fonctionne, avec une régularité trop attendue, sur la mécanique du suspens propre au feuilleton, d’un conte intemporel comme celui du « village des chats ». Un jeune homme, double de Tengo et sans doute du narrateur vagabond des textes antérieurs, y emprunte un train fantôme, descend seul sur le quai vide d’une localité déserte, que tous ses habitants humains semblent avoir abandonnée, et qui se repeuple la nuit d’une horde de chats capables de se substituer à notre espèce dans l’accomplissement de la plupart de nos actes quotidiens et sociaux. Ces chats, qui repèrent et détestent l’odeur de l’homme, montent à l’assaut du clocher où s’est réfugié le héros transi, mais ne le trouvent pas malgré l’évidence de sa présence : serait-il devenu transparent ? L’histoire n’aurait-elle que l’inconsistance d’un cauchemar ?
On sait depuis un célèbre essai de Tzvetan Todorov que le sentiment du fantastique se nourrit de l’incertitude où nous plonge un récit, incertitude essentielle concernant sa propre nature, réaliste ou imaginaire. Voilà du grand art digne de Murakami. Souhaitons que le troisième tome de 1Q84 n’explicite pas cette courte nouvelle sans aucune justification autre que littéraire. Le Japonais énigmatique qui a écrit L’Éléphant s’évapore n’a pas intérêt à s’écarter trop du sol mouvant du village des chats, soit de son marécage intérieur. Il est le seul à savoir le découvrir au revers des pages et l’explorer pour notre délectation. C’est en quelque sorte son domaine réservé. Peut-être ne dispose-t-il pas de beaucoup d’autres terrains semblables où s’ébattre.
Maurice Mourier
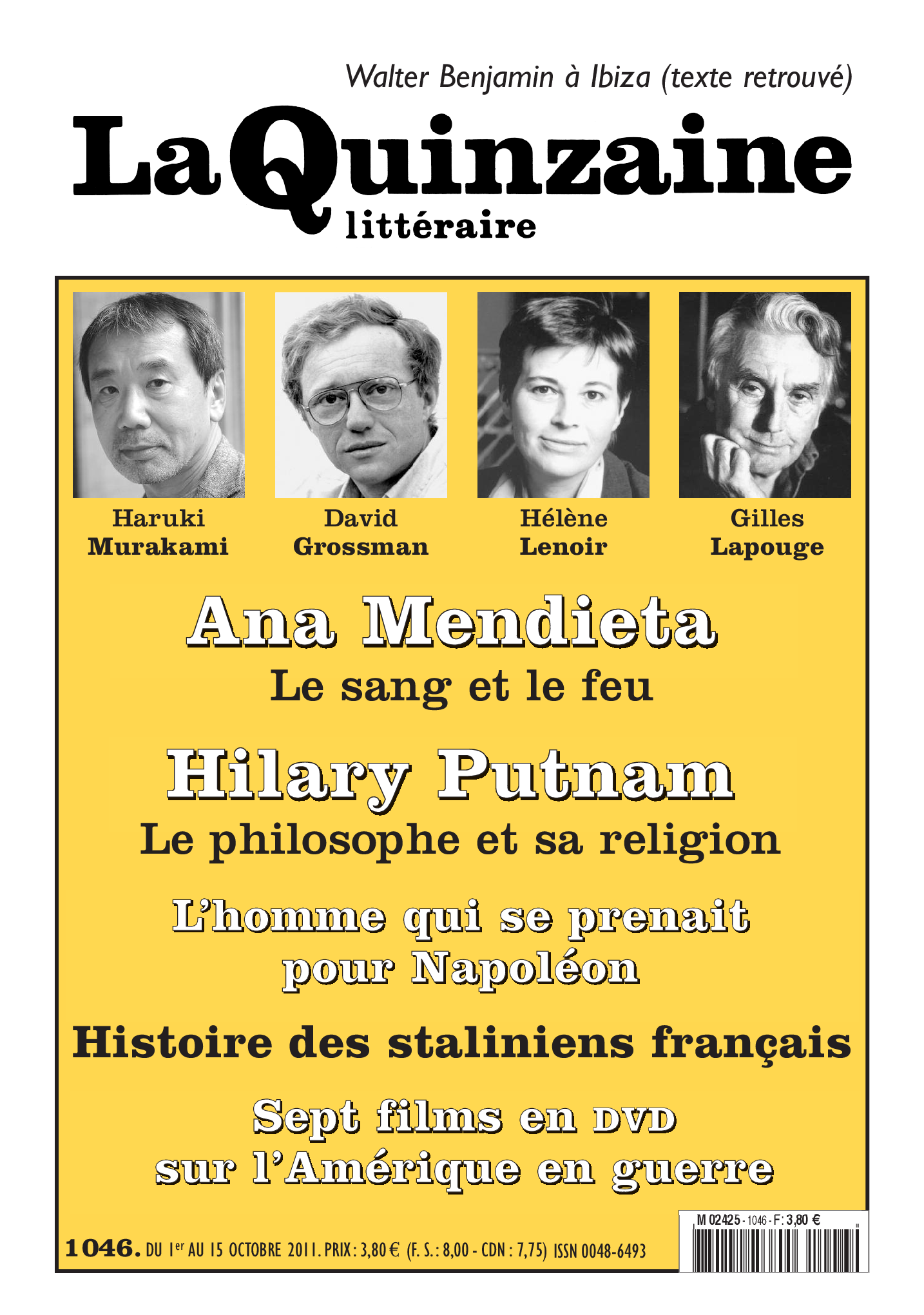

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)