Mais le coup de force réussi par Cendrars en 1913 (affirmer son échec en poésie pour mieux étayer son triomphe dans l’invention d’une forme libre qui mélange lyrisme et reportage et en compose un cocktail unique) joue l’aveu d’une impuissance qui, à ce moment-là au moins de la trajectoire du pénitent, ne lui a pas encore interdit l’usage du vers. Lorsqu’il a donné à son essai vraiment magistral sur Poe un titre aussi « apéritif », comme aurait dit Barthes, mais aussi énigmatique (qu’est-ce qu’aller « jusqu’au bout de la prose » ?), Henri Justin, spécialiste du poète américain, a-t-il songé à Cendrars ? J’en ferais volontiers le pari. Interrogé, à la fin de sa carrière, par Michel Manoll au cours d’« Entretiens » mémorables, Cendrars, auteur tardif de romans atypiques, parce que fondamentalement poétiques, répondait à son interlocuteur qui lui demandait pourquoi il n’écrivait plus de vers : « Je fais des poèmes pour bibi », c’est-à-dire que je les garde pour moi. Intériorisation de l’impuissance avouée quarante ans plus tôt ? Réelle conversion à la prose – ce qui ne veut pas dire au prosaïsme ?
La thèse centrale d’Henri Justin aborde en tout cas de front l’abandon de la forme poétique par Poe après 1831 (il est né en 1809), pour se lancer dans la rédaction de contes et de nouvelles, abandon tout relatif en un sens, puisque l’extraordinaire résurgence du Corbeau en 1841 est suivie de cinq autres poèmes, dont Annabel Lee (Poe meurt en 1849). Mais l’exégète nous convainc d’autant mieux de la justesse de son approche que toute son analyse critique, quasi exhaustive, ne met l’accent sur la supposée maldonne de Poe dans le domaine du vers que pour souligner avec vigueur le caractère génial de l’invention que cette renonciation permet : celle d’une forme littéraire absolument neuve, où l’écrivain équilibriste parvient à se tenir à distance égale – dans ses meilleurs contes – de la « verticalité » du poème et de l’« horizontalité » de la narration.
Il est vraiment impossible de rendre compte brièvement d’une étude aussi complète et aussi séduisante, dont pratiquement chaque page se révèle riche au point de nécessiter plusieurs lectures. La preuve la plus éclatante de l’importance de Poe, (que certains universitaires américains – offusqués par une réception en France qui, depuis Baudelaire, puis Mallarmé et Valéry, a fait de l’auteur du Corbeau une sorte de figure exemplaire de la littérature… hexagonale – s’obstinent à juger froid et illisible, j’ai entendu encore récemment proférer cette ânerie sur un célèbre campus de Nouvelle-Angleterre), c’est qu’il a suscité d’éblouissantes analyses.
Barthes à propos de La Vérité sur le cas de M.Valdemar, texte où la transgression de la mort atteint son paroxysme, Jean-Claude Milner (sur La Lettre volée, où s’inaugure, avec le personnage du détective parisien Dupin, le genre du roman policier, promis à un proliférant avenir), avant eux Gaston Bachelard : le poète maudit à la destinée courte et malheureuse n’a pas manqué de grands lecteurs fascinés et prêts à lui bâtir un « tombeau » certes moins définitif que celui de l’auteur d’Un coup de dés.
Par rapport à ces admirateurs de poids, le premier apport décisif d’Henri Justin tient à sa qualité d’américaniste. Elle lui permet, tout en marquant avec probité ce que la reconnaissance posthume de Poe doit effectivement à la France et à Baudelaire son traducteur magnifique, même s’il lui arrive parfois d’être infidèle ou fautif, de revenir lorsque c’est nécessaire à la lettre même du texte et d’infléchir par là l’image exagérément sombre et exaltée (romantique, en somme) d’une œuvre qui frappe aussi par ses visées éditoriales de conquête du public, la maîtrise et en tout cas le contrôle maniaque de ses moyens (recherche du mot exact, attention scrupuleuse au mécanisme d’une intrigue devant aboutir mathématiquement à un « effet » précis), enfin un humour très particulier qui confine souvent à la dérision, voire à l’auto-dérision.
L’apport décisif d’Henri Justin
Formé à la critique textuelle la plus rigoureuse et par conséquent peu enclin à s’appuyer sur le corpus poesque pour une psychanalyse de l’homme énigmatique qui produisit des contes aussi noirs que Bérénice, aussi enjoués et néanmoins inquiétants que Ne pariez jamais votre tête au diable (dont Fellini devait tirer le merveilleux Tre passi nel delirio), aussi ingénieusement machinés que Le Scarabée d’or, Henri Justin récuse à juste titre le simplisme de Marie Bonaparte, pour qui impuissance sexuelle et nécrophilie informent en profondeur les obsessions du narrateur de tant d’histoires d’apparence aussi maladive que les fleurs baudelairiennes.
Il évite également le terrorisme critique qui interdisait, dans les belles années du structuralisme, toute allusion à la vie de l’auteur. On trouvera donc ici ou là dans ce livre tels aperçus éclairants sur des épisodes biographiques essentiels, comme le mariage en 1836 avec la cousine Virginia Clemm, âgée de quatorze ans, ou la dernière aventure, bien trouble, qui aboutit à la mort misérable de Poe, en 1849, sans doute dans un accès de delirium tremens, mais ces détails n’apparaîtront que dans la mesure où les moments en question permettent de mieux lire soit les sinistres contes « conjugaux » (Bérénice, Morella, Ligeia, de 1835-1838), soit l’état psychique d’un homme persuadé de son génie et qui, après avoir écrit Eurêka, son texte le plus ambitieux et le plus touffu, tentative inouïe d’enquête poético-cosmogonique sur la réalité même de l’univers, estimait qu’il ne lui restait plus qu’à mourir, qu’il n’irait jamais plus loin que cette prose d’abord énoncée en tant que conférence.
En étudiant Justin vous comprendrez un peu – sans le comprendre tout à fait car c’est une entreprise aussi folle, et moins limpide que La Tentation de Saint-Antoine, qui accapara Flaubert toute sa vie – non seulement cet époustouflant Eurêka, mais bien des contes qui furent ou sont encore pour vous lectures de chevet : Une descente dans le Maëlstrom, auquel sont consacrées quelques-unes des pages les plus remarquables du livre ; Le Démon de la perversité (le concept singulier de « perversité » chez Poe est l’objet d’un chapitre entier et entièrement passionnant, aux pages 291-324), enfin ces chefs-d’œuvre d’écriture que sont les « récits de détection » mettant en scène le subtil Dupin, ancêtre de Sherlock Holmes, d’Hercule Poirot et d’autres limiers moins intelligents que ceux-là et surtout que lui.
« Artificialité » et « intensité », dit Justin dans une de ses nombreuses formules frappantes, caractérisent le génie de Poe. À la première de ces deux notions correspond sans doute l’impression de nouveauté théorique radicale que les plus exigeants des écrivains français (de Mallarmé et Valéry aux inventeurs du Nouveau Roman) ont ressentie à la découverte de cette prose qui, d’une façon si retorse, n’exhibe ses procédures de fabrication que pour dissimuler l’essentiel, et pas uniquement dans Genèse d’un poème, où Poe dissèque en pince-sans-rire le caractère prétendument « factice » du fameux Corbeau.
C’est l’intensité d’une écriture à l’évidence destinée à exorciser des lémures obsessionnels, à apprivoiser les fantômes ayant partie liée, peut-être, avec ces trois uniques années que l’auteur, dans sa toute première enfance, partagea avec une mère actrice belle et phtisique morte à vingt-cinq ans dans une sordide chambre d’hôtel (en présence du bambin ? Le père, également comédien ambulant, avait disparu peu avant sans laisser de trace), qui a hypnotisé Baudelaire (lui-même frustré d’amour par le remariage de sa mère veuve avec le brave général Aupick, qu’il cherche fébrilement dans Paris pour le faire fusiller, ce à quoi il ne parviendra pas, en 1848) et, pardelà Baudelaire, ceux pour qui Poe le cérébral parle la langue même de l’émotion la plus intense et la plus contenue.
C’est ça, la critique !
Henri Justin fait partie de ces derniers lecteurs. Dès les premières pages de son livre il cite quelques mots de Baudelaire dans sa Correspondance : « Savez-vous pourquoi j’ai patiemment traduit Poe ? Parce qu’il me ressemblait. » Un peu plus loin, Justin confie dans une phrase pudique qu’un deuil d’enfance a fait de lui aussi un frère du « poète exilé dans la prose ». Telle est la critique que nous plébiscitons : son théâtre exégétique intérieur ne fonctionne que parce qu’il refuse le non-engagement personnel des postures académiques. On ne peut lire en profondeur (c’est ça, la critique, ou bien ce n’est rien du tout) avec la seule rationalité pure et dure. Il y faut la passion, et le mot désigne ici autre chose que la vague appétence à quoi l’a réduit aujourd’hui son emploi abusif et systématique : la passion, autrement dit le feu intérieur dont il arrive que l’on brûle.
Un regret ? Assurément. Un passage trop bref du livre, à notre goût, traite des Aventures d’Arthur Gordon Pym (qu’Henri Justin, calquant l’anglais « narrative », préfère appeler Narration d’Arthur Gordon Pym), le seul roman de Poe, publié en 1838 et qui eut le mérite, rare en littérature, de susciter une « conclusion » due à l’admiration seule : Le Sphinx des glaces, de Jules Verne (les amours de Verne ne sont pas celles qu’on attend).
À une séquence fort étrange de ce texte qui nous enchante toujours, celle qui commence par « le caractère singulier de cette eau » et s’applique à décrire certaines anomalies de la terre antarctique de Tsalal où ont échoué les héros avant leur engloutissement dans les cataractes du pôle, Jean Ricardou avait jadis consacré une de ses plus brillantes analyses, que nous avions nous-mêmes tenté de poursuivre en examinant le labyrinthe de « pierre de savon » de cette île agencée comme un théâtre. Des dessins manifestement cryptiques accompagnent alors le texte, nous les avions interprétés comme des variations sur le nom même de Poe et cette recherche avait paru dans un numéro spécial d’Esprit (« L’Espace du texte »), qui doit dater de 1971 ou 1972. Élucubrations ! Il n’y a que les écrivains majeurs qui s’y prêtent.
Maurice Mourier
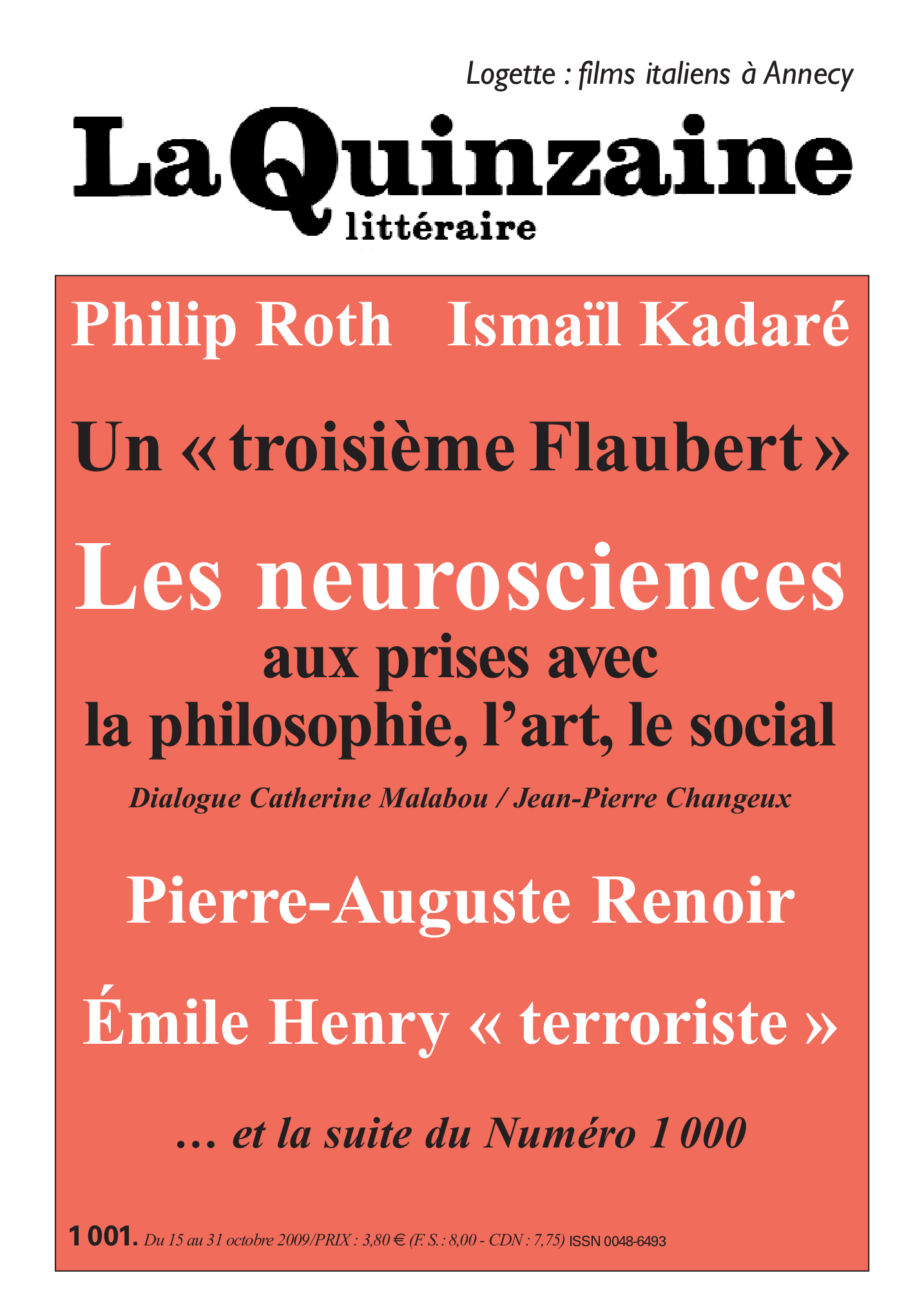

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)