Le deuil du pays natal ne peut jamais finir. Les paysages, les émotions, les troubles premiers ne s’effacent pas. Et leurs ombres surplombent le présent, pesant sur des êtres qui se débattent pour ne pas s’égarer dans l’obscurité de leur vie et ne peuvent retrouver la joie naïve et coupable d’une époque anéantie. C’est à l’impossible réconciliation avec son passé que se confronte Michiel, fils cadet d’une famille de propriétaires agricoles du veld (1) sud-africain, lorsqu’il revient sur « cette terre désormais interdite pour lui », refoulée avec tout ce qu’elle porte d’inéluctable violence, d’oblitération du bien, pour assister aux funérailles de sa mère brutalement disparue. Endeuillé et distant, revenu « en voyeur » et comme habité d’une tendresse étrange, il fait face à ceux dont il s’est éloigné, à ce qu’il a perdu, et se retrouve, fragile et nu, dans une certaine forme d’acceptation de ce qu’il est vraiment.
Le roman se tient tout entier dans la journée et demie de son séjour au domaine « Le Paradis », dont il ressaisit tout ce qu’il a été et tout ce qu’il n’est plus, en même temps qu’il reprend, par bribes, au hasard des lieux, des conversations, des gestes et des silences, ce qui a fait sa vie et la tord douloureusement. En quatre séquences – l’arrivée, la cérémonie, la nuit, le départ –, tout se rejoue de son existence « comme s’il n’était jamais parti ». La famille, les proches, son amour de jeunesse abandonné, les employés du domaine, la servante noire qui veille sur son père, sa fille… se rassemblent. Les paroles qu’ils échangent, ce qu’ils se racontent enfin, entremêlent leur présent difficile et leur passé évanoui. Le récit dit ainsi, dans la chorégraphie aventureuse de leurs conversations, l’écart de ces temps disjoints en même temps que l’exil qui l’amplifie, pour faire surgir la brutalité d’un temps que, d’une manière ou d’une autre, chacun s’obstine à fuir. Manière de climax, l’action du roman, fort simple en vérité, impose une réconciliation nécessaire qui ne prend sa dimension que dans le tourbillon de souvenirs qui viennent l’empêcher ou la compliquer sans fin.
Mark Behr excelle à entretisser cette mémoire évidemment éclatée, morcelée, avec le caractère linéaire de la narration d’un deuil et des rites qui l’entourent ; à tenir ensemble deux temps contradictoires, apparemment irréconciliables, celui, intime, diffracté, compliqué, et celui d’une Histoire qui bascule et fait se renverser la réalité d’un monde. C’est dans la confrontation de ces deux dimensions que s’impose la force d’un roman à la fois modeste et ambitieux ; dans la réflexion qui s’y livre, par le moyen d’une trame très émouvante, sur une mémoire hantée par une culpabilité indépassable, qui enferme le personnage principal dans une forme extrême de violence tournée contre soi-même. Car la mémoire – la mécanique même du roman – opère selon le mode d’une réactivation permanente d’une faute originelle. Elle demeure irrémédiablement coupable, faisant revenir les fautes, répétant les mêmes traumatismes qui portent la « transition » sud-africaine d’un régime à un autre, faisant passer d’une réalité à une autre. Behr conçoit la mémoire comme éminemment morale, pivot de tout un univers.
Les Rois du Paradis énonce ainsi, à travers le travail mémoriel lui-même, la nature de l’exil d’un homme que son père a banni en raison du déshonneur qu’il a fait peser sur une famille entière (il a été rétrogradé lors de son service militaire pour ses relations homosexuelles avec un « officier de couleur », puis a déserté, abandonnant tout de la vie qui lui était destinée) ; la nature, aussi, de sa fuite perpétuelle, du sentiment trouble d’avoir connu dans son pays une joie parfaite. Behr parvient, par le biais de son portrait et de la récapitulation désordonnée de ses expériences, à articuler une proposition singulièrement forte sur les liens qui existent entre politique et sexualité, pulsion et culpabilité, parole et silence, intime et collectif. Tout dans son roman est affaire de transgressions, de séparations, de ruptures, du deuil que l’on s’impose. Michiel découvre une sexualité tournée vers les hommes noirs, en porte la faute impardonnable, la répète dans sa relation avec un jeune universitaire, Kamil, avec qui il vit aux États-Unis. Il supporte ainsi une singulière forme de honte, celle d’être ce qu’il est et de fuir, de ne pas se retrouver, de n’exister que dans l’écart effrayant entre ce qu’il a été et ce qu’il est devenu, le poids du silence qu’il lui faut supporter. Le roman révèle ainsi un lien compliqué entre le sentiment raciste, même refoulé, et la sexualité envisagée selon le mode de la pulsion et de la violence – on pensera à la question de la torture, de la disparition. Et le place sous le régime d’un silence traumatisant, de ce que Coetzee dans Disgrâce nomme « le prix à payer pour continuer à vivre ici », conjuguant ainsi la honte d’être blanc, donc coupable, avec le sentiment d’une impossible appartenance.
Si le roman tourne autour du deuil de la mère qui redouble celui, ancien, de son fils aîné décédé dans un lac tout proche – Michiel conserve le secret de ce suicide escamoté –, c’est sans doute pour dire le trouble de cette identité silencieuse hantée de fautes impardonnables. À travers une expérience en grande partie habitée par la nature, sa contemplation bouleversante et l’omniprésence de l’élément liquide (le « water » du titre, étrangement disparu), Behr parvient à dire la solitude d’un être, les répétitions traumatiques, ses contradictions terribles – que la dimension psychanalytique du roman prend en charge inégalement – en les reliant à ce qui le dépasse et en grande partie le nie.
Les Rois du Paradis obéit à un mouvement de recouvrance, de retrouvailles, de réconciliation. Dans les rapports filiaux qui y trouvent enfin un espace – la scène du bain du père est un grand moment –, le romancier abolit une certaine distance entre les êtres, les fait se rencontrer, leur attribue une parole qui, seule, vacillante, peut contrevenir à une inéluctable violence, à ce qui les travaille au plus profond.
Behr n’a certainement pas écrit un roman familial seulement, il s’obstine à le dépasser avec discrétion, à dire la fragilité de l’homme, ses contradictions, les silences qui le dévorent, les deuils qu’il ne parvient pas à faire, la complexité d’un univers déchiré, la valeur du pardon. Et n’est-ce pas ce que veut lui dire son père, ce « tyran » au « regard bleu cobalt » toujours silencieux et buté, lorsque, renversant l’ordre du roman, il lui chuchote : « Ne nous oublie pas à nouveau » ?
- Steppe de l’Afrique du Sud.

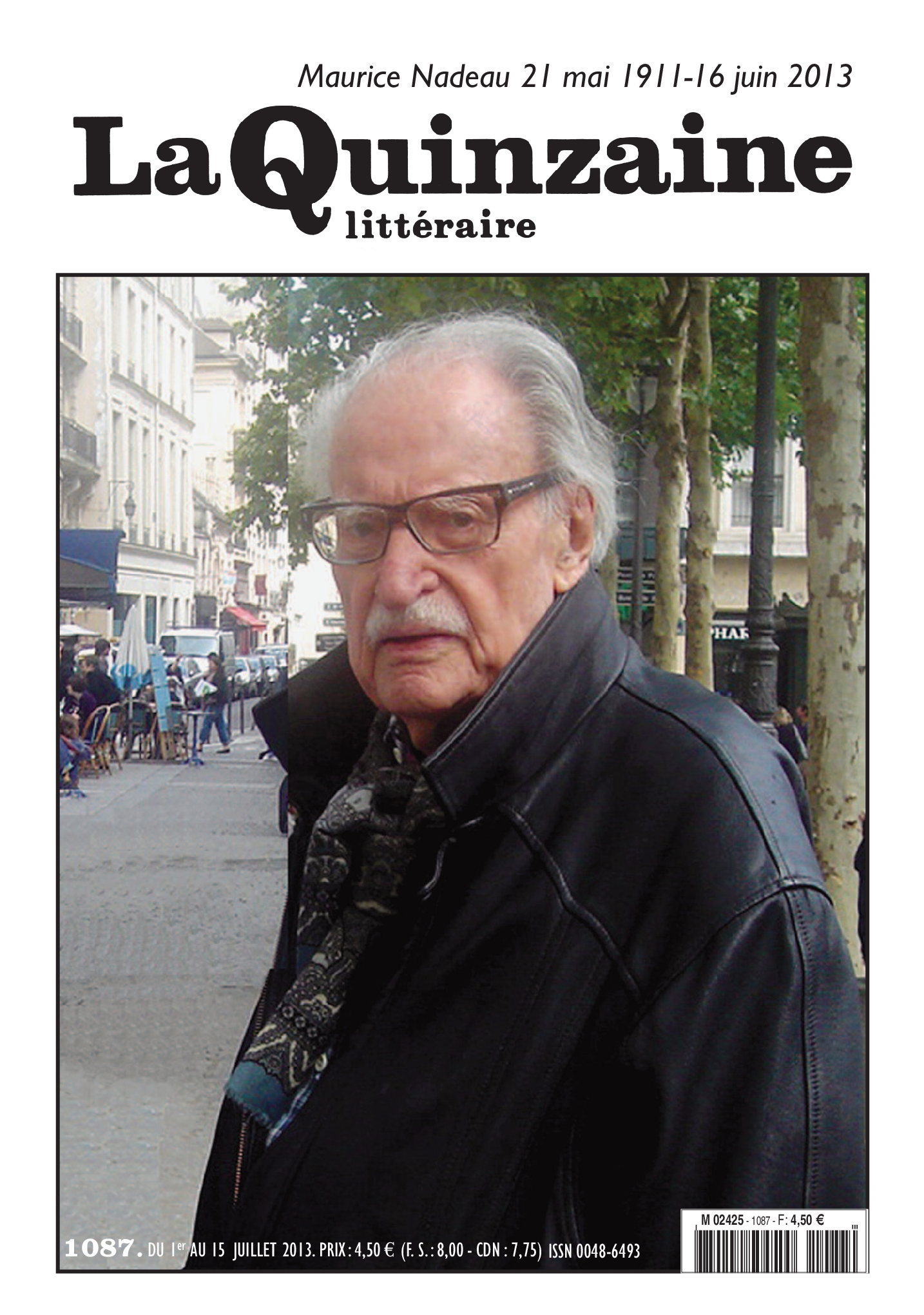

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)