Il fallait un jeune auteur – Alexandre Seurat a trente-six ans –, et un premier livre n’ayant pas à confirmer ou infléchir une réputation déjà acquise, pour avoir un tel courage : oser un livre qui s’apparente à un compte rendu de cours d’assises, puisqu’on y entend successivement les témoignages et les dépositions de tous les intéressés, sans que l’auteur apparaisse jamais. Le lecteur est confronté à la violence nue des propos, à la solitude pathétique traversée de culpabilité de ceux qui n’ont rien pu faire, et qui, après coup, reconnaissent qu’ils savaient déjà. Ainsi, l’institutrice, dont la première phrase ouvre le livre : « Quand j’ai vu l’avis de recherche, j’ai su qu’il était trop tard. » Tout le livre s’inscrit dans cet après coup marqué par l’irrémédiable. C’est le schéma d’une tragédie où tout est donné au début mais ne s’éclaire qu’à la fin, autour de la figure sacrificielle de la victime innocente.
Pas de commentaires ni d’analyses psychologiques explicites. Ce sont au début les témoignages de la tante et de la grand-mère de l’enfant qui permettent au lecteur de comprendre l’origine de son infortune : fille non désirée d’une mère qui quitte son compagnon avant de se réconcilier avec lui, elle est d’abord déclarée née sous X, avant que la mère ne vienne la rechercher. Elle avait dit à sa soeur que l’enfant était « mort-née » : son futur martyre donnera un sens terriblement exact à l’expression.
Le livre décline l’histoire de Diana comme les différentes stations d’un « calvaire » qui ne mènera à aucune rédemption. Jamais scolarisée jusqu’à six ans, puis ballotée d’une école à l’autre au gré des déménagements incessants de ses parents, elle ne tarde pas à inquiéter par les signes accumulés d’un corps violenté : coups sur les genoux, douche infligée à l’enfant toute habillée pour la punir, empreintes de crampons sur la cuisse, « énorme trace violette en épi de blé sur toute la longueur de la colonne vertébrale », et jusqu’à ces marques atroces sous la plante des pieds qui l’empêchent presque de marcher, mais qu’elle tente de cacher en claudiquant. La fin relève du récit d’horreur. Entre une disparition fictive et un enlèvement simulé de son enfant, le père demande qu’on l’aide à transporter un « gros bloc de béton de son garage ». Il en indiquera très précisément le lieu lors de sa garde à vue.
On reste horrifié, tout au long du récit, par l’habileté des parents à masquer leur crime derrière un embarras à dire : « C’est difficile, avec Diana ». Totalement accordés dans leurs déclarations, ils sont « indissociables, soudés comme les mécanismes d’une machine », avec « une apparence de naturel qui mettait mal à l’aise ». De son côté, Diana se mure dans un silence volontaire : « avec cette petite, il n’y avait pas de brèche – que ce rire incessant, interminable, qui secouait ses réponses ». Parfois le silence s’ouvre, et elle lâche un rapide « Maman, hier, elle m’a tapée », qu’elle s’empresse de nier.
Car l’enfant s’ingénie à cacher la violence dont elle est victime. C’est un des aspects les plus bouleversants de cette histoire, dont le lecteur ne peut qu’imaginer les ressorts : le désir secret, pour Diana, de se construire par le mensonge une vie normale, et sans doute le désir de se sauver en épargnant ses parents, dont elle avait besoin pour grandir. Elle inverse même son malheur par des rêves d’assistance à autrui : elle « voulait devenir gendarme […] elle voulait aider les gens ». Si quelques rares paroles de Diana sont rapportées à travers les propos des témoins, elle est presque toujours réduite au silence : jamais sujet à part entière, toujours objet des commentaires d’autrui, vouée à rester l’autre, définitivement la « maladroite ».
Pris dans l’écheveau des voix solitaires mais entremêlées des témoins, le lecteur revit de l’intérieur les drames des protagonistes. C’est l’une des grandes forces de ce livre : il brise la distance établie par les chroniques judiciaires des journaux, il défait le confort de la rhétorique des « faits divers » pour nous plonger dans un monde de souffrances, violences, nondits, douleurs muettes, supputations diverses, mélange de complicité et d’ignorance, de terreur pathétique et de semi-aveuglement.
À l’accablement du lecteur se mêle l’indignation révoltée à l’égard des administrations qui, par indifférence ou inertie, ont permis cette tragédie de l’enfant martyr. La deuxième institutrice : « j’ai appelé le bureau du procureur, et à force que j’insiste, qu’on me promène de poste en poste j’ai finalement appris que l’affaire avait été classée, faute d’éléments suffisants ». Le livre n’en dit pas plus. Face à l’indifférence anonyme de la machine judiciaire qui allait précipiter la mort de Diana, il montre des enseignants admirables de dévouement et d’empathie pour cette enfant qu’ils ont tout fait pour sauver. Tous ces témoins s’assemblent progressivement dans l’ouvrage, à la manière d’un choeur antique, dans un oratorio funèbre où les voix se succèdent, simplement juxtaposées et sans dramaturgie : les corps immobiles ou absents, seules s’élèvent les voix découpées sur le silence.
Il est difficile de parler d’esthétique littéraire à propos d’un ouvrage qui réactive tant de souffrance vécue. D’autant que l’auteur a fait un véritable travail d’enquête pour retrouver les déclarations des différents protagonistes, et qu’il a choisi de ne jamais prendre la parole, laissant le lecteur devant l’évidence à vif de la souffrance et du crime. Mais l’écrivain opère en sous-main : par une construction en boucle qui apparente cette histoire à une tragédie, et par une écriture qui tisse très finement les différents propos avec la voix de l’auteur. C’est lui que l’on entend dans la déposition de la gendarme, évoquant « le noeud d’énergie, de résistance, dans ce petit corps sur cette chaise, avec les mains soigneusement posées sur ses genoux serrés, souriant comme une enfant sage ».
C’est aussi indirectement la voix de l’auteur qui se fait entendre, à la fin, dans un « Épilogue » qui donne fictivement la parole au frère. Lui qui s’est tu, complice par impuissance autant que par indifférence, se met à réinventer leurs vies brisées dans une langue traversée de chaos : « je me demande si, dans le cas où on aurait été une autre famille […] si elle n’avait pas été elle et si je n’avais pas été moi, ceux que nous avons été – est-ce que les autres que nous aurions été auraient pu être frère et soeur ? ». Travail de deuil, « tombeau » dédié à la victime innocente, La Maladroite porte en filigrane ce rêve de fraternité impossible, formulé après coup : une fois encore, et définitivement, il est trop tard.
Daniel Bergez
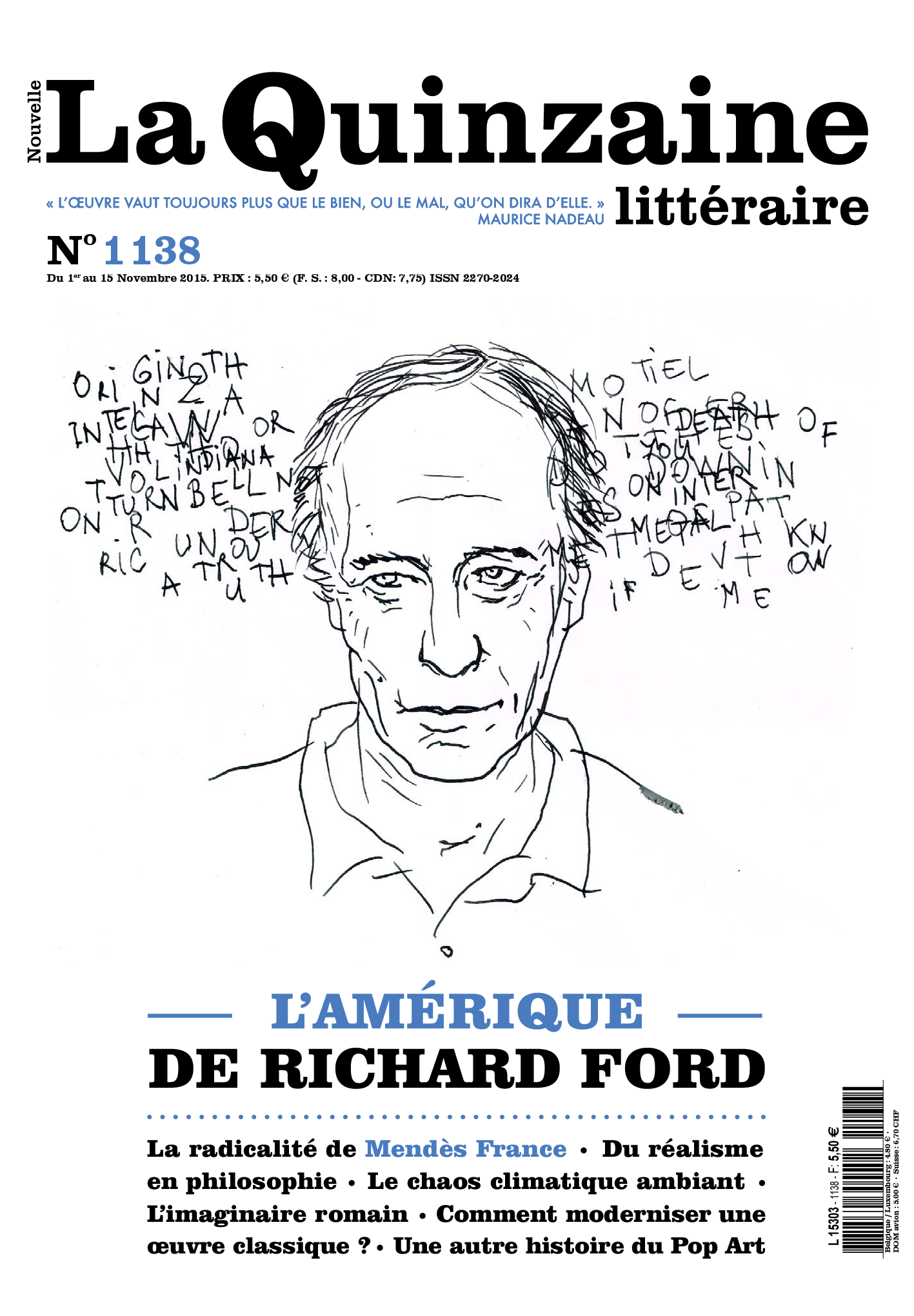

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)