Viviane Forrester n’écrit jamais le convenu ou l’attendu, dans ses fictions, comme on dit de nos jours, dans son Journal également ; s’estime liée à la narration « mais surtout à l’énigme, au secret, à ce qui sera tu et d’autant plus présent, exprimé ». Mettre à nu le secret, l’exposer, non pas pour le forcer, l’obliger à se dire, se livrer, plutôt pour qu’il paraisse, qu’on en perçoive la présence.
Il y a dans ces textes un dynamisme contagieux. Car il convient, ainsi que l’y incite John, son compagnon d’alors, « d’être toujours au commencement, jamais à la fin d’une entreprise », de se tenir au centre, non du carré qui clôt, mais du cercle qui préserve l’énergie puisqu’elle y est semblable en chacun de ses points.
L’obsession de Viviane (le beau prénom de fée qui enferma Merlin dans sa cage de verre) est justement de n’être pas serrée, finie ou empêchée par des limites, les siennes ou celles qu’autrui impose : « Je me cogne la tête contre moi-même, je suis si étroite. » Alors, y échapper par la passion de l’œuvre. Celle des mots, de la littérature qui aurait « quelque chose de la messe en sa réitération perpétuelle ».
Dimension religieuse évidente : l’œuvre peut survenir, comme Minerve toute armée, du moins toute constituée, du crâne de son auteur, elle préexiste, et il suffit de l’accueillir.
Ou dimension magique, à la manière des alchimistes médiévaux, dont la recherche semblait vouée à quelque ordre divin. Mais appuyée, comme un pont sur ses arches, accotée à la vie temporelle, luttant contre elle pour exister.
Écrire : être seule et ne plus l’être. L’isolement et son contraire. Obligation de différence, de dissemblance, jusqu’au rejet, pour rejoindre les autres. Et ceci y compris dans la vie personnelle, dans l’amour, dans le couple : « L’idée de mariage à laquelle il me faudra bien m’habituer », « Être libre, ne plus être la femme de quelqu’un ». Quitter sans cesse.
Commence alors pour elle, à partir de la prise de conscience, de l’affermissement de soi (nous sommes en 1967), le besoin de sortir de son nid, de rencontrer le monde et d’être publiée : elle envoie des nouvelles à Maurice Nadeau, pour la revue Les Lettres Nouvelles. Qui tout de suite est enthousiaste, raconte-t-elle.
Être écrivain, pour elle, la seule manière d’être au monde, de s’y tenir et de ne pas s’y égarer, car écrire c’est aussi et surtout en « lisser le chaos » ; outre cet ordre à instaurer, c’est tenter « de mourir un peu moins », se construire un refuge, un royaume.
La relation avec Maurice Nadeau s’est instaurée. Il publiera trois romans d’elle : Ainsi des exilés, en 1970, Le Grand Festin, en 1971, Le Corps entier de Marigda, en 1975, tous trois dans la collection des « Lettres Nouvelles », chez Denoël, et le texte de cinq émissions à France-Culture. Il lui offrira même de quoi un peu gagner sa vie avec des tâches rédactionnelles. Autant dire que c’est lui qui la lance, la découvre, lui donne en quelque sorte une autorisation à exister comme écrivain, à endosser ce rôle bizarre, à part, admiré et quelquefois honni, en tout cas constamment incompris. Magnifique et terrible cadeau.
Car la publication, et la reconnaissance qui lui succède sans tarder, ne sont pas rassurantes, au contraire. Viviane Forrester a l’impression, comme Virginia Woolf, qu’on la méprise. Étrange sensation et néanmoins compréhensible. Rien ne vaut le travail et le bonheur qui en découle, à l’intérieur de son abri. Dès qu’on en sort, qu’on apparaît et qu’on se livre aux autres, on n’en est pas grandi, mais dégradé. Mal pourtant nécessaire, qui ne nuit nullement à l’attrait du bonheur : « Je pourrais être heureuse même en étant une pierre. »
Être heureux. Le bonheur a besoin du refuge solitaire, il a besoin aussi de la confrontation avec les lieux, les êtres, avec ce qui est hors de soi, redécouverts, réinventés, si on consent à s’oublier, presque à se perdre ; à retrouver « l’inconnaissance » par la concentration et la méditation, et à sauvegarder le temps déchu et retrouvé, pont suspendu entre passé, présent. Temps nécessaire à l’œuvre. Ce qu’on mesure dans le Journal où la pensée d’un livre, Le Corps entier de Marigda, naît vers 1970, s’impose peu à peu, prend le temps de grandir, pour aboutir à la publication cinq ans après. « Toute cette vie. Toute cette vie pour parvenir à écrire ces mots. »
Patience draconienne, écrit Viviane à propos du journal du Che. L’expression lui convient à elle aussi. L’écriture, « un recommencement, une cérémonie au lieu même où la Passion est advenue déjà », écrit-elle cette fois à propos de Lowry.
Dans la fureur glaciale rassemble quatorze textes, dont certains publiés en revues (Nouveau Commerce, Télérama, Lettres Nouvelles). On y retrouve l’écho des romans qu’elle travaille à la même période, et du Journal, bien sûr, dont les propos s’éclairent, se convertissent en dialogues.
Importance de ceux-ci, tout au long des nouvelles, rompues, inattendues, où Viviane Forrester intercale le passé dans la trame du récit au présent, suscite un va-et-vient entre la paix présente, le bonheur, par exemple, d’un voyage en Pologne, d’un séjour en montagne, et le malheur, la terreur du passé. Et cela d’autant plus que malheur et terreur n’ont pas été vécus directement par elle mais qu’elle y a baigné, qu’elle s’y est abreuvée comme à la source empoisonnée et pourtant nourricière de sa propre origine.
« – On pourra visiter ce qui reste des camps. Ça doit t’intéresser ?
Le silence en Pologne. Ces voix tues ou tuées, plus mortes que la mort. Ignorées.
– Il ne reste plus rien, ai-je répondu.
Comment parler du lieu où l’on a trépassé ? » (noter alexandrin parfait).
Le Journal, éclairant fondement pour la compréhension de l’œuvre. Et celle-ci, première, dans les nouvelles qui l’annoncent, en proposent des éclats, une préfiguration, chacune d’elles cependant achevées, pertinentes.
Marie Etienne
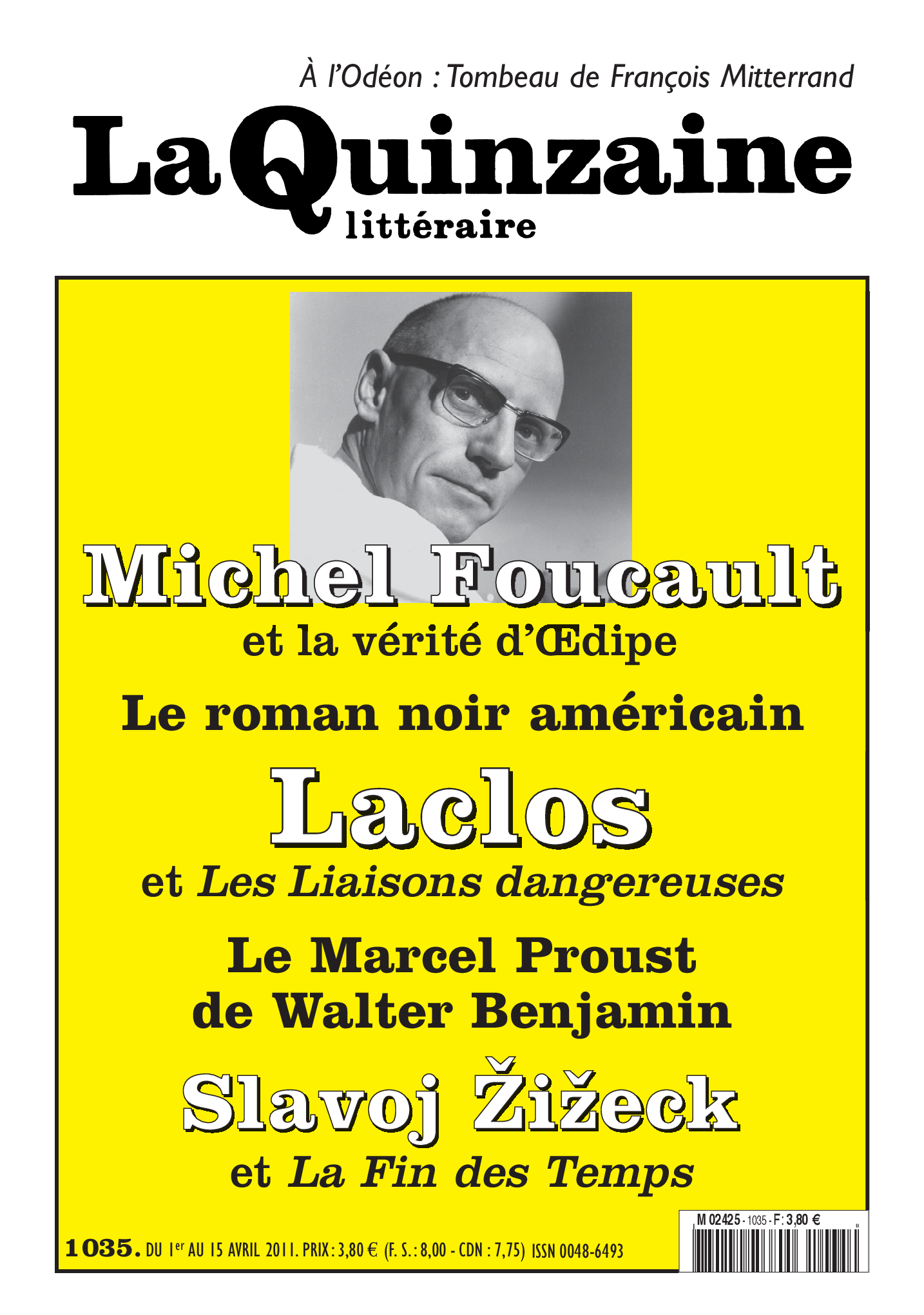

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)