De celui-ci, il a la notation de menus ou grands faits de la vie : recevoir une lettre, prendre un train, un avion, se rendre en Argentine, écrire et publier un livre, lire et se promener… Mais sa composition n’est pas chronologique. Les textes non datés sont répartis en 7 chapitres qui en constitueraient 7 versions différentes si l’on se fie aux titres : Première version, Deuxième version, etc. Nous serions en présence d’une relation répétitive, d’une tentative renouvelée 7 fois de raconter l’inracontable, de déchiffrer l’absence, de fixer le non-être ?
Il s’agit en effet d’un projet de ce type. Silvia Baron Supervielle annonce dès les premières pages sa décision de renoncer aux souvenirs, estimant qu’ils occupent trop de place, qu’ils empêchent le présent d’advenir. Elle n’y arrive pas tout à fait. Surgit, à la deuxième séquence, à propos d’une lecture sur les handicapés, le souvenir de sa petite sœur : « Couchée en permanence, elle émettait des sons gutturaux et souriait, riait follement en me voyant arriver, c’était la fête… »
Le handicap est un exil, la tâche d’écrire en est un autre, puisqu’elle consiste à rechercher « le mot entier que j’attends », et à interpréter « une langue muette qui convient aux contrées inaccessibles ». Pire, ou mieux, écrire n’est pas trouver un style, « souvent rattaché à la décoration », c’est répondre à la nécessité impérative, sans recul ni refus, de se livrer tout entier à la solitude : « Lorsque l’homme n’a plus où aller, où s’enfuir, où trouver un abri, il a une possibilité de se livrer. » Quel désespoir !
Les pages s’organisent, dans chacun des chapitres, en séquences distinctes, qui toutes commencent par la vision du ciel et toutes s’achèvent par quelques vers de Dante, extraits de la Divine Comédie. En sont tirés les derniers mots, qui sont placés en tête, qui titrent les séquences : « s’ajuste avec le temps », « allume l’amour », « n’a pas été rompu ». Le lecteur est brassé par la répétition et par la différence d’une vie qui se veut happée et consacrée à l’intériorité, à la quête spirituelle, comme tourné et retourné à l’intérieur de cercles.
Ayant abandonné au moins partiellement les souvenirs de son enfance, de l’Argentine, et n’étant pas vraiment entrée dans le présent de son nouveau pays, la France, elle ne se sent jamais chez elle, jamais nulle part, exilée où qu’elle aille. Un aveu bouleversant, noté en termes nus : « l’éloignement est devenu ma résidence véritable », « je demeure dans un rêve ouvert », à la recherche du signe espéré qui « n’a pas encore trouvé sa forme écrite », destiné à approcher le mystère plutôt qu’à le dévoiler.
Une méditation sur l’exil qui n’est pas, contrairement à ce qu’on croit, seulement abandon du pays d’origine, mais perte, du fait de l’abandon, de tous les autres lieux et des ancrages qu’ils autorisent. S
ilvia Baron Supervielle, auteur de poésie, d’essais, de récits, est aussi traductrice de Borges, Silvina Ocampo, Arnaldo Calveyra vers le français et de Marguerite Yourcenar vers l’espagnol. Elle commence à traduire de celle-ci des poèmes découverts sur les quais, dans une revue et lui envoie le fruit de son travail. Lequel est accueilli avec chaleur. C’est le début d’une relation épistolaire entrecoupée par des rencontres et un séjour à Petite Plaisance, la maison où vivait l’académicienne, dans le Maine, aux États-Unis. Silvia Baron Supervielle reconnaît en celle-ci une sœur en exil, une citoyenne du monde qui ne se sent jamais nulle part vraiment chez elle, et dont la résidence véritable, ainsi qu’elle l’écrit dans sa préface au volume, est « un espace dépourvu de frontière et de temps ». Cette préface, leur échange, permettent d’imaginer la grande dame au quotidien, jetant sans les ouvrir les lettres qu’elle recevait quand elles portaient mention, sur l’enveloppe, de la formule de l’Académie française ; distante avec le voisinage mais familière avec les jardiniers, livreurs, employés de maison ; constamment au travail, dans toutes les pièces de la maison, sur différents cahiers ; et constamment sollicitée : « Je n’ai encore malheureusement pas eu le temps de lire votre volume. Vous m’excuseriez si vous voyiez les piles de traductions non relues, d’épreuves non corrigées, de lettres non répondues et souvent non lues qui s’étagent sur mon bureau et ne diminuent que peu à peu », écrit-elle le 27 juin 1984 à sa traductrice.
Leur correspondance, qui durera jusqu’à peu avant sa mort, reflète l’estime et l’affection de l’aînée pour la cadette, à qui elle saura gré, entre autres choses, de s’être intéressée à une activité qui lui tenait à cœur mais qui ne comptait pas autant qu’elle eût voulu dans sa notoriété – sa pratique poétique ; l’intense admiration et l’affection aussi bien sûr de la cadette pour l’aînée, qui lui écrit, traduisant Feux : « Quelquefois je reste plantée là, bouche ouverte. »
Marie Etienne
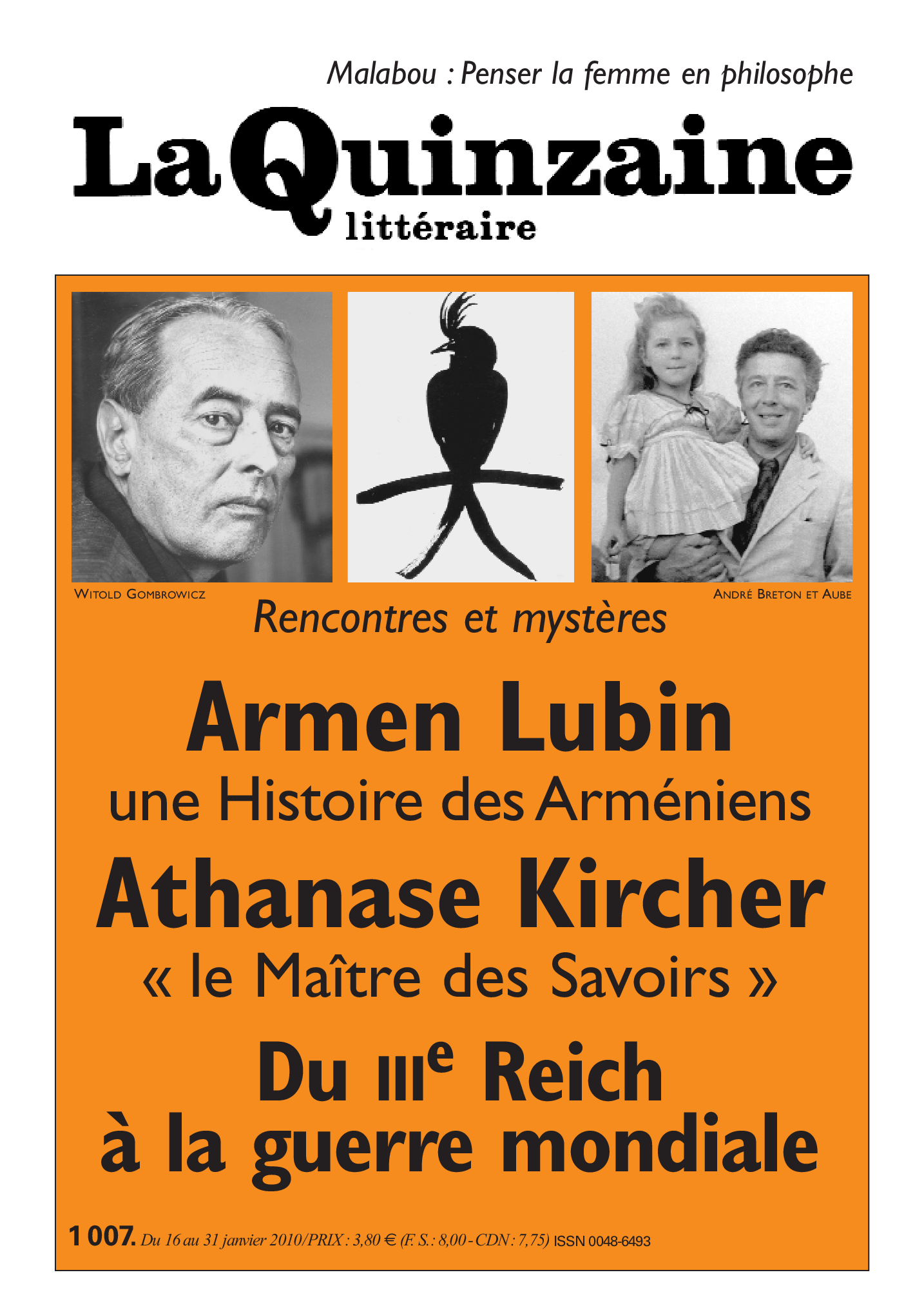

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)