Éblouir : à la fois illuminer par une splendeur et aveugler par une trop forte intensité. La Venise que nous présente l’exposition est un théâtre où tout se donne à voir et à entendre, mais dans un jeu de masques où l’illusion joue à plein, où les identités se travestissent dans une comédie à la fois festive et sourdement mélancolique. Bien des scènes picturales rappellent la tradition de la commedia dell’arte, où les personnages sont ostensiblement joués par des acteurs dont le visage est caché, tandis que l’identité affichée par le masque n’est qu’un « rôle » dramatique.
La Scène de carnaval ou le Menuet de Giandomenico Tiepolo – observateur ironique de la société contemporaine, qu’il peuple de polichinelles, de montreurs d’instruments d’optique, de charlatans – est exemplaire de cette atmosphère : la danse aristocratique qui occupe le devant de la scène y est entourée par un ballet de figures tirées de tous les ordres de la société, représentant toutes les conditions sociales, encadrées par des personnages masqués, d’un côté, et par un ensemble de musiciens, de l’autre côté. Redoublant cette logique du spectacle joué, un groupe de jeunes personnes, juchées au-dessus d’un parapet, observent la scène, faisant face au spectateur du tableau, qu’ils représentent ainsi mis en abyme.
La Venise du XVIIIe siècle, marquée par le style « rococo » qui achève triomphalement l’esthétique « baroque », se plaît aux chatoiements. L’ornementation y triomphe dans les riches vêtements, dont on voit ici trois exemples sur un couple aux visages de mannequins, ou dans le verre de Murano, superbement inséré dans les boiseries d’un fauteuil. Elle éclate dans la musique du temps, « ornée » précisément, comme le voulait l’esthétique baroque ; quelques instruments, comme un violoncelle rare et une très belle mandoline milanaise, accompagnent une présentation de partitions, dont l’une, autographe, de Vivaldi, à la graphie empressée, comme emportée par le mouvement rythmique de l’œuvre en train de s’écrire.
Pour les peintres et en dehors des scènes de comédie et de bal, l’inspiration est fournie par la ville elle-même. Avec ses façades décorées, ses églises et son Palais des doges, elle est un motif inlassablement répété et sujette à de multiples variations de tonalités et d’angles de vue. L’influence de la peinture du Nord est évidente dans cet art de représenter frontalement des façades, mais leurs alignements massifs en font un décor de théâtre, tout ensemble chatoyant et mystérieux. On n’en perçoit jamais l’envers ni l’intérieur, parce que tout se joue à l’extérieur, sur la scène indéfiniment réinventée qu’offre la ville, avec ses places et ses escaliers qui servent de tréteaux à la comédie de la vie.
Dans ces alignements architecturaux qui sont un vrai défi pictural, l’art des peintres introduit des ornementations et des variations qu’on pourrait dire « musicales ». Sous l’harmonie vaporeuse du ciel, qui nimbe et fond les formes et les teintes des palais, l’on voit et l’on entend le staccato des fenêtres alignées – scandant le rythme obsédant d’une même mesure répétée à l’infini ; on perçoit le legato de l’eau qui coule dans les canaux ; on est saisi par les pizzicati des petits personnages ajoutés après coup, piqués sur la toile de la pointe d’un pinceau nerveux.
Si la ville est en elle-même motif pictural, c’est que l’art n’est pas séparé, du moins pour la société aristocratique, de toutes les activités, même quotidiennes. Une commode vénitienne, mêlant ébénisterie, art et décoration par des motifs floraux se détachant sur un bleu-vert clair, rappelle à quel point, dans une Venise connaissant alors un relatif déclin économique, se développa un très subtil artisanat de luxe. De même, Le Départ du Bucentaure de Francesco Guardi, d’une virtuosité technique impressionnante, est une brillante variation picturale sur une fête à la fois aristocratique et populaire, où les spectateurs ici encore redoublent le regard porté sur le tableau. L’art est partout : comme le soulignait le dramaturge Carlo Goldoni, « on chante dans les places, dans les rues et sur les canaux ». Jean-Jacques Rousseau, qui fut un temps employé à l’ambassade de France à Venise, écrivait de même à propos des barcarolles chantées par les gondoliers : « En les écoutant, je trouvais que je n’avais pas ouï chanter jusqu’alors. »
L’exposition est l’occasion de redécouvrir les maîtres de la peinture vénitienne du XVIIIe siècle : Canaletto, Francesco Guardi et bien sûr Giambattista Tiepolo, véritable génie pictural protéiforme, à la technique aussi puissante que raffinée et dont toutes les œuvres, par la disposition des couleurs, le rythme de la lumière, l’expressivité des corps, dégagent une théâtralité saisissante. Que ce soit dans Neptune offre l’abondance à Venise ou dans l’extraordinaire Danaé et Jupiter, la vigueur d’un pinceau vibrant d’énergie accompagne des gestes et postures qui dessinent une véritable narration dans l’esthétique normalement figée de l’art pictural.
On découvre aussi certains artistes peu connus, telle Giulia Lama. Après Artemisia Gentileschi au XVIIe siècle, elle fut l’une des rares femmes à travailler le genre noble et particulièrement redoutable de la peinture d’histoire. Son Martyr de saint Jean l’Évangéliste, avec un effet de contre-plongée et un brossage vigoureux de la toile, dégage une énergie saisissante, où l’ardeur picturale semble se confondre avec la verticalité extatique du personnage. L’exposition présente aussi une composition très surprenante de Canaletto : loin des représentations frontales de la ville dont il est coutumier, il crée, dans L’Atelier des tailleurs de pierre au Campo San Vidal, une perspective qui repousse à l’arrière-plan le sujet traditionnel et qui met en valeur les artisans au travail, les blocs de pierre brute qu’ils taillent, leur cabane en planches mal dégrossies. Animée par un fort jeu de lumière qui la dramatise, la scène est unique dans l’œuvre de Canaletto, introduisant une tonalité populaire et sombre qui semble anticiper le XIXe siècle.
Certains visiteurs pourront sans doute regretter que la fête vénitienne soit ici désignée plus que représentée dans cet accrochage essentiellement visuel : comment se plonger dans la Venise du XVIIIe siècle, sans entendre en même temps des airs d’opéra, des voix de castrats ou tel ou tel concerto de Vivaldi ? L’entreprise muséale trouve ses limites, s’agissant d’un tel objet d’exposition : les arts à Venise ne sont pas dissociables les uns des autres, ils forment un vaste concerto dans l’immense espace de résonance de la Sérénissime. En rendre compte par une collection de fragments juxtaposés – même si le parcours de l’exposition est bien ordonné – donne le sentiment que la partition n’est pas complète. Mais les Italiens eux-mêmes ont cautionné la formule : l’exposition est organisée conjointement par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et par la Fondazione Musei Civici di Venezia. Elle sera d’ailleurs présentée à Venise – du 23 février au 9 juin 2019 –, comme un miroir que la ville se tendra à elle-même.
Daniel Bergez
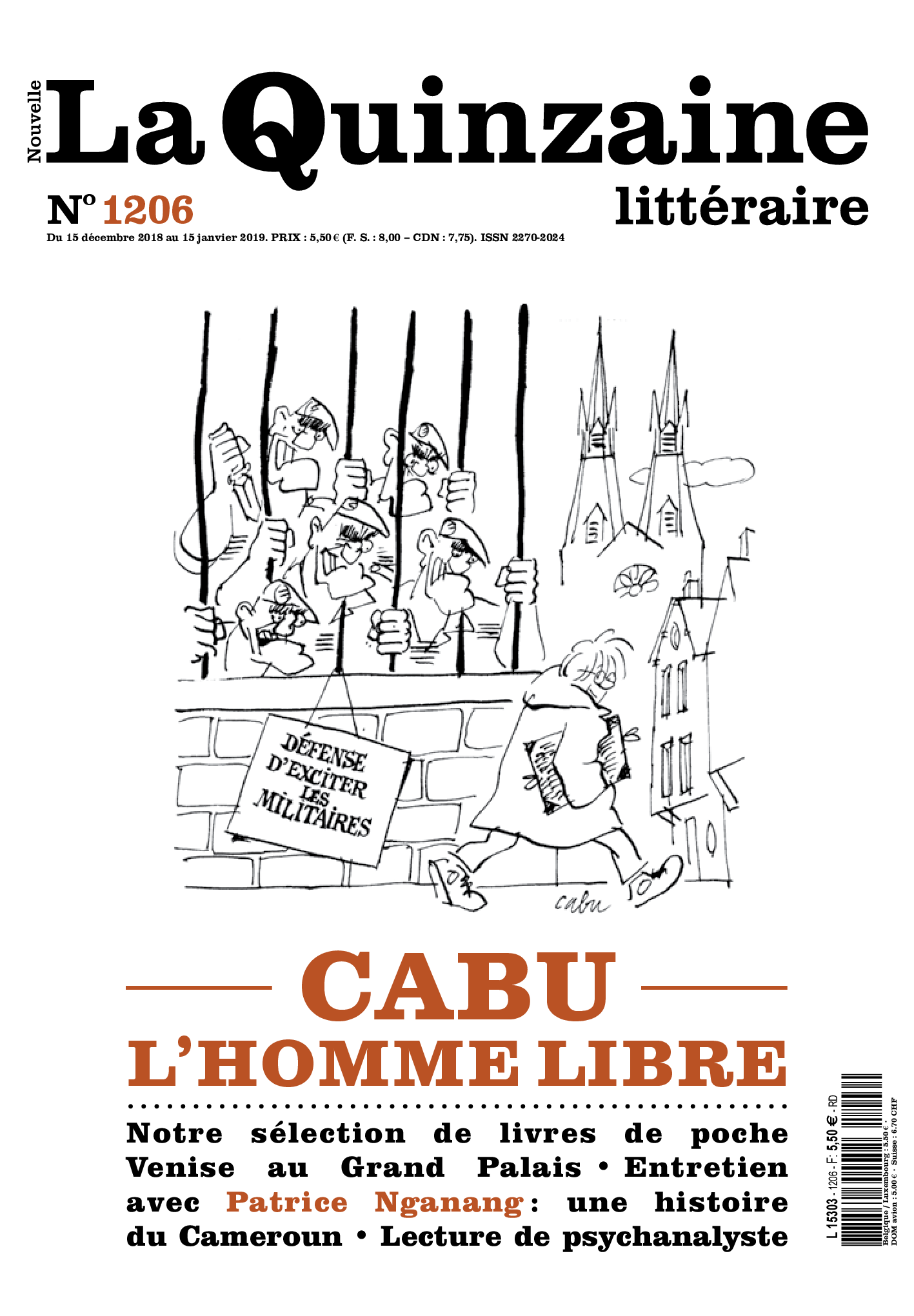

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)