« Ils allaient passer leurs derniers jours en tant que mari et femme comme les tout premiers, presque trente ans auparavant, aux chutes du Niagara, comme si, de l’autre côté de la frontière, près de ce légendaire et tumultueux chaudron des nouveaux départs, loin de toute créance domestique qui sapait leur quotidien, ils avaient une chance de se retrouver l’un l’autre. » Sur cette trame contrastée qui fait naître un certain sentiment nostalgique, O’Nan brosse le portrait d’un couple de quinquagénaires à la dérive, comme abasourdis de vivre une vie qui lentement se défait, minés par la crise économique, endettés, emportés par une existence commune qui perd son sens et par des regrets sourds et anciens qui les étouffent. Ses héros ne se reconnaissent plus et ne peuvent espérer se retrouver qu’en revivant ce qu’ils s’imaginent avoir été le meilleur de leurs existences trop communes.
Leurs aventures médiocres, l’affaissement de leurs personnalités qui se confrontent à une manière de néant intérieur teinté de remords, structurent un récit tout entier inscrit dans une sorte de potentialité qui jamais ne s’accomplit – laquelle prend toute sa valeur dans les titres des chapitres, établis sur de simples probabilités plus ou moins saugrenues. Le récit décrit ainsi une vie presque irréelle qui s’abîme dans ce qu’elle n’est plus, souligne un extrême inconfort, l’inadéquation fondatrice entre désir et réalité, les fables que nous nous racontons à nous-mêmes pour nous faire croire que nous sommes vaguement heureux. Les étapes de leur voyage – qui repose sur une espèce d’arnaque – s’apparentent ainsi à un double jeu qui, d’un côté révèle les béances qui les séparent, et de l’autre les enferme dans une parodie de leur passé idéalisé. O’Nan excelle à démonter leur illusions, à se jouer des chances qu’ils ne saisissent pas, à les exhiber avec une violence que son écriture un peu plate, feutrée en même temps que sophistiquée, ne masque pas, à rendre palpable leur désarroi et le vide stupéfiant de leurs vies définitivement factices.
Il parvient, avec une virtuosité plutôt discrète, de la manière la plus simple possible, à faire alterner l’intériorité toujours inadéquate de ces deux personnages à la limite de la bouffonnerie et les différentes époques de leurs vies qui n’émergent que pour renforcer une impression terrifiante de gâchis. Les Joueurs est un roman de la farce dépressive, du néant qui engloutit les personnalités et leur révèle leur dimension véritable, étriquée, extraordinairement conformiste. L’écrivain les contemple patiemment – avec une évidente cruauté, une sorte de tristesse désenchantée – s’échiner à lutter avec le rien qui les fait tenir encore un peu. Il y a un voisinage évident ici avec les grands textes de Richard Yates (1) qui, comme lui, souffre d’une lecture trop psychologisante, alors que ces deux écrivains fouillent obstinément la conscience américaine, ce qui l’anime au plus profond, cette manière de construction perverse de soi qui fait s’intriquer des discours contradictoires, des formes sociales essentielles et l’ahurissant mécanisme de déni qui les sous-tend. Avec ce roman épuré, O’Nan chorégraphie les troubles d’une société hyper-individualiste qui abandonne les êtres à leurs souffrances et à leurs illusions.
L’innocence est, désormais, définitivement perdue, semble-t-il nous dire. Ainsi, son roman, comme le cycle des Maxwell (2), adopte les mêmes tonalités minimalistes – que renforce la forme même de ce dernier récit extrêmement simple et net –, redit l’attachement à une forme subtile d’analyse sociologique d’un monde trop conforme et trop lisse sous la surface duquel bruissent le malheur et le désarroi d’êtres comme égarés dans leur vie. Il contrevient ici – avec un brio que les lecteurs familiers repéreront immédiatement – à une lecture psychologique, lui superposant la même réflexion continuée sur des identités qui s’établissent et s’effritent sous le poids de leur propre image. O’Nan les décompose ainsi, implacablement, ordonnant leur nature capitaliste ambiguë et destructrice, sonnant la charge contre un matérialisme nocif et l’obsession de la possession qui altèrent les êtres et les réduisent à un silence malheureux, à une terrible nausée.
Car tout le roman – établi sur les chances que nous saisissons ou pas et leurs projections permanentes sur le passé – n’est qu’une succession de clichés que l’écrivain met en scène, avec un sens de l’artifice qu’il faut bien percevoir pour ne pas se méprendre sur sa valeur – il fait exprès ! –, ordonnant un rapport dénaturé à la mémoire et au monde qui nous entoure. Le ridicule, les dénégations des personnages, leur inscription dans un monde défait, altéré, où le faux remplace le beau, l’artifice la nature, où le rêve n’est plus qu’une consommation effrayante, semblent jaillir avec une brutalité inouïe, que viennent tempérer un ton assez anodin et une sorte de pure factualité. Les personnages demeurent ainsi aux prises avec un danger angoissant, celui de n’être rien de ce qu’ils croyaient, ne parvenant finalement qu’à se débattre sans fin dans un présent désormais vide.
Le dispositif même du roman – qui pourra dérouter –, évident, franc, très simplifié en apparence, obéit sans doute à un projet plus vaste et ancien qu’il vient en quelque sorte parachever et épuiser. Les Joueurs semble ainsi proposer une manière d’achèvement, O’Nan y condensant les thèmes qui l’obsèdent, les brassant dans une sorte de théâtralité grotesque qui se joue sans cesse des clichés, les amplifiant pour faire éclore une forme d’ultime vérité, celle d’une perte irréparable. Il nous invite ainsi, au gré d’une exagération permanente, à une lecture ironique, à une mise à distance, nous plongeant dans un malaise assez désagréable, à la fois trouble et revigorant. Dépouillé d’une certaine épaisseur tragique, obéissant à une mécanique plus désincarnée, comme réduit, le roman devient le lieu d’une pure démonstration, implacable, distante, proprement effarante, des mêmes travers et des mêmes douleurs qui font que ces êtres « avaient simplement peur de la vérité, de ce qu’elle était susceptible de révéler à leur sujet ».
- Pour plus de détails sur ces thèmes, nous renvoyons à la lecture de romans comme Easter Parade, La Fenêtre panoramique ou Un été à Cold Spring (Robert Laffont).
- Nous pensons à Emily et à Nos plus beaux souvenirs (Seuil, coll. « Points », cf. QL n° 1 065).

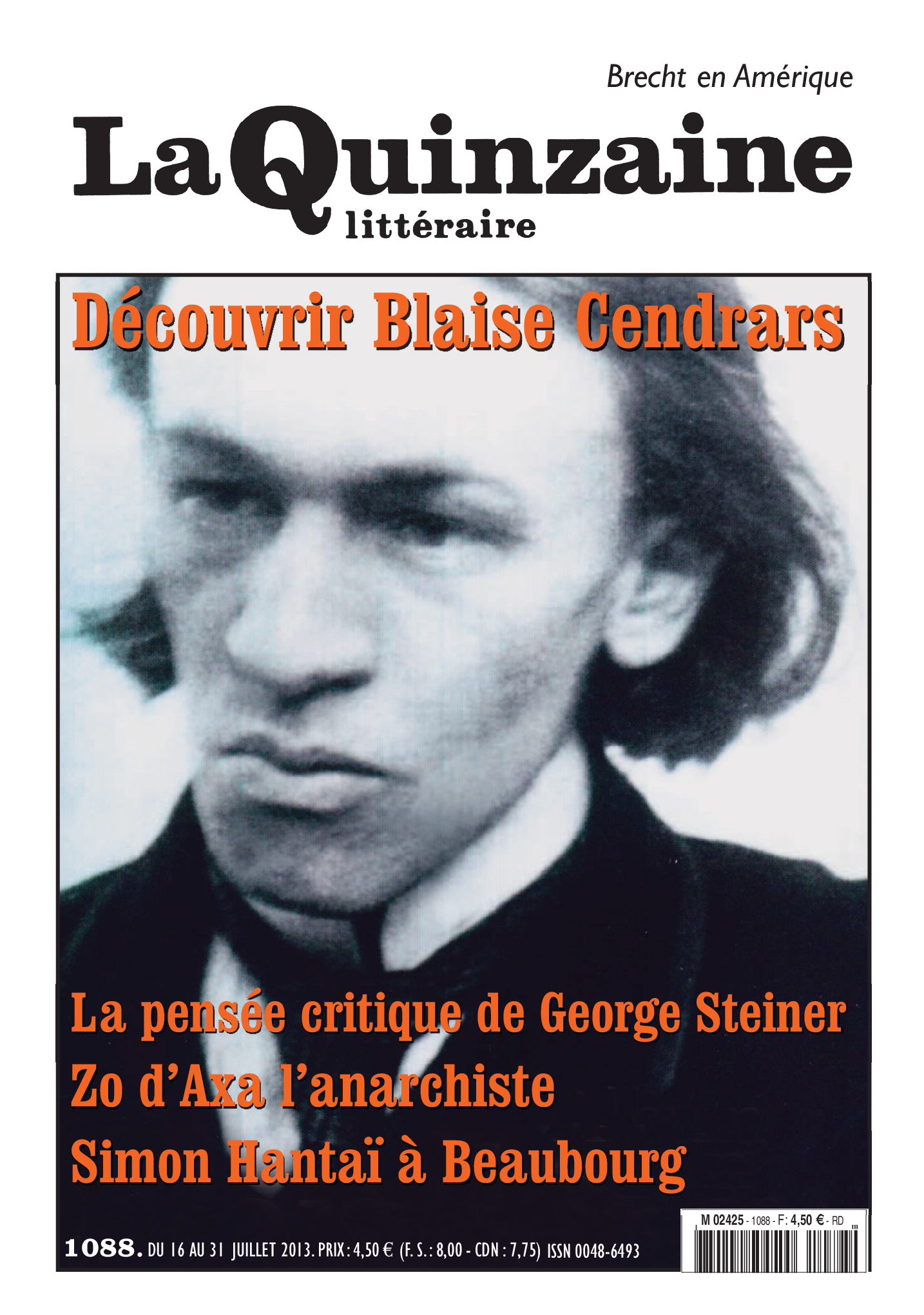

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)