L’introduction de cette édition rappelle les multiples activités menées en parallèle par Boris Vian : on lui doit dix romans, environ soixante nouvelles, trois recueils de poèmes, d’innombrables chroniques et critiques de jazz, des pièces de théâtre, livrets d’opéra, textes pour les spectacles de cabaret. Il faut y ajouter plus de cinq cents chansons, une trentaine de scénarios de films, sans compter toutes les contributions à la cinquantaine de revues auxquelles il a collaboré. S’il n’était mort à 39 ans, combien de volumes faudrait-il aujourd’hui pour publier ses œuvres ? L’écriture littéraire ne constitue qu’une partie seulement de sa création, mais elle est en elle-même étrangement plurielle, avec des romans qui dialoguent dans un étonnant contrepoint. Comme on le sait, Boris Vian a très vite choisi le pseudonyme de Vernon Sullivan pour publier des récits inspirés des polars américains, en marge des livres qu’il faisait paraître sous son nom. C’est une véritable polyphonie narrative, de la part d’un auteur ventriloque jonglant avec les registres en une alternance continue : à l’image de L’Écume des jours de Vian et de J’irai cracher sur vos tombes de Sullivan, tous deux parus en 1946, les œuvres des deux auteurs ne vont cesser de dialoguer, jusqu’au dernier roman de Vian, L’Arrache-cœur (1950-1951), qui suit de peu Elles se rendent pas compte, de Sullivan (1950).
L’habileté de Vian à se dédoubler en se masquant dans ses pastiches de polars américains s’impose parfaitement à la relecture du plus connu d’entre eux, J’irai cracher sur vos tombes, qui fit scandale. Conçu par Sullivan/Vian comme un canular, il trahit néanmoins de profondes hantises de l’écrivain : la fascination pour l’Amérique et le tropisme sexuel, formant la toile de fond d’une vengeance dans un contexte où le racisme et la question du double sont déterminants. Le livre montre de plus une parfaite assimilation et une maîtrise étonnante des codes romanesques que Vian s’approprie. Les scènes érotiques, fort nombreuses, disent crûment la violence du désir : « Elle se colla à moi si étroitement que j’en eus le souffle coupé. Elle avait une odeur de bébé propre. » Et la scène de meurtre est rendue sans pathos, par une écriture factuelle qui redouble l’efficacité de l’action : « Elle s’était laissé étrangler sans rien faire. […] J’ai pris le revolver dans ma poche et je lui ai tiré deux balles dans le cou, presque à bout portant. »
Les deux volumes de la Pléiade donnent à lire tous les autres romans de Vian, ceux qui sont signés Sullivan, comme Les morts ont tous la même peau, Et on tuera tous les affreux, Elles se rendent pas compte, et ceux qui sont publiés sous son propre nom : Vercoquin et le plancton, L’Herbe rouge, L’Arrache-cœur, et bien sûr L’Écume des jours. Il est le plus connu des romans de Vian, et à bon droit, combinant dans une histoire d’amour, avec une légèreté et une élégance rares, une pastorale moderne et une tragédie de l’amour impossible. Les paysages du début sont ceux – à moitié parodiques - de l’idylle classique, fondée sur l’harmonie et la fécondité de la nature : « Le soleil cuisait doucement les pommes tombées et les faisait éclore en petits pommiers verts et frais, qui fleurissaient instantanément et donnaient des pommes plus petites encore. » Mais la mort inexorable de Chloé, rongée et asphyxiée progressivement par le gigantesque nénuphar qui siège dans son poumon droit, est suivie étape par étape, jusqu’à la disparition finale, accompagnée de signes qui rendent cette fin inéluctable : le rétrécissement de l’espace, le vieillissement accéléré (« Tu as vieilli de dix ans, depuis huit jours »), de même que la vision de Chloé comme un gisant, qui revient plusieurs fois et réactive dans un registre funèbre le topo de la rêverie amoureuse sur l’être endormi : « Chloé était allongée sur son lit, vêtue d’un pyjama de soie mauve et d’une longue robe de chambre de satin piqué […] Autour d’elle il y avait beaucoup de fleurs et, surtout, des orchidées et des roses […] Sa poitrine était découverte et une grosse corolle bleue tranchait sur l’ambre de son sein droit. » Vian semble même démarquer directement Proust évoquant Albertine endormie lorsqu’il décrit Chloé allongée, quelques chapitres avant la fin : « Chloé dormait. Dans la journée, le nénuphar lui prêtait la belle couleur crème de sa peau, mais, pendant son sommeil, ce n’était pas la peine et les taches rouges de ses joues revenaient. Ses yeux faisaient deux marques bleutées sous son front, et, de loin, on ne savait pas s’ils étaient ouverts. » Tout annonce donc, comme dans une tragédie, l’évidence qui s’impose à Colin à la fin : « il savait que, le lendemain, Chloé serait morte ».
Le sentiment de l’inéluctable – où se projette l’angoisse du cardiaque qu’était Vian – s’allie miraculeusement dans ce roman à la grâce juvénile d’un amour d’une extraordinaire pureté. Loin des étalages de la littérature contemporaine, et tout en traduisant une forte compulsion érotique, les évocations amoureuses du roman mobilisent constamment un regard plein d’une candeur qu’on dirait native sur le mystère féminin. Rien de graveleux dans la vision des vêtements et des postures de Chloé. Sa chevelure n’engage à aucune lourde rêverie, mais déploie le bonheur d’une gaze légère : « Ses cheveux mousseux flottaient librement et exhalaient une douce vapeur parfumée de jasmin et d’œillet. » Lorsque l’évocation devient directement érotique, dans un rapport physique, le texte bascule dans un registre esthétique, doucement sensuel : « La dentelle de sa chemise dessinait sur sa peau dorée un réseau capricieux, tendrement gonflé par la naissance des seins. » Et le narrateur de commenter, quelques lignes plus loin, comme en voix hors champ, et en prenant prétexte du « jeu de Johnny Hodges » : « La sensualité à l’état pur, dégagée du corps. » Tout s’inscrit dans une tendresse infinie, une affection protectrice et bienveillante, sans transgression, qui semble puiser dans une originelle scène maternelle.
Cette composante qu’on pourrait dire enfantine se retrouve dans d’autres aspects marquants de l’œuvre, et notamment les constantes déformations oniriques de la réalité. Vian s’en est expliqué avec une remarquable lucidité dans l’Avant-propos, en évoquant une histoire dont la « réalisation matérielle proprement dite consiste essentiellement en une projection de la réalité, en atmosphère biaise et chauffée, sur un plan de référence irrégulièrement ondulé et présentant de la distorsion ». Projection et distorsion sont en effet les deux principes dynamiques de l’écriture de Vian : le réel s’y recrée sous forme ondulatoire et vibrante, dans une déformation constante de l’espace ; il se réduit et s’arrondit, au point de devenir à la fin étouffant, dans la chambre de Chloé comme dans la réalité extérieure : « Colin courait, courait, l’angle aigu de l’horizon, serré entre les maisons, se précipitait vers lui. » L’espace peut aussi être étrangement dynamisé par le mouvement du regard qui le saisit ; au début de L’Arrache-cœur, la falaise est ainsi animée : « Les grands pans de blocs rouges tombaient à la verticale dans l’eau peu profonde, d’où ils ressortaient presque aussitôt pour donner lieu à une falaise rouge sur la crête de laquelle Jacquemort, à genoux, se penchait. » Cette dynamique de l’espace est renforcée par l’apport d’un vocabulaire scientifique, qui devient matériau imaginaire et aliment de la création littéraire, même pour les scènes les plus émouvantes : « Colin s’était assis par terre pour écouter, adossé au pianocktail, et il pleurait de grosses larmes elliptiques et souples qui roulaient sur ses vêtements et filaient dans la poussière. »
Relevant d’un imaginaire enfantin, la réorganisation subjective de l’espace rejoint le goût irrépressible de Vian pour le jeu avec le langage. Entre potacherie et ironie assassine, il mobilise toutes les ressources du jeu avec les mots. Tel un enfant, il donne à certaines expressions leur sens premier (dans L’Écume des jours, les pharmaciens « exécutent » les ordonnances avec une « petite guillotine de bureau ») ou crée des néologismes qui sont l’image verbale de la chose dite (tels le « pianocktail », ou le « Bedon » de la « sacristoche »). Le langage ne fait que transcrire la logique du désir, qui courbe la réalité à son image : découvrant la chambre ronde de Chloé, le professeur Mangemanche demande, avec raison : « Vous avez joué un disque d’Ellington, alors ? » Le jeu se complexifie lorsque Vian introduit dans la langue supposée « littéraire » des termes puisés dans les vocabulaires techniques, qui rappellent l’ingénieur qu’il était par sa formation (« Il se produit […] un système d’ondes statiques présentant, comme en acoustique, des nœuds et des ventres, ce qui ne contribue pas peu à créer l’atmosphère dans la salle de danse ») ; le dévergondage linguistique se trouve alors lesté par une caution scientifique qui lui donne un sérieux paradoxal.
Si elle semble découvrir les mots avec la fraîcheur d’un regard premier qui se joue des codes, cette naïveté simulée se retourne en agressivité corrosive lorsqu’il s’agit d’épingler telle ou telle institution établie. Jean-Paul Sartre (devenu Jean-Sol Partre), accompagné de la duchesse de Bauvouard, en fait constamment les frais, avec une insistance répétitive qui traduit certainement, a contrario, une fascination refoulée pour le grand penseur de l’époque (lors d’une conférence donnée par Partre, « nombreux étaient les cas d’évanouissement dus à l’exaltation intra-utérine qui s’emparait particulièrement du public féminin » ; à la fin, l’orateur se lève et présente « au public des échantillons de vomi empaillé »). Vian n’a cessé de satisfaire ce goût pour les affabulations les plus drolatiques, rocambolesques ou scabreuses, comme lorsque, dans une de ses chroniques, il affirme avoir rencontré à New York André Breton déguisé en noir : « mais quel camouflage !... Il s’est passé au Noir ; on dirait absolument un vrai nègre ».
L’une des lois du jeu avec le langage - indépendamment de son fonctionnement comique – est d’être bref. Il requiert une rapidité efficace du même ordre que la brièveté séquentielle de l’écriture romanesque de Vian, qui répugne toujours - manque de temps, et manque de goût - aux grandes constructions romanesques. Vian solde ainsi avec d’autres l’histoire du roman construite depuis Balzac pour en faire, comme Perec, un champ d’expérimentation de l’écriture narrative. Les intrigues sont donc linéaires, développant une idée initiale qui ne tarde pas à apparaître au lecteur, et se déploie en épisodes successifs et juxtaposés. Vian écrit à la manière des plans-séquences du cinéma, les chapitres constituant à eux seuls des unités de sens - raison pour laquelle ils sont assez sommairement juxtaposés, et varient parfois considérablement de longueur. On pourrait même imaginer que la pratique du jazz, faisant entendre des interventions juxtaposées d’instruments solistes, est un modèle sous-jacent de cette écriture ; tout s’y joue dans l’intensité de l’instant, plus que dans la courbe d’ensemble de l’œuvre. Les nouvelles (dont beaucoup ne dépassent pas trois pages), les ébauches et scénarios d’œuvres que rassemble cette édition montrent d’ailleurs bien ce goût de la brièveté et de la composition séquentielle, au détriment de la construction globale des récits ou des profils psychologiques des personnages.
A redécouvrir ces textes, qui ne datent que de quelques décennies, on se dit qu’un tel auteur trouverait difficilement sa place aujourd’hui. Raconter sa vie ou régler ses comptes avec sa famille en prenant à témoin ses lecteurs ? Très peu pour Vian. Éclairer l’histoire contemporaine dans des fresques hautes en couleur n’aurait pas non plus été son fort. Il se défiait de la littérature dite « engagée » que saluait son époque. Dans un texte paru dans « Point de vue » en 1947, « Je ne suis pas un assassin », il répondait au procès qu’on lui faisait après la publication de J’irai cracher sur vos tombes, ouvrage qu’on avait retrouvé sur le lieu d’un féminicide. Jouant d’abord de sa double identité (« Je suis le premier désolé de ne pas être Sullivan »), il posait ensuite la question de la responsabilité d’un écrivain : « un auteur est le type même de l’irresponsable », contrairement aux prétentions d’Aragon et Gide, entre autres qui, faisant état de « désordres moraux ou psychologiques », exhibent leur « petit remue-ménage intime ». Et Vian d’ajouter : « Tout ceci relève d’une seule cause, le narcissisme de l’écrivain. »
Ce désintérêt ostensible pour l’« engagement » procède chez Vian d’une lucidité sans concession sur la gratuité essentielle de l’acte créateur. Il appartient à l’univers du jeu, dans toutes les acceptions du terme : créer, c’est prendre plaisir à faire jouer entre eux les différents emboîtements du réel, sans imaginer par là même délivrer une leçon de sagesse ou de vérité sur le monde. Rien de romantique dans cette appréhension de l’œuvre. Elle est historiquement et esthétiquement proche de Georges Perec, lui aussi expérimentateur des possibles narratifs. Vian écrit donc apparemment sans conséquence. Appartenant au Collège de 'Pataphysique, il aurait certainement participé à l’oulipo, Ouvroir de Littérature Potentielle, s’il n’était pas mort un an avant sa création. Les modalités narratives, qui ne sauraient certes être dissociées par le lecteur d’une « vision du monde », sont d’abord perçues par l’écrivain comme des combinatoires agencées à l’intérieur du vaste puzzle de la langue. Les fantaisies multiples, facéties et gaudrioles que s’autorise Vian s’inscrivent dans cette logique : elles délivrent le texte de toute responsabilité envers le réel objectif, et affirment sa liberté plénière. Vian peut ainsi, dans ses chroniques et articles, faire d’Aragon le « pseudonyme (de) l’évêque de Béziers », ou évoquer « la production et la répartition de fesses sur papier à rotative-que-veux-tu » de l’armée américaine, ou imaginer une statue de Jean-Paul Sartre (donné comme l’auteur de La Lettre et le Néon dans L’Écume des jours) représenté par « un adolescent assis sur un gros bloc de néant ». Il faut y voir l’exubérance d’une joie de vivre qui se sait fugace, et affecte de ne pas se prendre au sérieux. Comme l’affirme l’Introduction de cette édition, elle inscrit Vian dans une généalogie qui remonte à Rabelais, passe par Swift, Lewis Carroll et Alfred Jarry. Elle met aussi en valeur, par contraste, l’image si tendre et pathétique des amours de Colin et Chloé qui en constitue à contrario la toile de fond invisible : « Chloé reposait, très claire, sur le beau lit de leurs noces. Elle avait les yeux ouverts mais respirait mal. […] Colin ne savait pas, il courait, il avait peur. »
Daniel Bergez
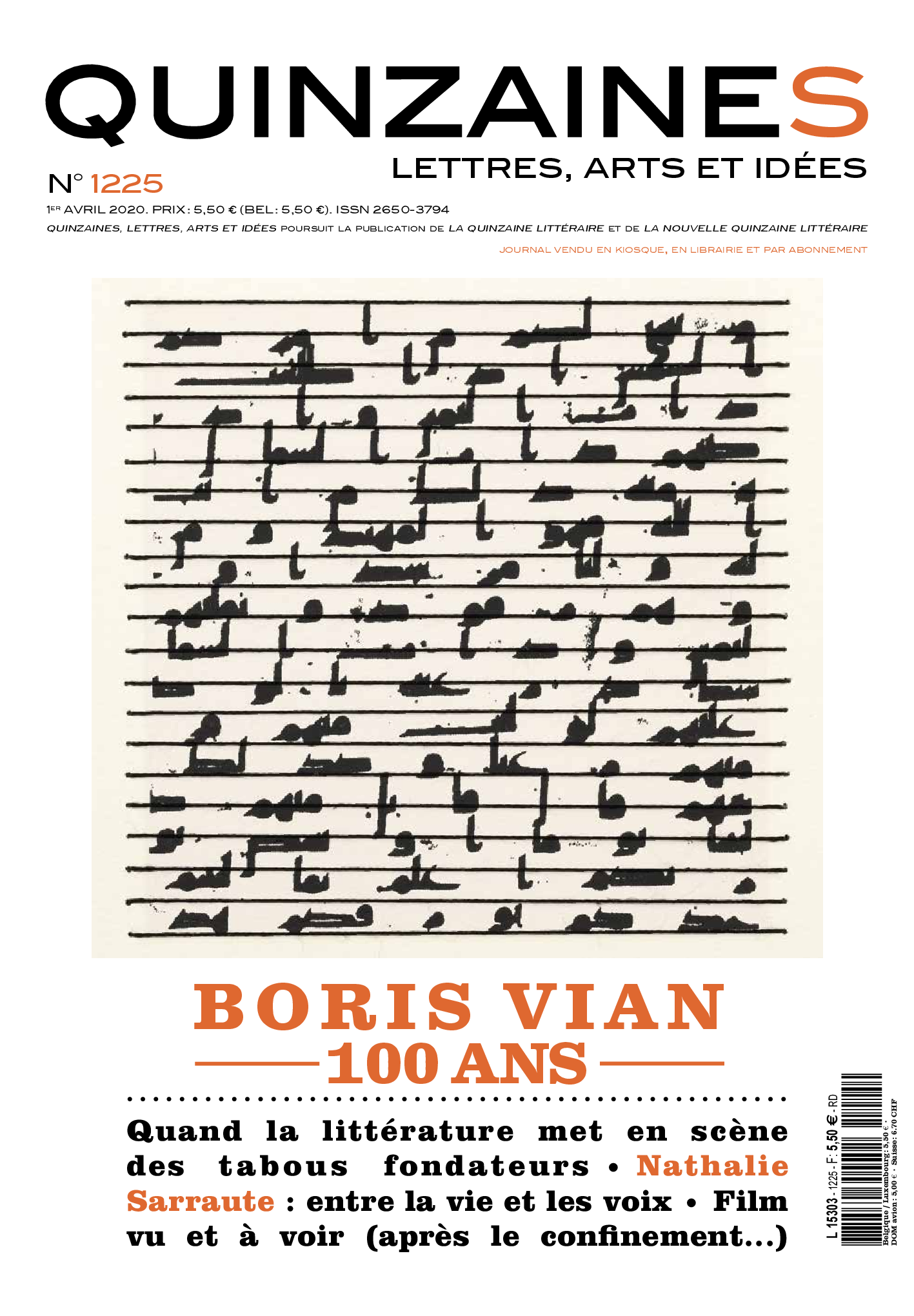

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)