Éric Dussert : Vous êtes un écrivain que l’on dirait aujourd’hui « métalittéraire ». Fictionnant tout en interrogeant la forme littéraire et ses enjeux, vous avez, avec le temps, proposé une interrogation de plus en plus intime de l’auteur et de ses rapports au lecteur, ce fastidieux raseur... Vos chroniques d’isolement vous ont-elles rendu à une salutaire solitude[1] ?
Éric Chevillard : Les lecteurs ne sont pas de tels raseurs avec moi ! Ils m’épargnent même si bien que la plupart d’entre eux poussent la complaisance jusqu’à ne pas me lire du tout. Je trouve cette sollicitude vaguement excessive. Mais émouvante aussi, bien sûr ; comment ne pas être sensible à tant de prévenance ? La chronique du confinement fut imaginée comme un rapport d’expérience quotidien de l’isolement au moment où, paradoxalement, celui-ci se trouvait partagé par tous… Mais il me semble que cette relation entre le particulier et l’universel, entre la singularité et la banalité, est toujours en jeu dans l’écriture. L’écrivain travaille cette collection de clichés en quoi consiste toute existence humaine. À défaut de savoir ou de pouvoir changer la vie, il reformule au moins à sa manière le texte du rôle.
E. D. : Qu’est-ce qui vous satisfait le plus en tant qu’homme et qu’écrivain : la solitude ou l'indépendance ?
E. C. : L’indépendance est souhaitée par tous, je crois. J’ai la chance d’échapper à l’enfer du travail organisé, hiérarchisé, d’exercer une activité qui ne se nourrit pas que d’énergies positives, comme on dit aujourd’hui, mais qui fait feu de tout bois, y compris le bois vermoulu et la planche pourrie. Activité qui se trouve parfois même mieux servie par les gestes malencontreux de la paresse, de la fatigue ou du sabotage que par ceux de l’enthousiasme ou de l’effort, qui fait des ressorts avec ses frisettes, et même, pourquoi pas, se revigore s’il le faut dans le chagrin, le découragement, l’angoisse, l’ennui…
E. D. : Vous me disiez, lorsque nous envisagions cet entretien, que la littérature vous tombait parfois des mains. Trop de littérature tue la littérature ?
E. C. : À certains moments, je peux avoir cette impression d’avoir lu tous les livres. Qu’il ne va plus rien m’arriver de fort de ce côté-là. C’est évidemment aussi faux que sot, et la littérature reste la grande affaire de ma vie. Mais, assez tard dans la sienne, Gide confiait que même un nouveau Lautréamont, dont il saurait voir objectivement l’originalité et la puissance, ne trouverait plus en lui, vieux lecteur endurci, assez d’innocence et d’ardeur pour produire vraiment son effet. Et donc, quand en plus il s’agit d’écrire soi-même…
E. D. : La constante activité d’écrire use-t-elle ?
E. C. : Quelque chose s’émousse et, ce faisant, s’affûte aussi. La vieille dent est plus tranchante que la dent de lait, parce qu’elle est devenue à force d’usure fine comme une lame. J’ai certainement moins de foi en la littérature et en ses pouvoirs qu’il y a trente ans. Mais la conscience de la vanité du geste donne aussi une liberté nouvelle. Par exemple, je me suis toujours un peu forcé à donner une forme romanesque à mes travaux d’écriture ; ce souci me quitte. Bien sûr, la question économique devient plus tenaillante encore pour un écrivain dès qu’il s’éloigne de la fiction. Je vais donc devoir la jouer fine… Mais le fragment est de plus en plus la forme que je privilégie, notamment avec l’entreprise quotidienne de L’Autofictif, mais aussi dans la composition de mes récits. Est-ce aussi parce que mon souffle est devenu plus court ? Je ne peux l’affirmer, car j’ai toujours eu cette tentation et cette pratique. Mais il est vrai que la perspective de m’atteler à un roman, j’en parlais hier encore avec un autre âne, a ces temps-ci aussi peu d’attraits pour moi que, pour Jerome K. Jerome, celle de « ramer un frêle esquif contre un fort courant ».
E. D. : Puisque vous évoquez Jerome, je pense au chien qui accompagne ses Trois Hommes sur un bateau et en profite pour relever que vous avez laissé les animaux envahir votre œuvre, comme autrefois Francis de Miomandre, La Fontaine ou Louis Pergaud. Comment justifiez-vous cette zoophilie débridée ?
E. C. : La littérature est un ouvrage d’homme adressé à ses semblables. C’est du sumo, on tourne vite en rond. Pour ma part, j’aimerais bien savoir ce qu’une fourmi, une outarde ou un orang-outan pensent de ce que j’écris. Est-ce que ça leur parle ? Est-ce que nos histoires se rejoignent ? Est-ce que nous partageons des sensations, des aperceptions, des expériences ? La pluie, la lune, le lilas, avons-nous la même notion de ces choses ? Et le réchauffement climatique ? Après tout, nous sommes contemporains. Nous vivons sous le même ciel. Je connais les opinions de Léa et celles de Léo, je n’ai pas besoin de les interroger… mais les points de vue du roitelet, de la carpe ou du guépard, ceux-là, je les ignore. J’aimerais tant lire leurs livres ! Puis il y a les noms des animaux qui sont les mots les plus beaux de la langue, les plumes chatoyantes, les ombres ocellées de notre lexique. La menace qui pèse sur la biodiversité recoupe étrangement nos craintes relatives à l’avenir de la littérature. La novlangue contemporaine n’est-elle pas la conséquence de la destruction de l’habitat naturel des écrivains ?
E. D. : Celui que l’on peut nommer votre Tartarin, Oreille rouge, cherchait à voir en Afrique les hippopotames. Quel aura été l’hippopotame du confinement ?
E. C. : Oreille rouge s’attend à voir des hippopotames au Mali (le nom du pays signifie d’ailleurs hippopotame en langue bambara), mais son attente est déçue, et vaine sa quête. J’aime votre question, parce que nous avons pu penser, en effet, que le confinement allait nous permettre de voir ou de vivre des choses nouvelles ; il allait y avoir des révélations, des apparitions, des épiphanies… Il s’agissait de découvrir l’hippopotame caché entre nos quatre murs. Peut-être le trouverions-nous en nous ? Peut-être même, grâce suprême, allions-nous devenir nous-même cet hippopotame… ou, au moins, une araignée domestique. À l’arrivée, il aura été noté une augmentation significative des violences conjugales et de la maltraitance envers les enfants. Très peu d’écrivains majeurs ont émergé dans ce contexte, un très petit nombre de plasticiens essentiels, quasiment pas de compositeurs importants… Chacun s’est enlisé plus profondément dans son ornière. La preuve en est que le deuxième confinement n’a pas eu du tout le même succès. Nous n’avons pas constaté du tout le même enthousiasme, la même assiduité. Bref, nous avons renoncé à l’hippopotame. Moi-même, j’ai complètement disparu du fleuve Niger.
E. D. : Dans vos chroniques de cette curieuse époque, vous constatez ce qui se déploie lorsque « tous les esprits carburent autour des mêmes questions. » L’art littéraire n’est-il pas garant de la variété, de l’inattendu, de l’air frais ?
E. C. : Si, si, ou sinon, s’il s’agit encore d’une illusion, je ne veux pas renoncer à celle-là. Et c’est pourquoi je m’acharne et je persévère. L’art demeure malgré tout la seule alternative à la triste réalité. Pas toujours si triste, d’ailleurs, soyons honnête ; la réalité propose des voluptés que la page ou la toile blanche nous refusent, alors que le drap, souvent beaucoup moins net, nous y invite… Mais alors, disons que dans le temps long du post-coïtum, s’il n’y avait pas l’art (et la rigolade, peut-être aussi, comme disait Queneau), nous serions bien dépourvus de moyens, bien désarmés. Je vois à cela qu’il me reste malgré tout un peu de jeunesse, et donc aussi un peu de candeur.
E. D. : Vous sentiriez-vous à l’aise en compagnie du jeune Gide de Paludes, de Jean de La Ville de Mirmont, de Jules Renard, ces ironistes perplexes, qui, revenus d’un siècle de littérature conquérante et pleine de tumultes, contenaient leurs ardeurs, par effet de contraste, avec des composés textuels plus ramassés mais aussi plus subtils, voire délicats ?
E. C. : Honte sur moi, je ne connais pas Mirmont, mais, oui, j’ai beaucoup lu Gide et Jules Renard… Mais – pardon pour cet aparté – avez-vous remarqué que le nom de Gide suffit, alors que Renard seul, non, il faut ajouter Jules ? Est-ce parce que l’animal lui fait une trop rude concurrence ? Pourtant, les Jules étaient peut-être plus nombreux encore que les renards, à son époque… Ne disait-il pas lui-même : « Chaque fois que, dans un journal, le mot Jules n’est pas suivi du mot Renard, j’ai du chagrin » ? Et donc, en effet, je les ai lus, le Journal de Jules, et plusieurs fois Paludes, aussi. Si bien que je devrais vous donner raison. Pourtant, ces lectures sont désormais si anciennes que je ne fonde plus rien dessus. J’aime ces livres abstraitement, avec nostalgie, comme la vieille maison aujourd’hui vendue de mes grands-parents… Je crois que la question des influences, et même celle des affinités ou des connivences, est aujourd’hui derrière moi. J’essaie désormais de survivre avec mes maigres moyens… Votre formule pourtant me convient assez, « ironiste perplexe ». Je me laisse facilement attendrir, par les enfants, par les visages, par le courage qu’il faut à chacun malgré tout pour conduire sa vie jusqu’au bout. Mais je suis certainement un sceptique. Mon professeur de philosophie me disait autrefois en me restituant mes dissertations : « C’est bien, c’est même peut-être très bien, mais on dirait que vous n’y croyez pas… » Il m’avait percé à jour ! Je n’y crois pas. Au sens, à l’intérêt, à la réalité de tout ça. J’écris pour creuser ce doute, je rencontre parfois le néant, parfois le mystère.
E. D. : Dans Monotobio, rebondissant récit des causes et des conséquences d’une existence, vous envisagez les petits faits vrais comme un long chapelet de circonstances obéissant à une « logique terriblement simpliste ». La prochaine question de cet entretien serait-elle prévue depuis des temps immémoriaux ?
E. C. : Mon récit est aussi une charge ironique contre le genre biographique ou autobiographique, où toute chronologie devient une narration romanesque semblant obéir à la nécessité. Comme si toute existence était un destin impérieux et que rien n’arrivait au hasard. Dans Monotobio, l’absurdité des enchaînements prouve au contraire que, comme le disait le grand Arno Schmidt, « la vie n’est pas un continuum. » Je fais le Jacques, dans ce livre, et même le Jacques le Fataliste. Mais j’ai toujours été intrigué par le train des causes et des effets, par le fait que chaque événement est à l’origine d’imprévisibles situations. Tout est à la fois principe et conséquence. Mon livre obéit à cette logique paradoxale, surréaliste. Tout est lié et rien n’a vraiment de sens, sinon rétrospectivement. Aussi bien, est-ce la liberté même, toutes les histoires peuvent trouver place entre deux faits, deux objets réunis par la coïncidence. C’est pourquoi vous allez inéluctablement me demander maintenant de quelle manière la disparition affligeante de la belle antilope nommée hippotrague bleu en Afrique du Sud, au XVIIIe siècle, a conduit tant de médiocres écrivains français contemporains à décerner les grands prix littéraires d’automne. Et je vous répondrai éloquemment en versant des larmes d’authentique crocodile.
E. D. : Si le territoire de l’écrivain, la langue, devient impraticable, si les conditions de la vie sociale se complexifient – ou se simplifient à outrance, au risque du totalitarisme – quelle autre voie que l’ironie reste-t-il ? Et l’ironie même peut-elle être encore comprise ?
E. C. : Il est vrai que l’ironie ou l’antiphrase permettent encore, par exemple, de contourner la censure morale qui dispose partout ces temps-ci, sur la page de l’écrivain, ses petites balises de slalom. Il est possible que reviennent des formes littéraires un peu oubliées, comme la fable, la satire ou la sotie, où l’ironie est maîtresse. L’ennui, c’est alors que la simplicité, la limpidité, la littéralité sont confisquées par les ingénus et les sots, qui semblent de ce fait parler comme les arbres et les oiseaux et être près des choses et des hommes. Celui qui raffine et élabore ses constructions sophistiquées passera en comparaison pour un cynique ou un précieux. L’ironiste selon mon goût doit parfois cesser de l’être, sans que personne ne devine exactement à quel moment de sa phrase il est redevenu l’écorché vif le plus sincère.
E. D. : Vous écriviez naguère « Écrire pour lui : faire main basse ». En est-on arrivé au point où l’enjeu d’écrire serait désormais pour un écrivain de « réparer » ou d'« alerter », ou bien encore « soulager » ?
E. C. : Il est vrai que ce sont des missions que certains se donnent aujourd’hui. Cet étalage de bons sentiments partout et en tout lieu est d’autant plus pénible qu’il n’empêche en rien l’époque d’être d’une brutalité extrême. Ce qui m’énerve le plus, c’est la prétention affichée de parler au nom de tous ou à la place des autres. Je dois manquer de générosité sans doute, mais les seuls artistes qui m’intéressent sont ceux dont la singularité irréductible (qui ne va pas sans une forme d’arrogance et de volonté de puissance parfois peu aimables) ouvre des espaces nouveaux de spéculation poétique, propose tout un vocabulaire inédit pour renommer ce monde (ce qui, soit dit en passant, relève paradoxalement aussi d’une forme de soin, de réparation, d’antidote à l’usure et à l’ennui.)
E. D. : Éric Chevillard, croyez-vous à « la crise » ?
E. C. : Pour y croire vraiment, il me faudrait croire aussi en l’harmonie, en une harmonie perdue ou à venir. La vie est un état de crise (la mort rôde) et le monde, un état provisoire du chaos. Il semble toutefois que l’ingéniosité humaine, qui a toujours su organiser le sauvetage en même temps que le naufrage, soit aujourd’hui un peu à court d’idées et de plans pour ses prochaines chaloupes. Les remèdes proposés sont souvent aussi effrayants que les maux, et l’on peut se demander si le pompier pyromane ne va finalement périr noyé sous la montée des eaux, jaillissant de sa lance à incendie...
Bibliographie sélective :
Monotobio (Minuit, 2020, 169 pages, 17 €)
Prosper à l'oeuvre (Noir sur blanc, 2019, 112 pages, 15 €)
L'Autofictif incendie Notre-Dame. Journal, 2018-2019 (L'Arbre vengeur, 2020, 232 pages, 15 €)
Feuilleton. Chroniques pour Le Monde des livres, 2011-2017 (La Baconnière, 2018, 319 pages, 19 €)
En poche :
Ronce-rose (Minuit, "Double" (poche), 132 pages, 8 €
[1] Du 18 mars au 7 avril 2020, Éric Chevillard a tenu pour Le Monde une chronique des trois premières semaines de confinement, en France, dû à la pandémie de Covid-19.
Eric Dussert
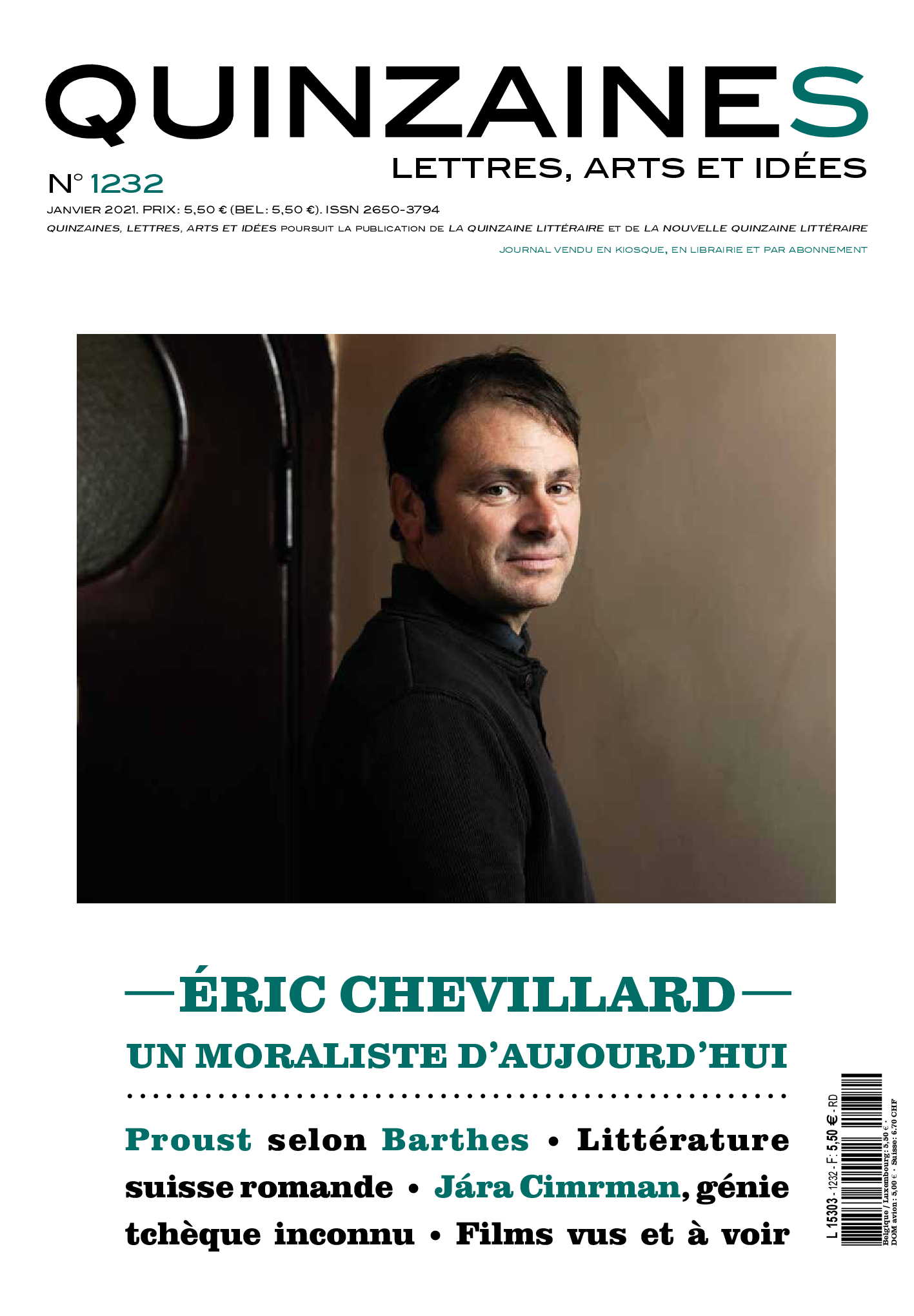

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)