De ses deux maîtres, Stillman retient ici la densité de la forme brève, cette fameuse « petite forme » qui est illustrée selon Gilles Deleuze par la comédie cinématographique depuis Charlie Chaplin et Ernst Lubitsch. Il s’agit, brillamment, nerveusement, de dresser un portrait de femme en un conte moral d’autant plus savoureux que le personnage principal, Lady Susan (c’est le nom de la novella de Jane Austen) est une vraie garce. La romancière anglaise, dont le cinéaste est un fin connaisseur, se révèle bien plus drôle et caustique que pourrait le laisser croire sa réputation d’écrivain sentimental, engoncé dans les rites et manières d’une société britannique où l’amour finira par triompher en dépit des obstacles en apparence insurmontables semés sur la route d’une jeune femme à marier.
Jane Austen renoue dans Lady Susan avec le personnage si passionnant, si érotique, de la jeune veuve qui fut mis à l’honneur par le roman des XVIIIe et XIXe siècles. Si elle est belle, et tel est le cas, elle peut en théorie tout se permettre car elle est libre devant Dieu et devant les hommes : la jeune veuve, parce qu’elle est jeune (et encore belle) et parce qu’elle est veuve (et presque toujours déjà mère), représente de fait l’idéal féminin de l’affranchissement. La Fontaine ne s’y est pas trompé : « La perte d’un époux ne va point sans soupirs, / On fait beaucoup de bruit, et puis on se console » ; ainsi commence la fable (« La jeune veuve », évidemment) qui vante si bien les « mille attraits » de « la veuve d’une journée ». Lady Susan brille sans conteste de tous ses feux et a bien l’intention de goûter enfin à une existence dispensatrice de joies sans nombre, à commencer par sa relation amoureuse avec le beau Manwaring. Susan veuve Vernon défraie la chronique, n’a pas été une bonne épouse, n’est définitivement pas une bonne mère et se doit avant tout de trouver une solution pour bien vivre : la veuve est jeune, mais pas riche ; sa fille Frederica est en âge d’épouser un bon parti, superflu plus que nécessaire, et elle-même ferait bien de redorer son blason.
Telle est la situation au début du film : Whit Stillman la fait comprendre et sentir avec brio, n’hésitant pas à recourir à d’artificieuses inscriptions à même l’écran afin de présenter personnages et lieux de l’action. Le cinéaste met en marche un train électrique qui file à toute vitesse : l’action débute par le départ précipité de Susan et Frederica qui doivent quitter Longford, la demeure des Manwaring, où quelque manigance extra-conjugale a dû être découverte. Après s’être débarrassée de sa fille dans une école, Susan trouve refuge à Churchill, chez son beau-frère Vernon, marié à la douce Catherine, beaucoup plus conforme à ce que nous connaissons des héroïnes de Jane Austen. La comédie « de tête » commence alors à Churchill, dans ce lieu qui respire la bienveillance et – selon Susan – l’ennui le plus profond. L’héroïne va d’abord s’attacher à se refaire une réputation : elle trouve une oreille accueillante auprès du frère de Catherine, Reginald DeCourcy, beau jeune homme innocent qui sera prestement retourné par l’intrigante. Ces manœuvres ne trompent pas le reste de la famille ; elles sont surtout parfaitement claires pour le spectateur.
Whitman retrouve ainsi la leçon des contes et comédies d’Éric Rohmer : l’âme, mauvaise en l’occurrence, est lisible à l’œil nu. Susan a un plan, comme l’héroïne d’Un beau mariage, et aucun des secrets de son entreprise, contournement d’obstacles, révélations, hypocrisies, mensonges, défaillances de l’instinct maternel, ne nous sera épargné. Le jeu de Kate Beckinsale se prête parfaitement à la plasticité d’un personnage tendu, comme les autres personnages plus vertueux de Jane Austen, vers la réalisation de son projet. Le fait est que l’actrice rend cette garce décidément très sympathique quand on la compare aux piètres vertueux qui l’entourent. C’est bien le paradoxe du portrait moral : son enjeu est la vérité d’un être, laquelle importe plus que la moralité. Whit Stillman retrouve en ces matières le meilleur Woody Allen, capable de rendre hommage à la vertu (Alice) ou à la quête de soi (Another Woman), mais aussi de suivre ses assassins dans les méandres de leur faute et de leurs conséquences (Crimes et délits, Match Point) en laissant le jugement moral à la discrétion de chacun de ses spectateurs.
Personne n’ose vraiment contredire Lady Susan dans ses jugements à l’emporte-pièce ou ses parallèles bibliques risqués ; son autorité, liée à son rang, et son inflexible volonté ne souffrent pas l’adversité. Elle a cependant une amie véritable, une Américaine (interprétée par Chloë Sevigny) que son mari menace, à chaque incartade, de renvoyer dans son Connecticut natal. Il lui est notamment interdit de fréquenter une Susan toujours précédée par son exécrable réputation. Leurs rendez-vous clandestins ménagent d’utiles respirations où transparaît le pouvoir souverain des femmes mûres à travers des dialogues délibérément redondants – Susan raconte souvent à Alicia des péripéties que nous connaissons – mais qui préparent l’étape suivante du plan. Les allusions à l’histoire récente de l’indépendance américaine (l’action se situe en 1790) ne servent pas seulement à faire sourire : si Susan juge ingrate l’attitude des Américains à l’égard de la Couronne, elle est certes approuvée par une Alicia qui ne se voit pas vivre hors de Londres, mais l’ingratitude envers la Mère Patrie est instantanément reliée à celle de sa propre fille, qui paraît prendre un malin plaisir à refuser le brillant parti proposé. Il s’agit en l’occurrence de Sir James Martin, personnage comique de haut vol, un parfait idiot, mais non dénué de charme. Tom Bennett crève l’écran dans ce rôle : pour me faire pardonner l’usage de cette expression, j’ajouterai que l’on ne peut comparer la sensation produite par Bennett qu’à celle de Christoph Waltz dans Inglourious Basterds ; vous voilà prévenus. Chacune de ses apparitions est une bénédiction et, comme il y a toujours des scènes de danses dans les films de Whit Stillman, je recommande la séquence dansée très compassée où son enthousiasme fait l’effet d’un coup de pistolet dans un concert ; cet homme n’est pas un acteur, c’est de la dynamite !
Je laisse au spectateur le soin de découvrir la résolution à la fois attendue et bizarre – « quirky » en anglais – de l’intrigue : disons simplement que l’on se rapproche des Affinités électives, mais sous euphorisant, que Jane Austen est tirée non seulement du côté d’Oscar Wilde pour la cruauté mais aussi d’Edith Wharton pour le féminisme.
Il me faut maintenant revenir sur le cas Whit Stillman. Fils d’un homme politique proche de John F. Kennedy, il a tout de l’aristocrate américain éduqué en preppy school et à Harvard. Véritable autodidacte du cinéma et grand cinéphile devant l’éternel, il a réalisé son premier film en vendant son appartement et en demandant argent et locations à sa famille et ses amis. Le résultat a pour titre Metropolitan (1990) et se trouve être très en avance en son temps, annonçant à la fois le mumblecore, Wes Anderson, Sofia Coppola et Noah Bumbach. Parce qu’il sait de quoi il parle, à mi-chemin de Scott Fitzgerald (qui désirait tant comprendre les codes de la haute société) et de J. D. Salinger (qui joua si bien de ces codes qu’il connaissait par cœur), Stillman décrit un outsider dans une coterie newyorkaise, le Sally Fowler Rat Pack : soirées, bals, filles sensibles, coincées, pimbêches et arrogantes, garçons à l’avenant, fin inouïe dans les Hamptons, gueule de bois d’un petit matin qui dure.
Cinéaste « littéraire », si l’on y tient, en tout cas aussi grand scénariste que fier metteur en scène, Whit Stillman sait qu’il a choisi la porte étroite, surtout il y a un quart de siècle, à un moment où personne n’attendait ce genre de films dans le milieu du cinéma. La faveur du public et de la critique lui permit de tirer deux autres salves, deux histoires d’amitié : Barcelona (1994), trop méconnu, où deux Américains se demandent pourquoi ils aiment des Espagnoles (avec une scène d’anthologie, un bal costumé disco…) ; et surtout Les Derniers Jours du disco (1998) – où deux filles, l’une éclatante, l’autre plus réservée (Kate Beckinsale et Chloë Sevigny, eh oui), communient dans la passion du disco dancing. L’époque évoquée est celle du début des années 1980, à la grande époque du Studio 54 (le Club dans le film), mais avec un regard par la lunette arrière sur un temps qui ne reviendra pas. Stillman a donné récemment une version littéraire du film, les belles éditions Tristram en ont publié une traduction en 2014 et le livre fut couronné en France du prix Fitzgerald, ce qui prouve qu’il ne faut désespérer de rien.
Et pourtant. À partir de 1998 commença pour Whit Stillman une traversée du désert dont Paris fut le chef-lieu. Il renouait sans doute par là avec le destin d’un de ses cinéastes de chevet, l’immense Preston Sturges, qui erra une bonne partie des années cinquante dans les bars des Champs-Élysées alors qu’il avait été le roi de la comédie hollywoodienne des années 1940. J’ai rencontré Whit Stillman à la fin du mois de mai et, la vie est étrange, nous avions l’impression de nous connaître, mais chacun reliait ce (faux) souvenir à ses obsessions, bien entendu partagées par l’autre : « We have met. In a disco ? », me dit-il. Or, mes grandes années du Palace remontent à la période évoquée dans le film qu’il consacra au sujet. « Non, je pense plutôt à L’Écume des Pages, pour la signature de mon livre sur Preston Sturges ». Non plus, même si j’ai toujours des doutes…
Stillman évoqua avec moi ses projets, qui vont désormais prendre forme, à commencer par une série intitulée Cosmopolitan dont chaque période se déroulera dans une ville européenne différente – cela rappelle le principe de Tatort, la série criminelle allemande qui, elle aussi, se déplace de ville en ville. À propos de Love and Friendship, il insista sur son goût sincère pour l’œuvre de Jane Austen, et me montra l’exemplaire tout frais de la novélisation du film qui vient d’être publiée par Little, Brown and Company. Comme je soulignais l’importance du rôle de Chloë Savigny dans son dernier film, il attira mon attention sur ce type de rôle « à distance » qui incorpore le commentaire au corps de l’œuvre, en prenant notamment l’exemple du personnage de Lily, interprété par Analeigh Tipton dans Damsels in Distress (2011), œuvre magnifique et opaque avec laquelle le cinéaste renoue enfin avec le cinéma. À l’instar de Sauve qui peut (la vie) de Godard, il s’agit d’un authentique second premier film où Stillman retrouve l’atmosphère intrigante et confinée du petit groupe, dans une université cette fois, et avec Greta Gerwig en prime. La clique de filles veut empêcher les suicides : je vous demande un peu. Tout finit heureusement par la danse, ce que le titre, inspiré d’un musical avec Fred Astaire, pouvait laisser présager. J’espère qu’on dansera dans Cosmopolitan. Quand à Whit Stillman, il est de nouveau parisien. Je ne vous dis pas où vous pouvez le trouver, mais vous avez peut-être deviné. In a disco ?
Marc Cerisuelo
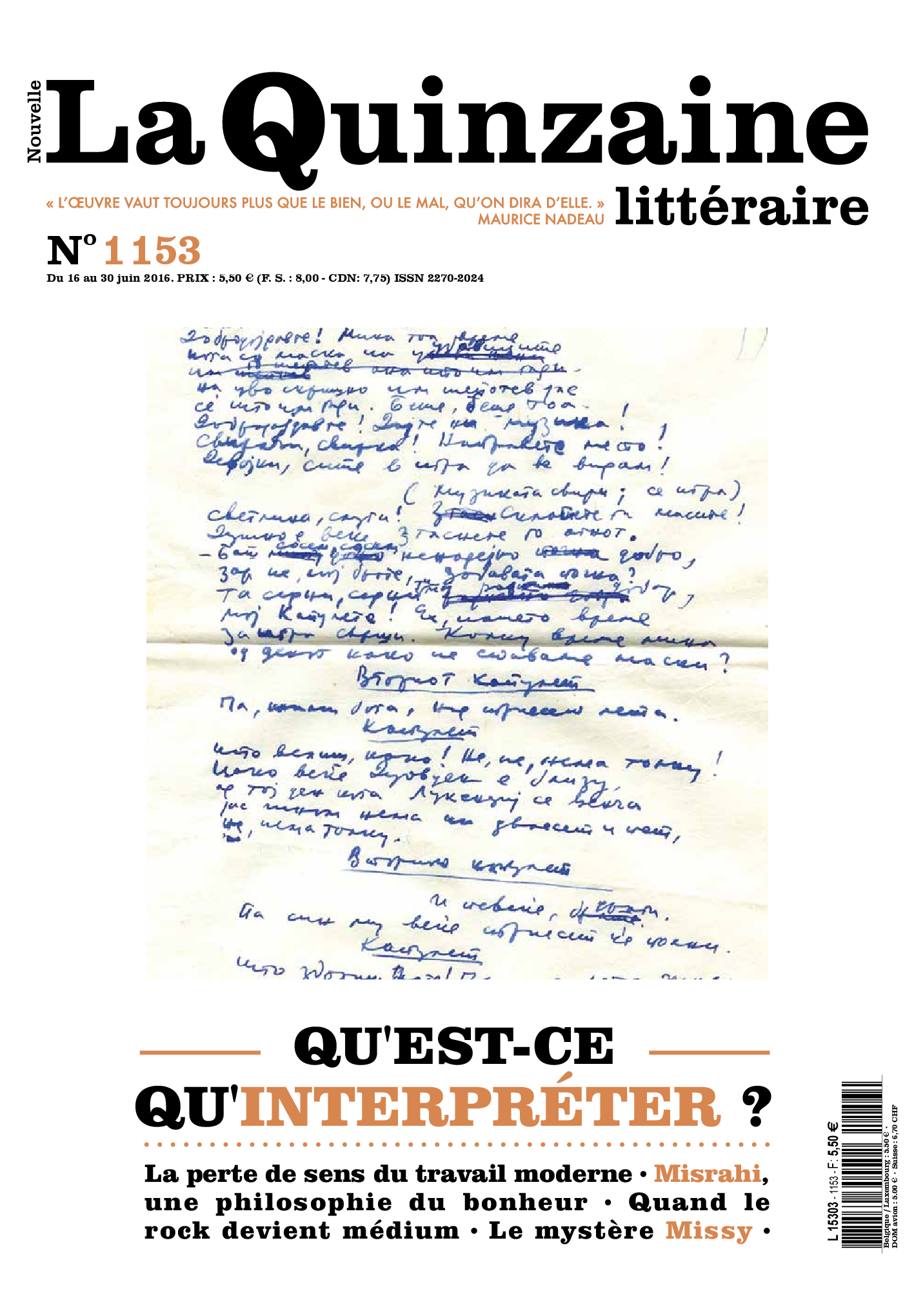

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)