La production de l’imprimé y connaît une très forte croissance. Le livre triomphe aux dépens de la communication orale. La population lisante connaît une rapide et très forte expansion. L’alphabétisation est en progrès dans les milieux urbains. Les femmes deviennent des lectrices passionnées. La possession des livres et leur lecture constituent un signe de réussite sociale. La presse périodique se développe dans l’Europe entière et diffuse une information souvent importante sur les livres parus. Ajoutons à cela le rôle des salons, des bureaux d’esprit, des cafés, où l’on commente les nouveautés de la librairie. Après la publication de La Nouvelle Héloïse de Rousseau, apparaît le phénomène des lettres de lecteurs passionnés adressées à l’auteur pour lui confier le plaisir qu’ils ont retiré de leur lecture.
Enfin, avec l’Histoire littéraire de la France des Bénédictins de Saint-Maur, dont le premier volume patronné par le Roi paraît en 1735, la littérature appartient désormais au patrimoine culturel, dont la protection devient une des légitimations du pouvoir politique. Ce n’est point par philanthropie ou par adhésion enthousiaste aux Lumières que les despotes éclairés font leur cour aux philosophes. Tout cela semble constituer un dispositif nouveau dans lequel la critique trouverait naturellement sa place. On s’éloignerait donc définitivement dans ce domaine du XVIIe siècle. À la fois des pratiques de l’Académie à ses débuts quand elle publie le Jugement de l’Académie sur le Cid, mais aussi de fragments critiques, inscrits dans des œuvres littéraires, visant d’autres fins que la critique elle-même, comme, par exemple, les Satires de Boileau.
La critique a existé aussi dans les débats que suscitent des œuvres comme L’École des femmes ou le Tartuffe de Molière. Les partisans de Corneille sont hostiles aux pièces du jeune Racine. Avec l’appui de forts en gueule, rémunérés, on prolonge au théâtre ou à l’opéra la tradition des cabales. La bohème littéraire œuvre, par ses applaudissements ou ses sifflets, au succès ou à la chute des pièces. Les gazettes s’en font l’écho. Peut-on refuser d’admettre que la censure est aussi une prise de position critique, relevant de critères qui ne doivent rien au bon goût, ni à un jugement esthétique ? Le censeur détermine si l’ouvrage qu’on lui soumet est ou non contraire aux bonnes mœurs, hostile ou non à la religion, et contraire ou non à la monarchie. Orthodoxie morale et adhésion monarchique constatées permettent sa libre diffusion.
Si la critique, au sens moderne du terme, ni même son ébauche n’existe évidemment pas au XVIIe siècle, la théorie littéraire y est remarquablement présente. Avec, bien sûr, Boileau et son Art poétique, les éditions commentées de La Poétique d’Aristote. Le débat concerne le plus souvent le théâtre, dont on définit les règles. Ainsi en est-il avec les préfaces de Corneille ou La Pratique du théâtre de l’abbé d’Aubignac de 1657. Le roman n’échappe pas non plus aux théoriciens. L’évêque érudit d’Avranches, Pierre Daniel Huet, donne en 1670, une Lettre sur l’origine des romans.
Le roman, terrain d’expérimentation littéraire
Le XVIIIe siècle n’abandonnera pas cette tradition critique. Le roman y est l’objet de débats jusque dans ses préfaces. Une des plus célèbres demeure celle que Jean-Jacques Rousseau donne à La Nouvelle Héloïse, un des plus grands succès de librairie du siècle, écrit par un philosophe fortement hostile aux romans. L’Église qui s’en prenait au XVIIe siècle surtout au théâtre, jugé indécent et corrupteur (François Garasse, Doctrine curieuse des beaux esprits de 1623), s’attaque désormais au roman. On le condamne au nom de l’Histoire, de la morale, des mœurs, de la réalité dont il détournerait ses lecteurs. Comme il n’existe pas un modèle antique qui déterminerait sa forme, le roman, malgré les critiques, devient de fait un remarquable terrain d’expérimentation littéraire.
Le théâtre remporte au XVIIIe siècle un succès jamais atteint jusque-là. Les gazettes rendent compte des pièces qui se jouent. Elles en proposent un résumé et une analyse. Cette dernière porte sur l’intrigue et la représentation. Cet ensemble constitue une forme déjà élaborée de la critique, telle qu’elle se pratique aujourd’hui encore… Sans en avoir l’amplitude, elle est à rapprocher de la critique d’art qu’invente Diderot dans les Salons. On ne compte plus les traités qui justifient le drame bourgeois.
La critique portant sur les romans ou les essais doit pourtant bien peu aux Salons ou aux chroniques théâtrales. Elle a connu une évolution qui lui appartient en propre. Condamnée à l’exil par la révocation de l’édit de Nantes, l’intelligentsia protestante maintient l’idéal humaniste de la République des Lettres, défini par Érasme, More, Vives… et continué par Claude Nicolas Peiresc (1580-1637). Elle fait de la circulation de l’information savante un devoir. D’où les contenus des périodiques publiés par Bayle, Leclerc, ou Basnage de Beauval, composés de résumés des livres parus, accompagnés d’extraits, sans en juger le contenu, leur mention même prouvant leur valeur. C’est à partir de ce modèle que se construit la critique. Elle élargit son champ d’application. Son public est désormais l’Europe cultivée. C’est elle que vise L’Année littéraire d’Élie Fréron, où il attaque les philosophes, mais en sachant reconnaître le talent, fût-il celui de ses adversaires. À cette lignée appartiennent les Observations sur quelques écrits modernes de Desfontaines et le Pour et Contre de l’abbé Prévost.
Aux cabales déjà évoquées, il faut ajouter les affrontements militants. Palissot attaqua les philosophes dans Les Originaux ou le Cercle, où Rousseau se présentait à quatre pattes en broutant une laitue. Il se moqua des Encyclopédistes et de Diderot dans les Petites lettres sur les grands philosophes, Rousseau se montra magnanime ; Diderot en appela au bras séculier. Voltaire adopta une autre position, quand en 1760, Jean acques Lefranc, de Pompignan, dans son discours de réception à l’Académie s’en prit aux philosophes accusés de menacer « le trône et l’autel ». Pour répondre, il rédigea une tirade en prose les Quand, puis en vers une suite de quatrains intitulés les Si, les Mais, les Car, les Qu’est- ce ? les Pourquoi ? les Ah ! Ah !
Il reste à évoquer Diderot. Il donna de nombreuses critiques dans la Correspondance littéraire de Grimm, paradigme des nouvelles à la main, destinée au Gotha européen (de Catherine II de Russie à Frédéric de Prusse). Diderot y publia ses Salons, Jacques le Fataliste et nombre de ses œuvres. Il y informe ses illustres lecteurs de l’actualité littéraire, fidèle au devoir déjà évoqué, à la défense des Lumières, heureux de satisfaire le goût européen pour l’esprit français. Il y rendit compte des ouvrages les plus divers, de Léonard, Chastellux, Sedaine, Malfilâtre, Voltaire, Ducis… Il n’a pas de méthode ; il se montre enthousiaste ou hostile. Il donne un abrégé (Le Code de la nature de Morelly), propose un autre point vue (Sur les femmes de Thomas), utilise un récit (Voyage autour du monde de Monsieur de Bougainville) pour exposer ses propres idées sur la morale sexuelle (Supplément au voyage de Bougainville).
Heureux écrivain, dont l’activité critique servait à nourrir l’œuvre.
Jean M. Goulemot
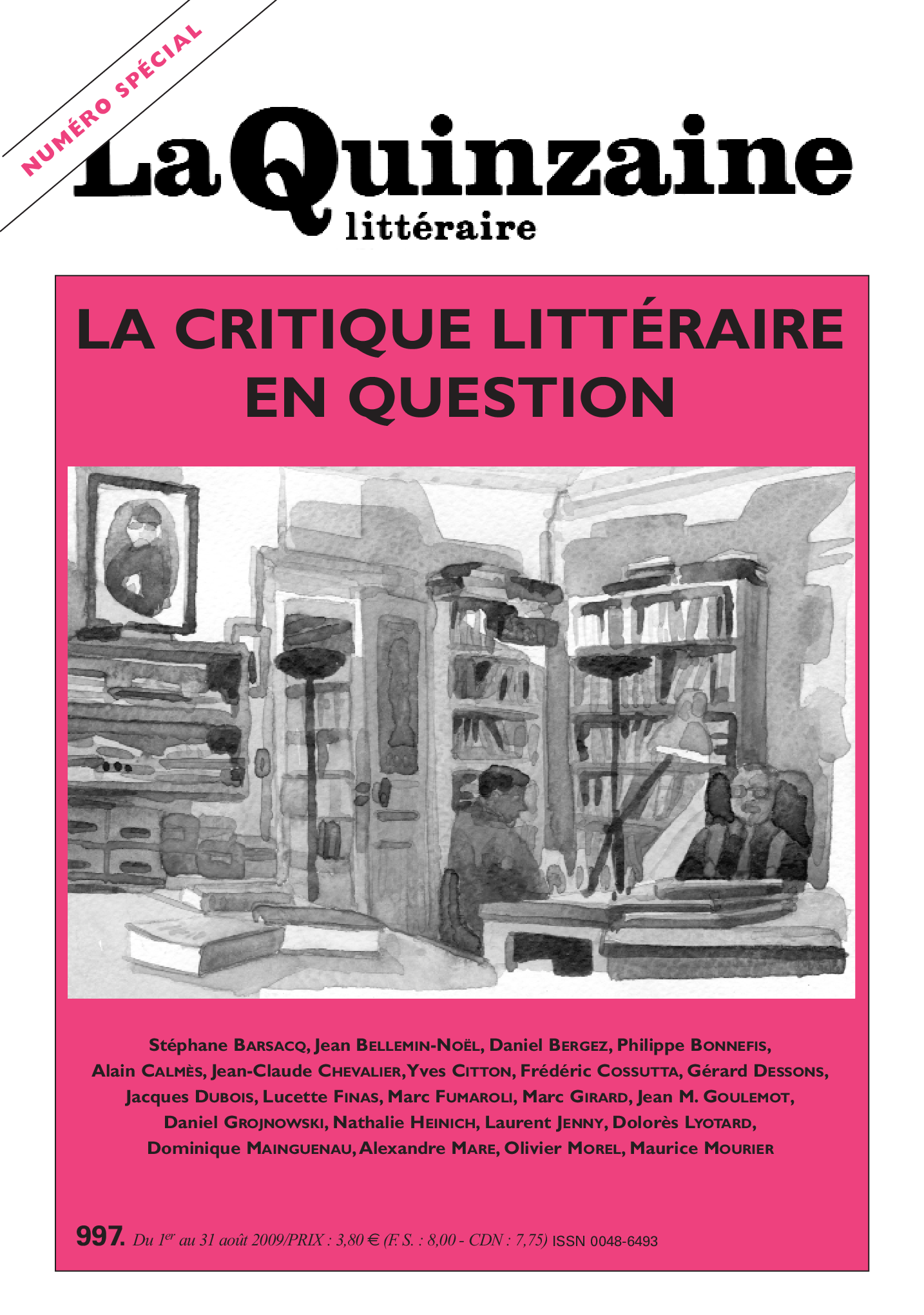

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)