Le titre du livre, S’effondrer sans, semble incomplet, sa préposition n’étant suivie d’aucun mot. De quel côté irait ce mot manquant ? Quel appui pour arrêter la chute ?
Une peinture de Daphné Bitchatch ensanglante la couverture. Sang et « sans » se rejoignent. À l’intérieur, les peintures semblent des empreintes noires sur mur rouge.
L’épigraphe est empruntée à La Déchirure de Henry Bauchau, dont la sibylle psychanalyste affirme qu’il est possible de vivre dans cette déchirure personnelle. Elle ajoute : « Ce n’est pas tant votre déchirure qui import...

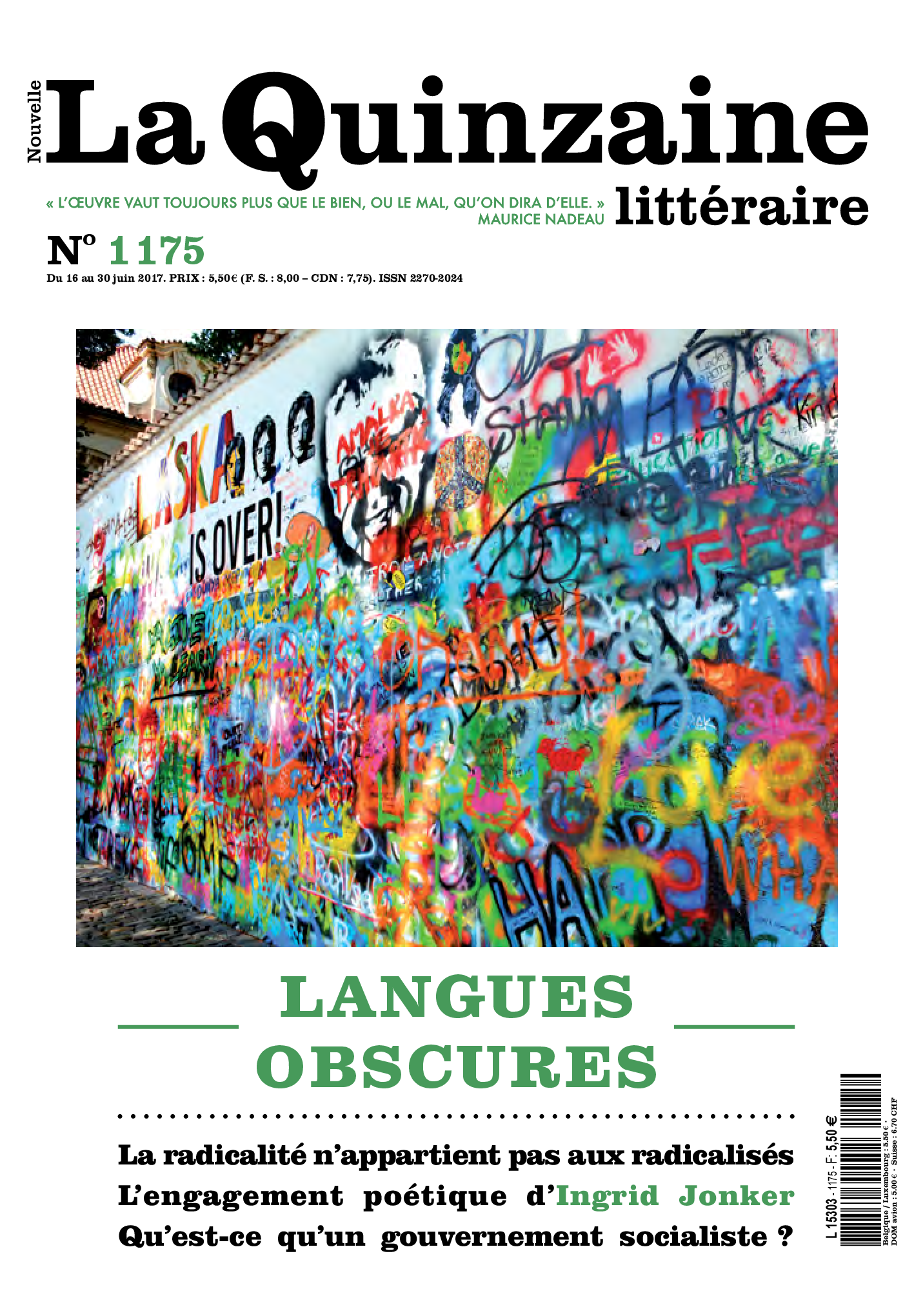

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)