Le livre assemble trois suites de poèmes composés en vers libres, mais aussi, pour certains, en vers mesurés et rimés.
Le poème du jour naissant s’ouvre sur le ciel, pas le vaste et terrible de la nuit définitive qui viendra, celui de l’« espoir ». La mesure humaine nous garde tout près de ce qui nous anime en marchant, en vivant. Deux mouvements simultanés nous occupent, révélés par le titre Prendre et perdre (presque une anagramme). Nous ne saisissons que de furtives apparitions, que la langue s’efforce (avec légèreté !) de maintenir. Cette poésie fra...

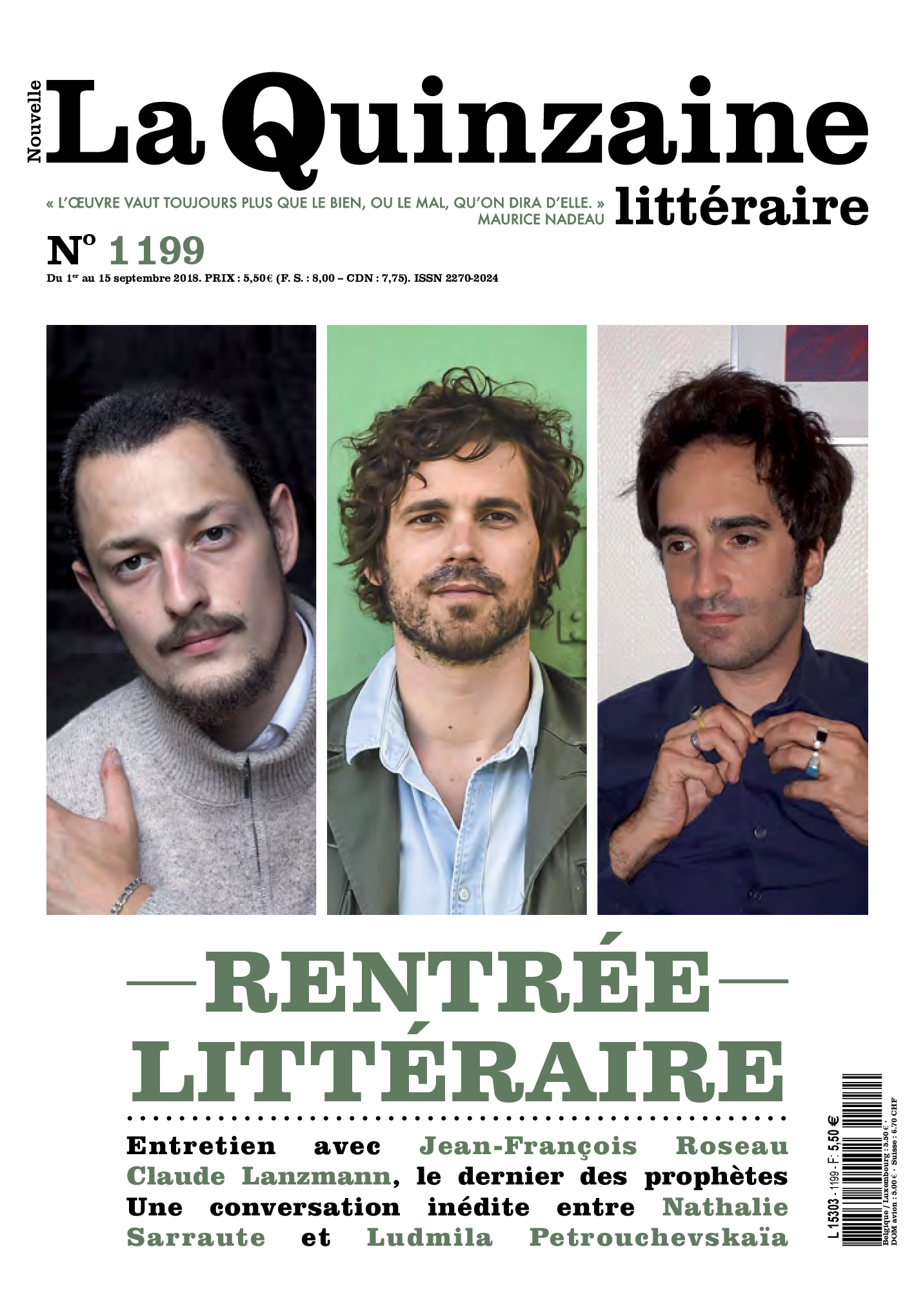

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)