Passons sur ce qu’une stupide américanisation de la langue « relevée » appelle aujourd’hui les prérequis : la connaissance du français écrit, afin d’éviter les six fautes d’orthographe, trois fautes de syntaxe, dix impropriétés et quatre pataquès qui agrémentent – suivez mon regard – une page moyenne des meilleurs quotidiens et parfois même celle de publications plus (précisément) relevées; une culture littéraire sinon exhaustive en plusieurs domaines tant hexagonaux qu’étrangers, mais qui au moins fasse la part belle au passé, car Aristophane a existé avant Pierre Desproges et Proust avant Mendelssohn; une teinture générale de tout le reste (aucun critique de poésie ou de roman ne peut se vanter d’être ignare en Sciences, surtout celles qui nourrissent et ont toujours nourri la littérature – astronomie, biologie, paléontologie –, à moins d’accepter qu’on le taxe d’analphabétisme partiel; enfin, mais là réside le véritable hic, il faut non seulement aimer lire, mais aimer et pratiquer la lecture approfondie, ce qui est une tout autre paire de manches.
Lecture approfondie, qu’est-ce ? Eh bien! Il suffirait de montrer à tous – mais ce serait cruel et la cruauté, en cette matière comme en d’autres, nous est étrangère – combien certains universitaires réputés brillants et « spécialistes » (comme on dit) de littérature sont capables de commettre des contresens complets sur tel poème apparemment limpide d’Au cœur du monde de Cendrars par exemple, pour ne rien dire d’Apollinaire le subtil ou de Maurice Scève le retors, pour que l’extrême difficulté dissimulée par cette formule faussement anodine, « lecture approfondie », apparaisse en pleine lumière.
Et d’abord il convient d’être lent. Ce défaut, qui faisait soupirer Breton quand il comparait sa propre lenteur à écrire avec l’extraordinaire aisance et rapidité d’Aragon (le résultat, à l’autopsie, on le connaît : Aragon a écrit beaucoup de vers de mirliton, Breton pas un seul texte qui ne soit à sa gloire), ce défaut, donc des scrupuleux et des gourmets, se révèle indispensable à acquérir quand il est question de critique littéraire, ou d’ailleurs de tout autre art. La manducation littéraire est lente, il ne s’agit pas de bouffer l’hostie mais de la savourer, même et surtout si elle est en fin de compte insipide (c’est ainsi qu’on s’en aperçoit).
Les textes qui comptent
Loin de nous l’idée de jeter l’anathème sur ces merveilleux boulimiques qui ingurgitent six cents pages de James Joyce en une journée. Mais ces champions ou bien se condamnent à n’avoir rien compris à rien s’ils s’en tiennent à la performance, ou bien rajouteront par après à leur premier bol alimentaire une mince couche de mots déjà avalés, et puis une autre, et cela pendant des heures. Vous les verrez littéralement avachis, c’est-à-dire changés en vaches et ruminant, remâchant la même bouchée pour la centième fois (et je ne vous dis pas expectorant combien de méthane langagier sous forme de rots phonèmes), faute de quoi leur estimation de la valeur du mets restera superficielle.
Les textes, ceux qui comptent, ne sont pas faits d’idées, d’histoires, ni de paragraphes (ou de strophes), ni de phrases, ni même de mots. Leur charme, ou leur inutilité, se construit de syllabes et de silences – d’où le caractère essentiel de la ponctuation, même si elle n’existe pas (car elle est alors virtuelle et c’est la respiration intérieure qui l’institue, ou la restitue). Critiquer un texte revient donc – mais ce n’est pas une petite affaire – à recréer en soi le jeu des syllabes et des silences, en somme non pas à le réécrire mais à l’interpréter exactement comme un chef d’orchestre déchiffre une partition délicate. C’est pourquoi il ne faut pas s’offusquer que tant de critiques dignes de ce nom soient aussi des praticiens de l’écriture. Combien existe-t-il de chefs d’orchestre qui n’aient pas d’abord tenu leur rôle comme premiers violons, et tâté au moins de la composition?
Descendre jusqu’aux tréfonds du langage singulier d’un véritable écrivain, refaire pratiquement avec lui le chemin qu’il a dû parcourir en lançant ses attaques (« Je te salue, vieil Océan », « Un agneau se désaltérait », « Dans le rêve d’Elisa », rien que des poètes, je le concède, mais la poésie n’est-elle pas le parangon même, et la pointe ultime de la littérature ?), n’en louper aucun, de ces mots, aucun des enchaînements syntaxiques qui le relient aux autres, reconstituer ainsi, pour le monologue intime de chacun, l’architecture même d’où émane la musique, et qui accessoirement bâtit le sens, voilà la lecture approfondie. Sans cette discipline la critique n’est qu’un survol, habile ou laborieux, de ce qui est le moins intéressant dans un texte, son déroulement anecdotique, ce qu’il charrie forcément de tout ce qui n’est pas vraiment lui : histoire d’amour, état d’une société et, encore un peu plus bas dans le degré d’attention requis, effet de mode ou engagement politique.
Merde alors! Dit le lecteur. Mais comment faites-vous donc pour rendre compte d’un gros volume et – ce qui est tout de même la raison de la critique – donner à l’autre anonyme l’envie de lire le dernier livre de Machin? Et quand Machin n’est accessible qu’en traduction?
Réponse (navrée) : on compose avec ses principes, mais l’oreille basse et la truffe à terre, car c’est un métier de chien.
Maurice Mourier
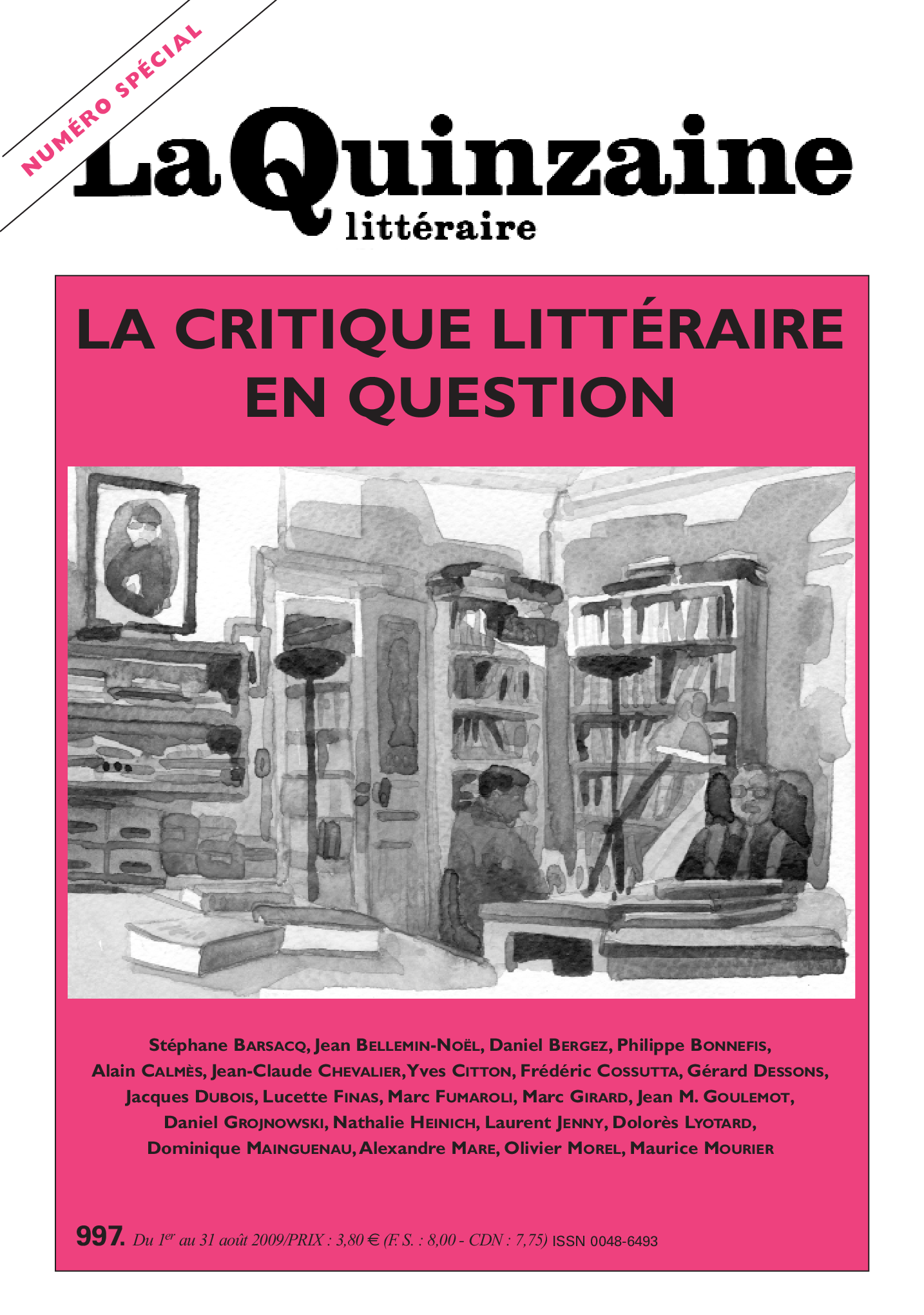

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)