Face à ce gouffre de toutes les turpitudes, on se dit d’abord qu’un grand romancier hongrois un peu fou a voulu réécrire Dante, et ce d’autant que le récit procède par cercles dont chaque spire englobe l’histoire circonscrite d’un fait divers, d’une famille, d’un moment historique, d’un paysage, de quoi justifier la comparaison. Mais ça ne colle pas. Il s’agit ici de la terriblement humaine Comédie, en aucun cas de la Divine, et surtout pas de guide dans cet enchaînement monstrueux de crimes et de suicides, de guerres et de trahisons, aucune Béatrice et d’ailleurs aucun poète. On a beau cheminer dans une forêt obscure et buter de chapitre en chapitre sur une nouvelle fournée de damnés, ce qui manque, grâce à une série de trouvailles stylistiques stupéfiantes, c’est bien la voix narrative qui dans toutes les sagas a pour fonction première de rassurer le lecteur.
Cette voix omniprésente, chez Dante par exemple, mais aussi bien dans La Comédie humaine du roi Balzac, ou bien dans la Recherche, en somme partout, confère au lecteur une position d’exterritorialité : tu vois, dit Dante, je suis là, je te raconte ce que je découvre, la douce main de l’Égérie, posée sur mon bras, m’évite de rouler dans la fange avec les réprouvés. Nádas, au contraire, nous plonge jusqu’au cou au fond d’un Nuit et Brouillard sans nous y accompagner, sans carte ni mode d’emploi, sans tirer du récit aucune leçon apparente. Il nous condamne au sort cocasse des trois petites filles de Lewis Carroll forcées de puiser la mélasse non pas en la hissant d’un puits de cette matière gluante à l’extérieur duquel elles se tiendraient, mais bien du fond même du puits où elles vivent. Dans l’admirable scène de De l’autre côté du miroir où le Loir répond à Alice qui lui rappelle avec inquiétude : « But they were in the well », « Of course they were, well in », un jeu de mots, mine de rien, traduit le caractère inquiétant et morbide du chef-d’œuvre victorien : mais oui, ma petite, pour tirer la mélasse, elles étaient dans le puits de mélasse, carrément dedans ! Et de même le lecteur de Nádas : non pas spectateur distancié de l’horreur, mais carrément dedans, les deux pieds dedans, ou devant.
Histoires parallèles conte à sa manière tordue l’histoire de la Hongrie de 1920 à 1989, de la dictature nationale-socialiste de l’amiral Horthy à la chute du mur de Berlin dont la mention figure à la première page du livre. Le lecteur sera donc bien avisé de revoir son ABC de la Seconde Guerre mondiale, car Nádas ne lui facilite guère la tâche en procédant par allusions, résurgences brutales de faits occultés, et bouleverse constamment la chronologie en mêlant le présent au passé, ou plus exactement en refusant au moindre de ses personnages – et il y en a une foule, qui s’agite sur les marges des aventures des dix ou douze principaux - de vivre un épisode quelconque de sa chienne de vie sans qu’instantanément celui-ci soit contaminé par le souvenir d’événements précédents, des traumatismes pour la plupart.
C’est que la Hongrie, dont le Prix Nobel de littérature Imre Kertész, ami de Nádas, assure qu’elle est irrémédiable – et l’apparition toute récente du néo-fasciste Orban semble lui donner raison – s’est illustrée, au long de l’atroce XXe siècle, comme l’alliée la plus servile des totalitarismes, l’auxiliaire zélée du nazisme après l’Anschluss (15 mars 1938), partageant avec Himmler l’idéologie de la solution finale en envoyant ses Juifs en camp de concentration, participant aux expériences de nettoyage biologique des malades et des tarés avec Mengele, puis se muant sans complexe en complice du stalinisme, après l’écrasement de la révolution d’octobre 1956 notamment. Toute la Hongrie ? Non, bien sûr, mais bien l’essentiel du « pays dans ses profondeurs » suivant la formule gaullienne, le fond nationaliste et xénophobe d’un peuple de paysans du Danube que représente gaillardement dans le texte le concierge Balter. Dénonciateur de Juifs puis d’insurgés de 56, maton dans un pénitencier des rives du fleuve, il prend sa retraite et cultive en sage voltairien son lopin de plaine, mais finit par tuer sauvagement – et c’est aussi presque la fin du livre – le fou inoffensif échappé d’un asile, qui lui volait ses abricots.
Le livre des victimes
Histoires parallèles est le livre des victimes. Les Juifs bien entendu, puis les Tziganes, qui encourent les uns et les autres, cela semble aller de soi, le mépris et la haine de l’ensemble de la société, du haut au bas de l’échelle sociale. Ah ! on est bien loin de la sympathie active que Jules Verne manifestait à l’égard de l’irrédentisme magyar dans son Mathias Sandorf en 1885 ! La magyaritude, dans ce livre, est synonyme de morgue obtuse, d’autant plus encline à manifester l’orgueil imbécile de la « race » que la crainte – et la réalité – du métissage est partout. Les meilleurs représentants de l’antique « noblesse » issue des hordes ouralo-altaïques jadis sédentarisées autour du lac Balaton, dans les plaines danubiennes et la Transylvanie, à peu de choses près les limites des provinces romaines de Pannonie et de Dacie, ne se sont pas privés d’épouser les héritières juives, riches et cultivées, de pères ayant fait fortune par leur travail. On voit ces couples se former puis se défaire au fil du livre, on voit ces veuves, actuelles ou futures, tenter, dans la Hongrie présente, de recouvrer leurs biens spoliés, d’élever leurs enfants déboussolés, de maintenir avec d’autres anciennes beautés, qui furent leurs compagnes de jeunesse, des liens en partie factices, qui bien rarement en tout cas sont marqués par une tendresse ou une générosité vraies. Si bien que le lecteur découvre avec effarement un pandémonium dont la clé est le manque d’amour.
L’Enfer hongrois
C’est là ce qui rend la lecture de ce livre étonnant si dérangeante. De ce qu’il faut bien appeler l’Enfer hongrois, quelle est la cause principale ? On la découvre dans le très long chapitre ultime du Livre I, bizarrement intitulé « Les arguments silencieux de l’esprit », 100 pages, presque un volume à lui tout seul, et surtout dans les deux premiers chapitres du Livre II (« L’île Marguerite » et « L’autre rive »), cet ensemble en continuité formant la tentative la plus obsessionnelle que je connaisse de décrire in vivo ce que fornication veut dire. Fornication, et non pas justement amour physique. Dans le premier cité de ces chapitres, Ágost, un des protagonistes, le fils d’Erna Demén, dite Nino, descendante d’un céréalier juif et propriétaire d’un magnifique immeuble à Budapest, s’envoie en l’air dans une chambre de bonne sordide avec la belle Gyöngyvér, qu’il juge inculte et qu’il méprise. Dans le second, Kristóf, cousin d’Ágost, orphelin de père (celui-ci a été assassiné par ses « camarades » communistes), et quasiment de mère (elle l’a abandonné pour vivre avec une femme), erre sur le territoire nocturne des rencontres homosexuelles de la capitale, en voyeur d’abord, en violé à demi consentant ensuite.
Or cette seconde scène, où l’exaspération phallique atteint un degré d’incandescence rare, explique en fait la précédente, où le culte du phallus en gloire – entre apothéose et dégoût – est célébré sur tous les tons de la vanité masculine et de l’extase féminine, bien réelle mais point dupe pour autant. Dans les deux cas, c’est la formidable stupidité agressive du mâle, la soumission apprise et jugée, mais pas clairement dénoncée, de la femelle, qui s’étalent et interdisent rigoureusement entre partenaires tous sentiments vraiment humains, ou qui devraient l’être, tels que prise de conscience de l’égalité des sexes dans la jouissance, éloge du plaisir, échange amoureux, reconnaissance envers autrui et ce qu’il apporte, tendresse, et avant tout bonheur.
L’obsession maladive du sexe
On comprend, à partir du constat de cette carence fondamentale, le caractère oppressant d’une œuvre où nulle part l’amour ne peut se faufiler puisque l’égoïsme et le malheur de vivre empêchent son émergence. Mais cela va beaucoup plus loin. Plus loin que la Hongrie, car l’obsession maladive du sexe perpétuellement sollicité, perpétuellement excité, convoité et déçu, s’accompagne, en toute page du texte, d’une inflation des bruits et des odeurs du corps, d’une véritable hantise de ce qu’on appelait pudiquement « les humeurs » au Grand Siècle de l’hypocrisie, qui ici suintent continûment, tachent, engluent, empestent. L’homme pète, vomit, défèque, se roule dans ses déjections, l’homme baise et c’est la même chose, il se vautre dans l’abject comme la bête qu’il est en effet, comme le ver amoureux d’une étoile, mais l’étoile est absente et le ver est obscène et nu. L’ignominie hongroise devient alors, dans la peur omniprésente, la bassesse, la sanie, la violence et la médiocrité des âmes, une métaphore de celle du monde entier. Enfoncé, Céline, sur son propre terrain ! Histoires parallèles ou l’explication des dérives homicides du XXe siècle par la religion de la virilité. Soldats, du haut de ce monceau de morts qui pourrissent et qui puent, du haut de ces millions de massacrés, d’amputés, de torturés, c’est le Saint Phallus qui vous contemple et que vous adorez !
Rude épreuve pour le lecteur masculin, rude et saine quand elle peut se compenser, comme ici, par la délectation née d’un art consommé des structurations insolites. Ne connaissant pas le hongrois, bien malin l’amateur de littérature qui pourrait juger de la langue et de sa traduction – bien qu’un Galenos, transcription littérale du nom du fameux médecin grec qui nous est connu depuis Rabelais sous le nom heureusement francisé de Galien, fasse mauvais effet dès le début du texte (page 23)… Mais des structures romanesques et de leur diabolique imbrication, oui, on peut discuter. Rien de plus consciemment baroque que ce livre. À l’intérieur même des chapitres, pas la moindre linéarité. On passe sans crier gare du Je au Il et il s’agit bien pourtant du même personnage. On saute d’une réminiscence à une autre, de la réalité (fictionnelle, bien sûr) au rêve, de nuit ou bien éveillé. Une vertigineuse simultanéité, à la Delaunay ou à la Fellini dans les séquences les plus élaborées de son Casanova de 1976, mais sans jamais l’euphorie fellinienne, fait glisser les uns sur les autres, comme autant d’images à peine fluides (visqueuses plutôt, chargées de glaires, elles collent à la rétine), les éléments disloqués de cette puissante et sinistre fantasmagorie.
Quelques lueurs dans ce diorama de cauchemar ? En cherchant bien, peut-être. Ainsi, dans l’avant-dernier chapitre du Livre II (« Traverses imprégnées »), quand le vieux marchand de bois juif ruiné, Gottlieb, parvient enfin à faire rire sa femme, une mégère, en lui lisant l’histoire du rabbin Ammon, qui réussit à tromper les goyim et à s’enfuir avec les siens à Pfeilen. Ou bien encore dans le dernier chapitre du livre (« L’amoureux de la beauté »), quand le bon contremaître Bizsók, le seul Hongrois du texte qui ne soit ni une insensible brute ni une lavette, se demande s’il ne va pas inviter Tuba, son ouvrier tzigane, dont il admire la beauté, à partager sa roulotte, et cela sans implication sexuelle immédiatement repérable. Les Tziganes ! Ils n’apparaissent qu’in fine en tant qu’hommes, non en tant que parias, et l’on apprend incidemment que Gyöngyvér, fille adoptive de ce Bizsók, est peut-être bien une Tzigane, elle aussi. Mais la lueur est ténue, elle s’efface aussitôt. Faire cohabiter un Rom, cette lie de l’humanité, avec un Hongrois de souche, cela décidément ne se peut pas et Bizsók renonce… par respect humain !
En fait, le système d’écriture d’Histoires parallèles ne rappelle celui de La Divine Comédie que parce qu’il l’inverse. Concentriques dans La Comédie où l’on s’enfonce de l’obscurité sylvestre relative jusqu’à l’anus mundi, centre menaçant où règne le Malin, les cercles que dessinent ces sombres « histoires » de Nádas sont excentriques. Le décor du livre s’élargit de Budapest la maléfique à la campagne verdoyante autour du Danube et de la Tisza, perdant un peu, très peu, de son horreur désespérée. Faut-il comprendre qu’au rebours de la Recherche du temps perdu, l’immense « recherche de l’impossible oubli » que Péter Nádas a tentée au cours d’années fiévreuses d’écriture – quinze, dit-on – a finalement réussi ? Ce serait trop beau, tant qu’il y aura des mâles et qu’ils répandront la terreur.
Maurice Mourier
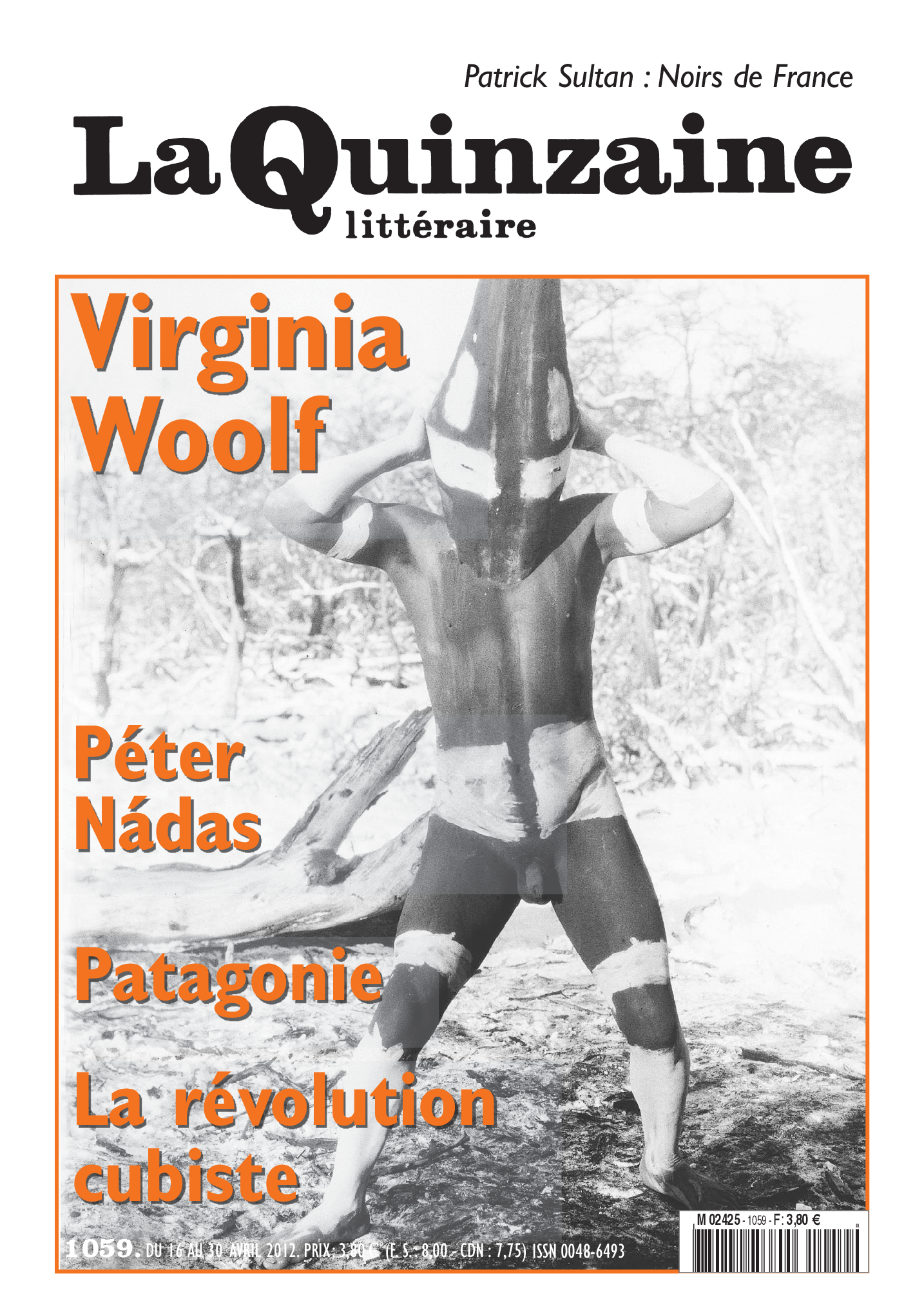

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)