Omar Merzoug : Lire d’une manière critique, qu’est-ce à dire pour vous qui êtes l’initiateur de la « textanalyse » ?
Jean Bellemin-Noël : C’est lire d’abord et essentiellement pour le plaisir. Autrement dit, contrairement à ce que fait Pierre Bayard, qui explore les possibilités qu’offre la psychanalyse ou les procédés herméneutiques de cet ordre pour repérer la théorie implicite et le savoir contenus dans les œuvres, j’ai toujours pratiqué une lecture d’imagination enrichie par l’inconscient en essayant d’aller plus loin que ce que fait d’ordinaire la critique littéraire – toujours pour répondre à l’éternelle question : « Pourquoi est-ce beau ? Pourquoi est-ce que ça plaît ? » Ce qui me stimule, ce qui m’importe, c’est de découvrir des aspects nouveaux, de faire rayonner le texte autrement, de le faire résonner chez le lecteur, d’essayer de faire comprendre aux autres pourquoi tel livre les séduit et pourquoi tel autre, qui peut être du même auteur, les accroche moins, probablement parce que ça les touche à un niveau de leur être profond qu’ils ne connaissent que s’ils ont effectué une analyse et si elle a été bien conduite. Je pense que tel est le véritable objet du travail d’un critique littéraire.
O. M. : Dans un petit livre consacré à l’interprétation psychanalytique des textes, vous écrivez que la textanalyse est une démarche radicale ; en quoi consiste sa radicalité ?
J. B.-N. : Elle est radicale parce qu’elle est née contre un autre type de lecture, une sorte de lecture fourre-tout dans laquelle on mélangeait ce qu’on pouvait reconstituer de l’inconscient de l’écrivain à travers sa vie, telle qu’il l’avait racontée ou que les témoins l’avaient restituée, à travers sa correspondance, ses écrits de circonstance, en marge de son œuvre proprement dite ; j’avais pensé, à tort ou à raison, que c’était d’abord un travail incertain dans ses conclusions et ensuite un travail inutile : j’ai en effet commencé par lire les Contes ou l’Iliade, textes sans auteur, où ça n’a pas de sens de se demander ce que l’auteur a voulu dire ou quel était l’inconscient de l’auteur. Donc contre ces procédés fourre-tout, j’ai radicalisé les possibilités en restreignant sévèrement l’objet de mon travail à un ouvrage à la fois, étant entendu qu’ouvrage peut tout aussi bien renvoyer à La Recherche du temps perdu qu’à un sonnet de Baudelaire. Un ouvrage, c’est-à-dire un énoncé qui comporte une unité et une cohérence et où j’essaie de percevoir, comme un analyste procède avec un patient, ce qui est mis en jeu des formations inconscientes du lecteur. Au début, j’ai attribué ces formations inconscientes au texte par ce que c’était la mode et qu’on ne parlait que du Texte, mais maintenant j’appellerais plutôt ça l’inconscient de la lecture, car c’est mon engagement personnel dans le texte qui est mis en cause. Je partais du postulat que mon inconscient n’est pas foncièrement différent de celui de mes auditeurs ou éventuels futurs lecteurs, et que donc ce que j’aurais décelé pourrait leur ouvrir des perspectives et leur faire éprouver un plaisir renouvelé à lire certaines œuvres.
O. M. : Cette manière de lire les textes littéraires au sens le plus large du terme vautelle pour tout texte littéraire, quelle que soit la culture dans laquelle il s’inscrit ?
J. B.-N. : Oui. J’ai travaillé en utilisant les langues que je connaissais. J’ai travaillé sur des textes allemands, j’aurais pu travailler sur le latin et le grec ; je viens de travailler de manière plus indirecte sur des romans coréens parce que je collabore à la traduction de romans de ce pays, j’ai le sentiment que c’est valable pour tous les temps et tous les lieux. Votre question est en un sens opportune, puisque mes plus fidèles « disciples » qui ont essayé de travailler à ma manière sont essentiellement des Japonais et des Coréens. Il s’est trouvé que c’étaient ces étudiants qui venaient à Vincennes ou à Paris-VIII préparer leur doctorat avec une réelle curiosité pour le freudisme et j’ai pu constater que cette manière de lire vaut absolument pour tous les textes.
O. M. : Pour en revenir à votre méthode de lecture, la textanalyse, peut-on dire qu’il y a autant d’interprétations qu’il y a de lecteurs d’une œuvre ?
J. B.-N. : C’est l’objection qu’on fait généralement à cette méthode ; sauf à noter que, pour reprendre une comparaison simple, notre inconscient est à l’image de notre corps : nous avons tous deux bras, deux jambes, une tête, un cœur. Il en est qui sont plus habiles d’une main que de l’autre, il y en a qui boitent…
O. M. : Vous voulez dire, en somme, qu’il y a des « fantasmes originaires » ?
J. B.-N. : Voilà, il y a en nous tous les fantasmes liés à notre origine même, au fait de notre naissance sexuée, et puis chacun les adapte à sa façon. Je pense qu’en faisant ses propres associations on peut rendre la parole aux images qui sont latentes dans les textes et c’est ce qui m’avait permis de dire que l’inconscient était en quelque sorte dans le texte. Maintenant, je me rends compte qu’en réalité il produit ses effets au point de rencontre du texte et du lecteur, c’est pour cela que je parle d’inconscient de la lecture. Les éléments qui surgissent sont des éléments qui sont à la disposition de tous dans toutes les langues, dans toutes les cultures si l’on admet avec Freud l’idée que l’inconscient est le même pour tous les êtres humains pour la simple raison que tous les êtres humains ont eu une mère, un père, ou quelqu’un qui en tenait lieu… Et à partir de ce noyau très précoce, Freud a toujours défendu l’idée que l’inconscient était « infantile » et qu’il demeurait comme trace de l’infantilité en chacun : de ce fait-là, nous avons pratiquement tous le même inconscient de base.
O. M. : Que pensez-vous de ce décalage qui semble franco-français entre une critique littéraire journalistique (magazines, quotidiens, hebdomadaires) et une critique érudite, savante, qui fait appel à un savoir constitué et des outils d’une grande rigueur ?
J. B.-N. : Il y a d’une part ceux qui lisent vite tout ce qui paraît afin d’éclairer les choix du public en sélectionnant ce qui leur paraît le meilleur, le plus susceptible de durer, et d’autre part ceux qui étudient, longuement et en détail, les ouvrages qui manifestement durent ou ont commencé à durer. Ce sont parfois les mêmes, avec deux casquettes différentes. Ou alors, les premiers ont souvent été les élèves ou les étudiants des seconds, pour acquérir auprès de divers spécialistes une formation générale, plus polyvalente.
O. M. : Certains écrivains prétendent que les critiques littéraires ne leur ont jamais rien appris, qu’en pensez-vous ?
J. B.-N. : Je serais assez d’accord. Il me semble que si j’étais un véritable écrivain, j’écrirais en pensant à mon rapport à l’écriture et à des lecteurs « éternels », donc je ne me demanderais pas si le discours de tel ou tel critique peut m’aider ou ne pas m’aider au moment où j’écris. Les écrivains apprennent plus des philosophes que des critiques. Je pense à quelqu’un qui a été très bien étudié par un de ceux qui font actuellement du bon travail en critique (Patrick Née), je pense au poète Yves Bonnefoy : il est à mes yeux le seul écrivain avec Michel Leiris qui ait pris au sérieux l’apport du freudisme et qui ait intégré à son écriture ses rapports avec son inconscient ; et même il théorise l’intérêt qu’il y a quand on est poète à mesurer la dimension d’« autoanalyse » que comporte l’écriture poétique. Un RobbeGrillet, au contraire, n’a cessé de dénier cette réalité.
O. M. : Quand vous lisez vos confrères ou vos collègues qui écrivent dans des revues comme Critique, Littérature ou Poétique, qu’est-ce que vous attendez d’eux ?
J. B.-N. : Un accroissement de mon plaisir de lire touchant des œuvres que je ne connais pas ou que je n’ai pas moi-même étudiées à fond : Starobinski sur Rousseau, Jean-Pierre Richard sur Proust, ce furent des expériences inoubliables. Le plus souvent, cela m’intéresse de considérer leurs « trouvailles », d’examiner ce qu’ils avaient vu ou repéré et que je n’avais moi-même pas repéré, ce qui les avait stimulés. C’est fascinant de noter, comme je le fais souvent avec mes anciens étudiants japonais ou coréens, qu’à partir des mêmes prémisses on peut procéder à un autre travail légèrement différent. Il faut avoir le culte de ce que Freud appelait les « petites différences ».
O. M. : Un critique littéraire idéal, ce serait ?
J. B.-N. : Celui qui me permettrait de mieux lire, de faire une lecture plus enrichissante d’un texte que j’avais bien aimé ou dont j’avais pensé qu’il fallait le relire mieux que je n’avais fait auparavant.
Omar Merzoug
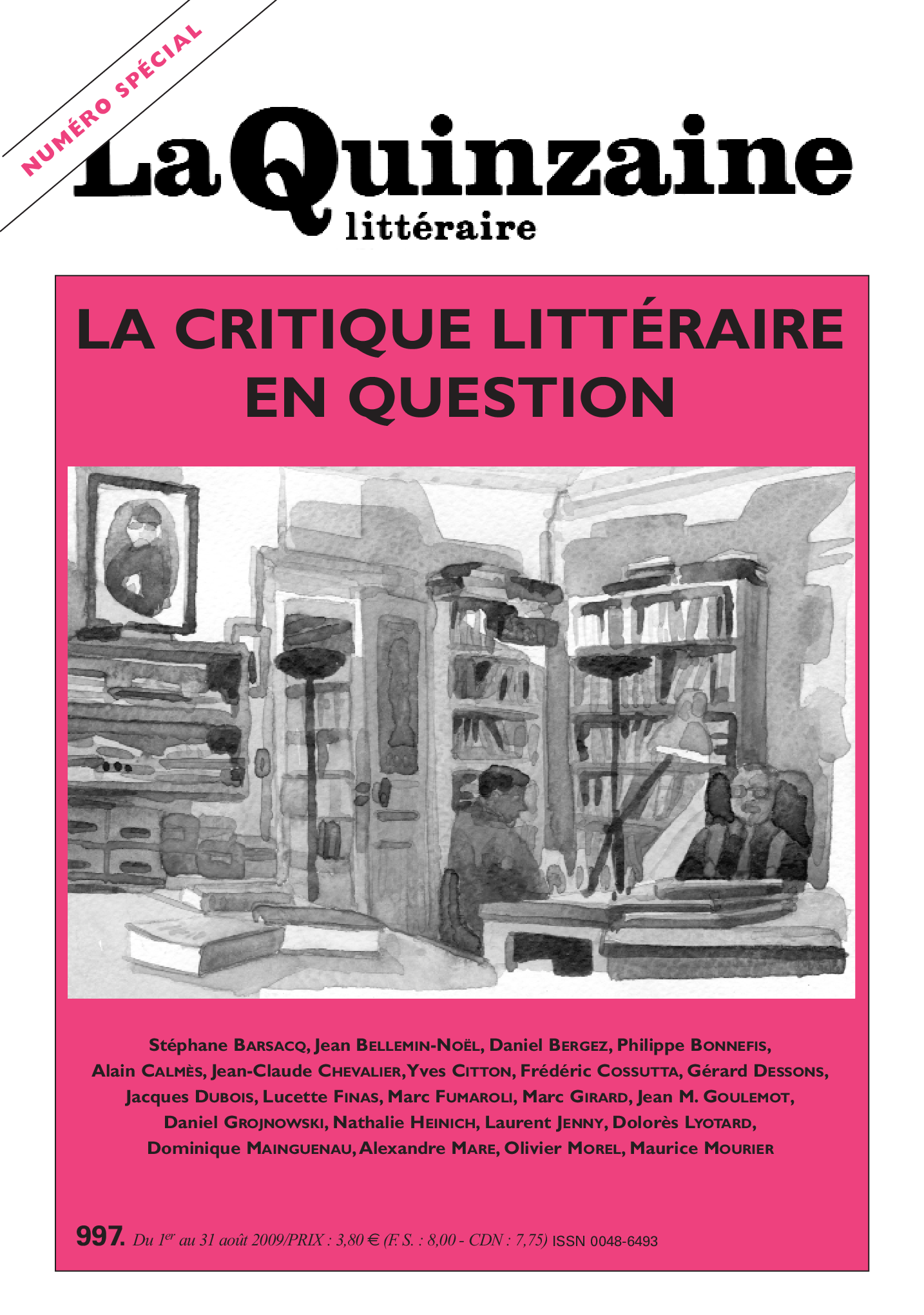

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)