Jean-Michel Maulpoix a intitulé son essai sur la poésie contemporaine : La poésie a mauvais genre[1]. Est-ce pour cela que, dans nombre de librairies, le rayon poésie est absent ou très réduit et plus ou moins dissimulé ? En dehors de quelques grands événements qui peuvent attirer les foules, comme le Marché de la poésie et certains festivals, on voit régulièrement des amateurs, si peu, se retrouver dans une librairie ou une médiathèque pour entendre un poète lire son œuvre récente. Les revues à l’allure de fanzines ...
La poésie a mauvais genre
Article publié dans le n°1187 (01 févr. 2018) de Quinzaines
Testament (d’après François Villon)
(Léo Scheer)
A.R.N. agencement répétitif névralgique_voyou
(Editions de la Revue des Ressources)

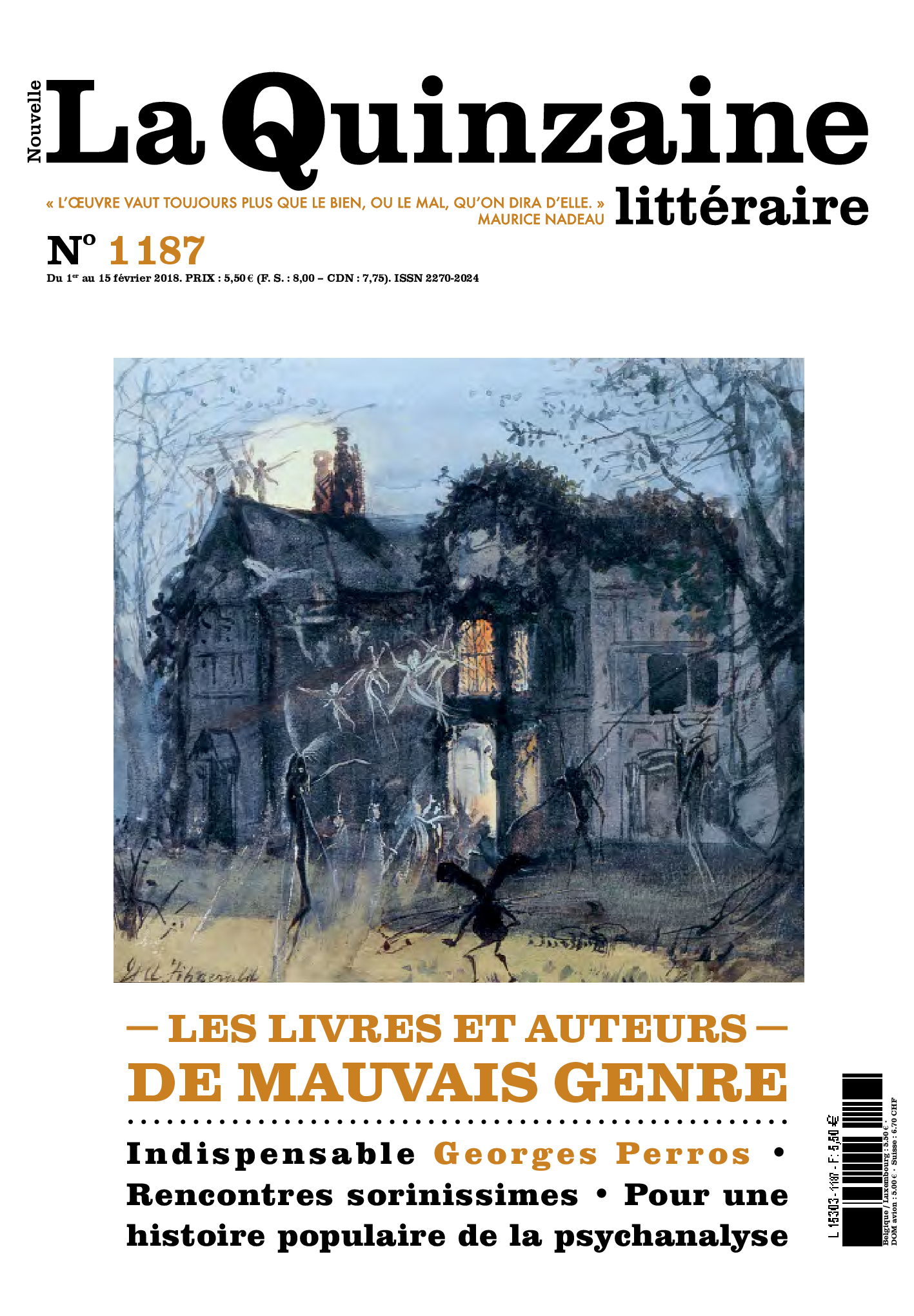

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)