L’un des apports de cette publication est de donner à lire des textes peu connus, où le croyant et le penseur s’expriment directement, sans passer par le truchement de la critique littéraire. Une foi religieuse absolue et intransigeante s’y formule, servant de point d’optique pour juger d’une décadence politique, sociale et morale que Léon Bloy n’a cessé de stigmatiser. Dans les ténèbres présente ainsi des analyses critiques pleines de mordant du culte des apparences, de l’occultation de la douleur (dans un « siècle si lâchement sensuel ») comme du culte de l’argent représenté par les nouveaux riches, « ceux qui ne rendent pas l’argent ou qui ne le rendront qu’avec leurs tripes quand on les aura crevés sans douceur ». Certains textes relèvent de la pensée mystique, comme Le Symbolisme de l’apparition et Celle qui pleure, consacrés à l’apparition mariale de Notre-Dame de La Salette. D’autres tentent de montrer comment, dans l’histoire, se manifeste la révélation de l’Esprit saint et de l’Apocalypse, comme Le Révélateur du Globe, consacré à Christophe Colomb.
Le Salut par les juifs permet de rendre justice des accusations d’antisémitisme qui ont poursuivi Léon Bloy, alors qu’il tentait, dans cet ouvrage, par les voies d’une ironie féroce, d’« honorer le monde juif au-delà de toute espérance ». Il est vrai que, s’il s’en prend à l’antisémitisme incarné par Drumont, il accable aussi les juifs contemporains, en tant qu’ils participent selon lui à ce monde du lucre qui suscite sa détestation. Tel est d’ailleurs le thème axial du Sang du pauvre, métaphore par laquelle Bloy dénonce le triomphe de l’argent dans la société contemporaine. Sa dénonciation s’appuie sur l’idée chrétienne d’une richesse qui est toujours à redistribuer à ceux qui en sont privés, car elle émane de Dieu : le riche doit toujours rendre ce qu’il ne possède jamais en propre. Or le « système de la Sueur » du monde moderne accable les miséreux, les laissés-pour-compte de la société. Et Bloy, qui pourrait passer sous certains aspects pour un bien-pensant, mêle ainsi sa voix à celles des anarchistes.
Sa propre expérience de la misère et du dénuement, qu’il est sans doute le seul des écrivains contemporains à avoir connus à ce point, porte son souffle dans ses réquisitoires. « Le Sang du Pauvre, c’est l’argent […]. Tu n’as pas le droit de jouir quand ton frère souffre ! hurle, chaque jour, de plus en plus haut, la multitude infinie des désespérés. » Les injures habituelles de Bloy cèdent la place à la compassion indignée, à la stupeur d’une conscience affligée par l’insupportable : « Ce qu’il y a de plus incompréhensible au monde, c’est la patience des pauvres […]. Car voici l’horreur des horreurs : le travail des enfants, la misère des tout-petits exploitée par l’industrie productrice de la richesse ! » Hugo et Michelet ne sont pas loin.
C’est cependant au titre de l’activité critique que Léon Bloy a laissé son nom dans l’histoire littéraire. Ses articles sont, pour l’essentiel, réunis dans deux recueils placés en tête du volume. Les Propos d’un entrepreneur en démolitions (1884) annoncent la posture critique qui sera toujours celle de Léon Bloy, moins soucieux d’analyser les œuvres (il s’en défend d’ailleurs : « J’ai déclaré depuis longtemps mon incompétence en cet arpentage ») que de défaire à grand renfort d’anathèmes des réputations qui lui paraissent usurpées. Ses cibles favorites sont sans surprise les écrivains naturalistes, les frères Goncourt et surtout Zola. Il consacre à ce dernier un pamphlet au titre ironique, « Je m’accuse », où sont évoqués les « merdeux romans » (sic) de ce « lécheur des émonctoires » ; à l’accusation de se repaître de l’ignoble se joint celle de stérilité de pensée, accablée a contrario par un déluge de noms prestigieux : « M. Zola est le Christophe Colomb, le Vasco de Gama, le Magellan, le grand Albuquerque du Lieu Commun. Il équipe une flotte de trois cents navires et presse une armée navale de trente mille hommes téméraires pour découvrir que “tout n’est pas rose dans la vie” […] ou que “l’argent ne fait pas le bonheur”. » Il s’emporte donc contre « l’impuissance, l’infécondité de l’auteur », assimilant son « bavardage monstrueux » à la « masturbation d’un cadavre ». La critique des Goncourt est aussi radicale, mais dans le sens de l’insignifiance : « M. de Goncourt, qui n’a pas de génie, mais qui est plein de cavernes sonores et ténébreuses, est illuminé à nos yeux par le mot RIEN. » Cette vacuité se masque derrière la « salauderie physiologique qui sert de base à tout roman naturaliste ».
Cette même critique du « rien » porte, non sans pertinence, sur Flaubert, avec un lexique qui sait s’adapter à la nature de l’œuvre. Point de grossièretés injurieuses pour cet auteur, mais le portrait d’un « fauve concubin des lexiques et des dictionnaires [qui] travailla, tant qu’il fut sur terre, à l’extermination de sa propre personnalité ». On sent, chez Bloy, une perception assez juste du travail de Flaubert, quand il parle d’un écrivain qui « fut à la fois Œdipe et Sphinx et passa chiennement sa vie à se déchirer lui-même » ; et c’est l’avis assez général de l’époque qu’il formule en parlant de l’« embêtement si olympien » de L’Éducation sentimentale. Cette critique de l’inanité est l’argument lancinant des éreintements de Bloy. Affligé de ce symptôme, Alphonse Daudet est ainsi devenu « un voleur de gloire », démarquant Balzac, Dickens, Goncourt, Flaubert, Zola, Paul Arène…, avec un « style visqueux et blanchâtre » caractéristique des « romanciers pour dames ». La charge est assurément plus féroce pour Paul Bourget, cet « épuceur de coccinelles qui méprise les pauvres », accablé par un propos attribué à Pierre Corneille sur les femmes : « “Il leur manque quelque chose”, disait-il. » Et Bloy de poursuivre : « C’est évidemment le triste cas de Paul Bourget. »
L’éreintement littéraire et idéologique des œuvres s’accompagne presque toujours de portraits-charges traités à l’eau-forte. Portraits-caricatures censés être accablants et puisant dans les poncifs les plus éculés d’une physiognomonie animalière et réifiante. Voici Ernest Renan, l’auteur d’une Vie de Jésus nécessairement sacrilège pour Léon Bloy, éclaté dans un puzzle disparate : « Face glabre, au nez vitellien, légèrement empourpré et picoté de petites engrêlures qui tiennent le milieu entre le bourgeon de la fleur du pêcher et les bubelettes vermillonnes d’un pleurnichage chronique, assez noblement posé, d’ailleurs, au-dessus d’une fine bouche d’aruspice narquois et dubitatif. » Il arrive que ce portrait-charge, auquel n’échappe aucune des victimes de Bloy, se construise dans une sympathie amusée pour le modèle ; c’est le cas du « Sar » Péladan, contemporain dont le mysticisme s’accompagnait de ridicules vestimentaires ; il présente « une invraisemblable tignasse de mérinos noir, emmêlée, broussailleuse, exorbitante, à la fois hispide et calamistrée, semblable à quelque nid d’hirondelle mal famé que n’habiterait plus aucun migrateur des cieux » ; les « yeux bovins et à fleur de crâne, ronds et inanimés, [sont] semblables à des dos de poissons morts émergeant d’une onde croupie » ; quant à l’oreille, « qui sait si ce n’est pas un pentacle, un talisman de chair glorifiée, quelque annexe mystérieuse au puissant cerveau de ce prophète qui lui déléguerait sa sagesse ».
En contrepoint de tant de détestations, de temps à autre perce une admiration, elle aussi complète et sans nuance, obéissant au même régime du « tout ou rien ». Bloy n’a pas de mots assez louangeurs pour Ernest Hello, écrivain chrétien de l’époque, et surtout pour Jules Barbey d’Aurevilly, auquel il revient avec une fascination obsédante centrée sur la tension entre perversité et aspiration à l’absolu : ses personnages féminins vivent une expérience « identique à la damnation des anges superbes » ; elles sont des « captives réduites à se dévorer elles-mêmes », dans un « sadisme » qui n’est autre qu’« une famine enragée d’absolu, transférée dans l’ordre passionnel ».
On redécouvre aussi dans ce volume que Bloy fut l’un des premiers à reconnaître la force inouïe de Lautréamont ; c’est à lui qu’est consacré le premier chapitre de Belluaires et Porchers, qui le présente en « être merveilleusement doué, un homme du génie poétique le plus incontestable […], aux trois quarts détruit par l’ouragan de quelque effroyable douleur », et dont l’œuvre conserve la « trace calcinée » qui le fait « se survivre à lui-même ». Bloy est rempli d’une admiration fascinée pour cette œuvre où « l’immense pitié » est « mélangée d’indicible horreur ». Les blasphèmes de Maldoror sont autant de témoignages inversés et bouleversants d’un appel de l’infini : « A-t-il fallu qu’il adorât la Beauté, ce poète englouti dans les ténèbres, pour l’insulter avec tant de soin. »
Ce renversement est sans doute au cœur de la posture qu’adopte Léon Bloy critique. Il est, superlativement, l’Homo duplex, cette figure du double qui a hanté le XIXe siècle. Ange et démon, assoiffé d’absolu mais se vautrant dans la fange et dans l’ignominie pour mieux entrevoir une Rédemption. Il se fait même, non sans complaisance morbide, le grand damné, le sacrifié exemplaire, en revendiquant hautement la culpabilité de ses violences, qui semblent reprendre le cri du psaume biblique : « de profundis clamavi ». Bloy recherche ces ténèbres pour mieux faire résonner dans sa vocifération le cri d’une espérance ultime. L’autoportrait qu’il donne de lui-même dans Léon Bloy devant les cochons atteste bien cette posture, qui ne vise qu’à un renversement : « Incommutablement, il est notifié que je suis louche de mœurs, perdu de réputation, privé de talent, d’orthographe même, un écrivain vidé, vanné, pourri, un bravo de l’écritoire, un chenapan de plume, un crapaud des lettres, un pou malpropre, une tripaille, un champignon vénéneux, un lâche, un pleutre, un parfait drôle. » Comme toujours, l’exécration déverse ici un flot onomastique où se satisfait on ne sait quelle pulsion vers l’ignoble. Mais il s’agit ici de Bloy par lui-même, transformé en martyr d’un avilissement qu’il revendique.
S’accabler pour mieux mériter la grâce : cette dualité rejoint la conversion qu’opère la création artistique. À la suite de Baudelaire et de tant d’autres, Bloy fait de l’imagination la « maîtresse faculté de l’artiste » ; et, comme chez le poète des Fleurs du Mal, elle opère un renversement, établit une « réversibilité » entre l’horreur et le salut : « Elle parfume les immondices, désinfecte les élégances, aurifie les dents des crocodiles, rapatrie l’ivresse du parfait amour dans les plus vieux cœurs, découvre des filons de marbre dans des chairs vendangées par la syphilis, restitue des comètes aux plus répugnantes calvities, confère la sapidité de l’ambroisie au vomissement. »
Quel intérêt à lire Léon Bloy aujourd’hui, si l’on n’est pas de sa chapelle, qui sent le soufre ? Sa virulence le rend détestable, mais elle rappelle ce que furent les débats d’idées au XIXe siècle et au début du XXe siècle : de véritables affrontements, l’équivalent scriptural du duel (que Léon Bloy pratiqua d’ailleurs) ; bref, l’inverse de la critique lénifiante, bien-pensante et complaisante de certains thuriféraires d’aujourd’hui. Les idées avaient corps et chair, elles engageaient sous le regard d’autrui, et écrire était un acte. Par ailleurs, l’intolérance religieuse de Léon Bloy, poussée à un fanatisme d’exécration, rejoint, dans ses conséquences politiques et sociales, bien des dénonciations de la société actuelle, fondée sur l’inégalité. Sa sympathie instinctive pour les pauvres et les exclus est manifeste, nourrie encore par la figure du Crucifié, qui lui en offre l’image exemplaire. Sa condamnation de l’argent et de l’affairisme sonne aussi juste aujourd’hui qu’à son époque : « Le désir exclusif de s’enrichir est, sans contredit, ce qui peut être imaginé de plus abject », affirme Le Sang du pauvre. En ces temps d’autocensure éditoriale, dans un contexte où l’opinion dirige le marché, il est assurément courageux à un éditeur d’avoir pris le parti de rééditer Léon Bloy. Ses excès, ses outrances insupportables, ses violences injurieuses, font partie de son œuvre, autant que les lueurs d’infini qui y percent pathétiquement.
Daniel Bergez
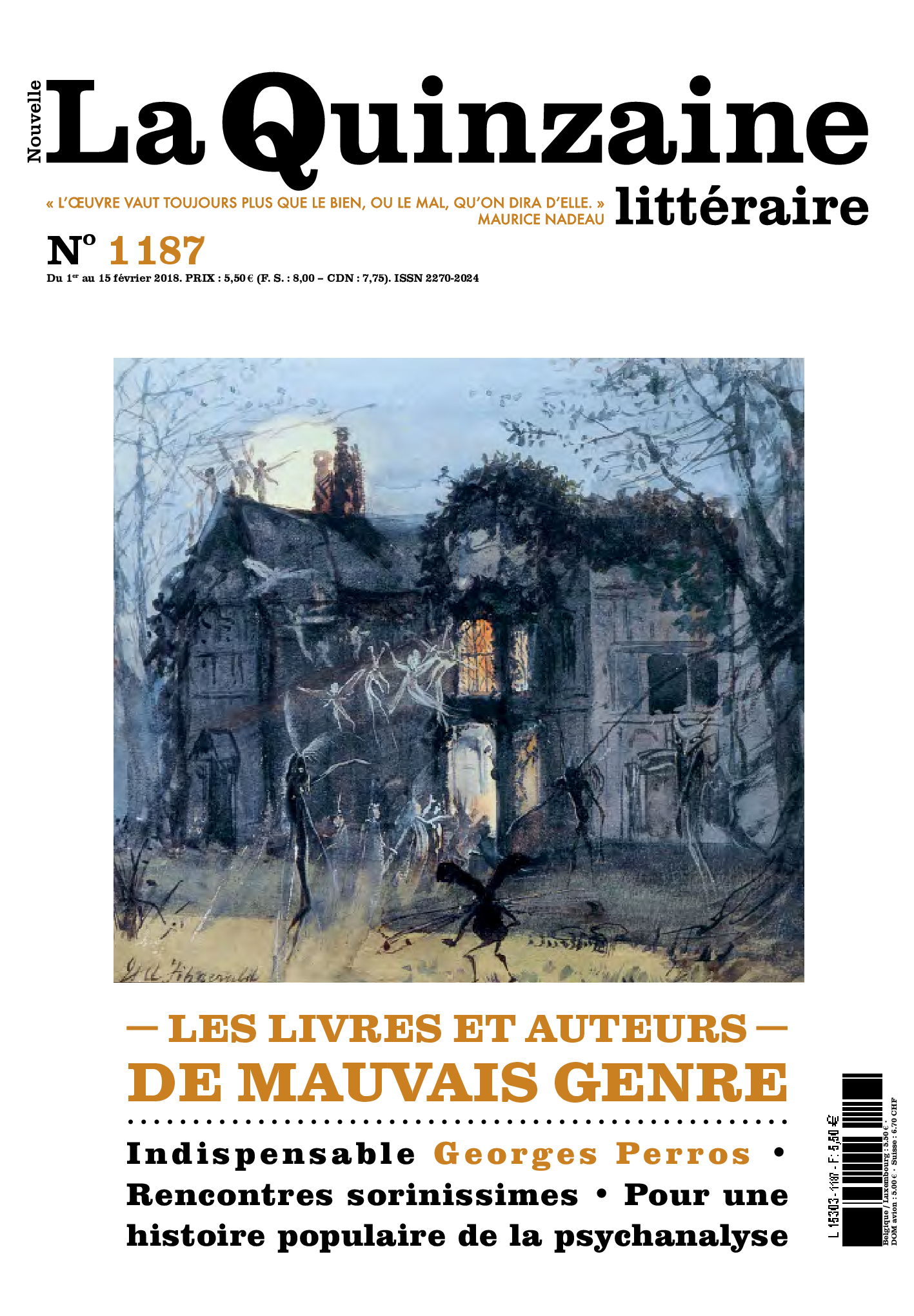

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)