Claire Olivier : Votre dernier livre publié, Made in China (2017), s’ouvre sur un lien renvoyant au film The Honey Dress, dont le tournage constitue une part importante de votre récit. Comment considérez-vous cette articulation ?
Jean-Philippe Toussaint : Au-delà du fantasme de sortir physiquement des limites du livre qu’on est en train d’écrire, l’idée qui m’intéressait dans Made in China, c’était de faire surgir, comme par magie, de la musique des pages d’un livre. Il y a quelques années, il était impossible de faire surgir de la musique d’un livre. Mais c’est devenu techniquement possible aujourd’hui. Dans le livre numérique de Made in China, à quelques lignes de la fin, la musique se déclenche toute seule, et le film The Honey Dress commence sous les yeux du lecteur devenu spectateur. L’ensemble du dispositif n’est évidemment possible que dans un format numérique.
CO : Avez-vous eu connaissance de la manière dont votre lectorat s’est emparé de cette proposition qui établit un lien entre le texte et la vidéo ?
JPT : J’ai eu quelques réactions de lecteurs, mais l’essentiel des témoignages qui me sont parvenus provient d’amis écrivains. Made in China est la chronique du tournage d’un film en Chine, c’est aussi le portrait de Chen Tong, mon éditeur chinois, mais c’est surtout un livre qui parle du travail de création, à la fois de la création littéraire et de la création cinématographique. Il poursuit en quelque sorte l’élaboration d’un art poétique que j’ai commencé à définir dans L’Urgence et la Patience. À défaut d’avoir trouvé un large public, c’est un livre qui a particulièrement intéressé les écrivains.
CO : Made in China permet à plus d’un titre d’entrer dans les « coulisses » de la création. À plusieurs reprises, du reste, vous avez affirmé votre goût pour les « coulisses » ; on peut considérer également que la publication de votre essai L’Urgence et la Patience (2012) participe d’un éclairage de votre pratique. Pouvez-vous préciser quelle visibilité l’écrivain doit-il, selon vous, donner à son travail ?
JPT : Je pense que si l’écrivain peut, et a même intérêt, à demeurer dans l’ombre, son travail a vocation à rechercher la visibilité et la lumière. Je peux concevoir qu’un écrivain ne souhaite pas livrer les coulisses de son travail. Mais, pour ma part, j’ai toujours eu la curiosité d’aller voir derrière le rideau. Cela participe d’ailleurs, je crois, de ce goût que j’ai toujours eu, depuis La Salle de bain, pour le quotidien, le concret, le prosaïque.
CO : Dans le catalogue de votre exposition « Livre/Louvre », La Main et le Regard (Le Passage, 2012), vous faites référence à des artistes, Léonard de Vinci, Eugène Delacroix, qui engagent leur réflexion esthétique dans plusieurs domaines. Quel regard portez-vous sur David Lynch, cinéaste, vidéaste, peintre, musicien, chanteur ?
JPT : David Lynch est une référence pour moi. J’ai vu plusieurs fois Mulholland Drive. Je trouve que son travail cinématographique est très stimulant, et sa pluridisciplinarité artistique, fascinante.
CO : Dans L’Urgence et la Patience, comme dans de nombreux entretiens, vous évoquez les écrivains qui « comptent » pour vous : Dostoïevski, Proust, Flaubert, Beckett, Robbe-Grillet, Faulkner, Durrell… Vous ne citez pas d’écrivaines. Pourriez-vous indiquer celles (figures du passé ou plus contemporaines) dont les ouvrages ont retenu votre attention ?
JPT : J’ai dit un jour, dans un entretien, que mon écriture est nourrie des grands classiques de la littérature et que j’écrivais, consciemment, après Faulkner, Proust, Kafka, Nabokov, Beckett, Duras. Je ne citais que six noms dans cet entretien, et je citais Duras. Pour moi, Duras est un phare, au sens de Baudelaire, quand il écrit son poème « Les Phares ». Elle fait partie de ces quelques grands auteurs qui ont compté dans ma vie. J’ajouterais Virginia Woolf, que j’ai découvert tardivement, et que je suis toujours en train de découvrir, d’ailleurs. J’ai lu deux fois La Promenade au phare ces dernières années.
CO : Marguerite Duras a publié plusieurs livres aux éditions de Minuit. Comme vous, elle a réalisé des films, et notamment des films expérimentaux ; comme vous, elle a tenu des chroniques dans différents journaux. Pouvez-vous dire quelle perception vous avez de son travail ?
JPT : Je suis très sensible à la diversité des pratiques artistiques de Marguerite Duras. Duras représente une féminité comme inversée par rapport à celle de Proust. Elle est femme, elle est très féminine, mais elle est aussi très masculine. Je ressens très fort cette violence froide, cette dureté qu’il y a chez elle. Proust est masculin objectivement, c’est un homme, mais sa féminité est très apparente. J’ai toujours été intéressé, comme écrivain, à faire quelque chose de ma propre féminité, et j’ai le sentiment que ma féminité est plutôt du côté de chez Duras que du côté de chez Proust. Il me semble qu’il y a toujours, dans les livres de Duras, quelque chose de sensuel et de sauvage. Plusieurs fois, dans ma propre écriture, et en particulier dans le « cycle de Marie », j’ai essayé de retrouver ce mélange : la sensibilité, la sensualité et, en même temps, la violence, une certaine sauvagerie. Je crois que mon livre où l’on sent le plus cette influence de Duras, c’est Faire l’amour. Mais je ne saurais dire exactement où, peut-être dans certaines phrases, quand je dis par exemple de Marie qu’elle est « imprévisible et fantasque, tuante, incomparable ».
CO : En collaboration avec The Delano Orchestra, vous avez conçu un spectacle intitulé M.M.M.M., qui vous a conduit à lire, à jouer, à incarner votre propre texte sur scène et à présenter au public des images vidéo, notamment issues de Trois Fragments de Fuir. Qu’a pu vous apprendre cette confrontation à la scène ?
JPT : Ce spectacle a été une expérience humaine extrêmement enrichissante. Mais il m’a aussi permis de donner un débouché inattendu aux vidéos que j’avais tournées en Chine ces dernières années, Trois Fragments de Fuir, Zahir, The Honey Dress. Lorsque, avec Alexandre Rochon du Delano Orchestra, on a envisagé de faire un spectacle à partir des livres du « cycle de Marie », j’ai tout de suite pensé que je tenais toutes ces vidéos en réserve. Tout ce travail que j’avais fait un peu au hasard, un peu dans le brouillard, trouvait d’un coup son débouché naturel. Certaines de ces vidéos étaient des commandes précises, dans le cadre d’expositions, à l’Espace culturel Louis-Vuitton ou au Louvre, mais souvent il s’agissait de vidéos expérimentales, que je réalisais sans vrai budget et sans véritable débouché identifié. D’un coup, avec la réalisation du spectacle M.M.M.M., toutes ces vidéos, que j’avais en quelque sorte tournées à l’aveugle, trouvaient leur débouché naturel sur la scène d’un théâtre. Ce qui est très beau dans le spectacle, c’est qu’il est à la fois littéraire, musical, théâtral et cinématographique.
CO : Avez-vous songé à adapter pour la scène certains de vos textes ? Êtes-vous favorable à ce que d’autres – comédiens, metteurs en scène – s’engagent dans cette entreprise ?
JPT : Oui, j’y suis très favorable ! Je n’ai jamais pensé à adapter mes textes moi-même au théâtre, mais je suis ouvert à toutes les expériences. J’ai toujours aimé que la forme génère de la forme, qu’une forme littéraire puisse donner naissance à une forme cinématographique, à une forme théâtrale ou à une forme musicale. J’aime l’idée que mes livres puissent être le point de départ de projets pour d’autres créateurs. J’aime que de la forme naisse de la forme. Je suis sensible à l’appel de la forme !
CO : Pierre Michon, avec qui vous avez des échanges, comme en atteste votre site Internet, est de ceux qui vantent les vertus de la commande, de la sollicitation extérieure. Vous avez répondu, de votre côté, de manière favorable à la proposition du MoMA et des éditions Take 5 de collaborer avec Annette Messager, ce qui a permis la publication du livre d’artiste Enveloppe-moi (Take 5, 2013). Dans quelle mesure considérez-vous que la « commande », entendue dans un sens très large, est une nécessaire émulation créatrice qui invite à un dépassement ?
JPT : Pendant très longtemps, j’ai rechigné à l’idée d’écrire des textes de commande. La première fois que j’ai accepté, c’était pour accompagner une nouvelle traduction d’À la recherche du temps perdu au Japon, qui devait paraître chez Shūeisha, mon éditeur japonais. Il y avait un contributeur par volume. C’était un très beau projet, mais cela m’a donné un mal fou. Par la suite, j’ai commencé à accueillir l’idée plus favorablement. Je ne le regrette pas, cela m’a permis de faire de très belles rencontres, en particulier avec des artistes. Vous évoquez le livre avec Annette Messager, mais j’ai aussi écrit des textes autour du travail d’Ange Leccia ou d’Adel Abdessemed. J’ai eu les pupilles brillantes et les papilles comblées de faire un portrait de Pierre Gagnaire. Le dernier projet qui m’a occupé récemment, c’est un regard subjectif porté sur les gravures sur bois de Félix Vallotton pour un livre à paraître prochainement aux éditions Martin de Halleux. À chaque fois, j’entre dans un univers différent, que j’explore, revisite ou découvre. Cela a quelque chose de stimulant, de tonique et de régénérant.
CO : Vous avez choisi de placer, au seuil de votre recueil Football (2015), une singulière épigraphe : « Voici un livre qui ne plaira à personne, ni aux intellectuels, qui ne s’intéressent pas au football, ni aux amateurs de football, qui le trouveront trop intellectuel. Mais il me fallait l’écrire, je ne voulais pas rompre le fil ténu qui me relie encore au monde. » Pouvez-vous commenter cette dernière phrase ?
JPT : La phrase peut en effet sembler énigmatique. Elle évoque, je crois, la tentation de repli sur soi que je sentais naître en moi à l’époque où j’écrivais Football. Elle me rappelle cette phrase ancienne que j’ai écrite dans La Salle de bain : « Je devais prendre un risque, disais-je, le risque de compromettre la quiétude de ma vie abstraite pour – je ne terminai pas ma phrase. » Prendre le football comme sujet d’étude m’a permis de rester au contact du monde, de ne pas perdre le fil avec l’époque. Même si le sujet apparent du livre est le football, son enjeu réel et clandestin, c’est mon rapport à la littérature. Il y a une unité secrète dans ces trois livres, L’Urgence et la Patience, Football, Made in China, qui constituent un triptyque caché, où j’essaie de définir mon art poétique.
CO : Quel regard portez-vous sur votre œuvre, de l’écriture de La Salle de bain à celle du roman sur lequel vous travaillez ? Distinguez-vous des phases, des périodes, des moments de rupture, ou, au contraire, mettriez-vous en avant une forme de continuité ?
JPT : La difficulté, c’est de parvenir à la fois à se renouveler et à écrire toujours le même livre. Je n’aime pas beaucoup l’idée de période. Mais c’est vrai qu’il y a une grande unité de ton dans mes premiers romans. Au moment de La Salle de bain, je proposais une littérature centrée sur l’insignifiant, le banal, le quotidien, que j’essayais de traiter sur un mode décalé et humoristique. Il y a aussi une grande cohérence de tonalité dans mes derniers livres, plus sombres, plus mélancoliques. À l’idée de période, je préfère l’idée, plus sinueuse, de courant, des eaux qui se mélangent, chaque livre interagissant avec les autres. Il me semble qu’il y avait déjà, en puissance, beaucoup d’éléments du « cycle de Marie » dans mes premiers livres, et en particulier dans La Salle de bain ou L’Appareil-photo : l’obsession de l’eau, la nuit, l’amour, la mélancolie, le temps qui passe, invisible, et en même temps destructeur.
CO : Votre site Internet existe depuis une dizaine d’années. Correspond-il à la forme que vous souhaitiez élaborer ? Que représente-t-il pour vous ?
JPT : Ce que je recherchais dans ce site, c’était de trouver une forme spécifique à Internet pour le vaste corpus de textes, de photos et de vidéos dont je dispose. Le site est une réalisation collective que nous avons créée avec l’informaticien Patrick Soquet. Une de ses plus grandes originalités, c’est de donner mes brouillons en accès libre, un peu comme si les internautes pouvaient se promener librement dans mon ordinateur. Mais ce n’est qu’un exemple, le site recèle bien d’autres propositions.
CO : Comment va Alfred Bruyas ?
JPT : Je vois que mon site Internet n’a pas de secret pour vous. Alfred Bruyas est une création littéraire, je le fais apparaître dans une nouvelle inédite que j’ai écrite dans le cadre du Borges Projet. À défaut d’avoir le même âge que moi (nous sommes tous les deux nés en 1957), le jour de notre rencontre, en 2014, alors que j’ai 56 ans, Alfred Bruyas, lui, par un affolant effet de toupie temporelle ou d’anagramme de nombres, se trouve déjà en 2041 et a 83 ans. C’est une manière pour moi d’aborder la question du double, si chère à Borges. Le Borges Projet est un projet littéraire interactif de mon site Internet, dans lequel nous invitons les internautes à réécrire ou à imaginer le destin d’une nouvelle apocryphe de Borges, L’Île des anamorphoses, dont je parle dans La Vérité sur Marie. Il s’agit de réécrire ou d’imaginer le destin de cette nouvelle disparue de Borges (disparue, et pour cause, car c’est moi qui l’ai inventée). À ce jour, nous avons déjà reçu plus de cent contributions, que l’on peut découvrir en accès libre sur mon site.
Claire Olivier
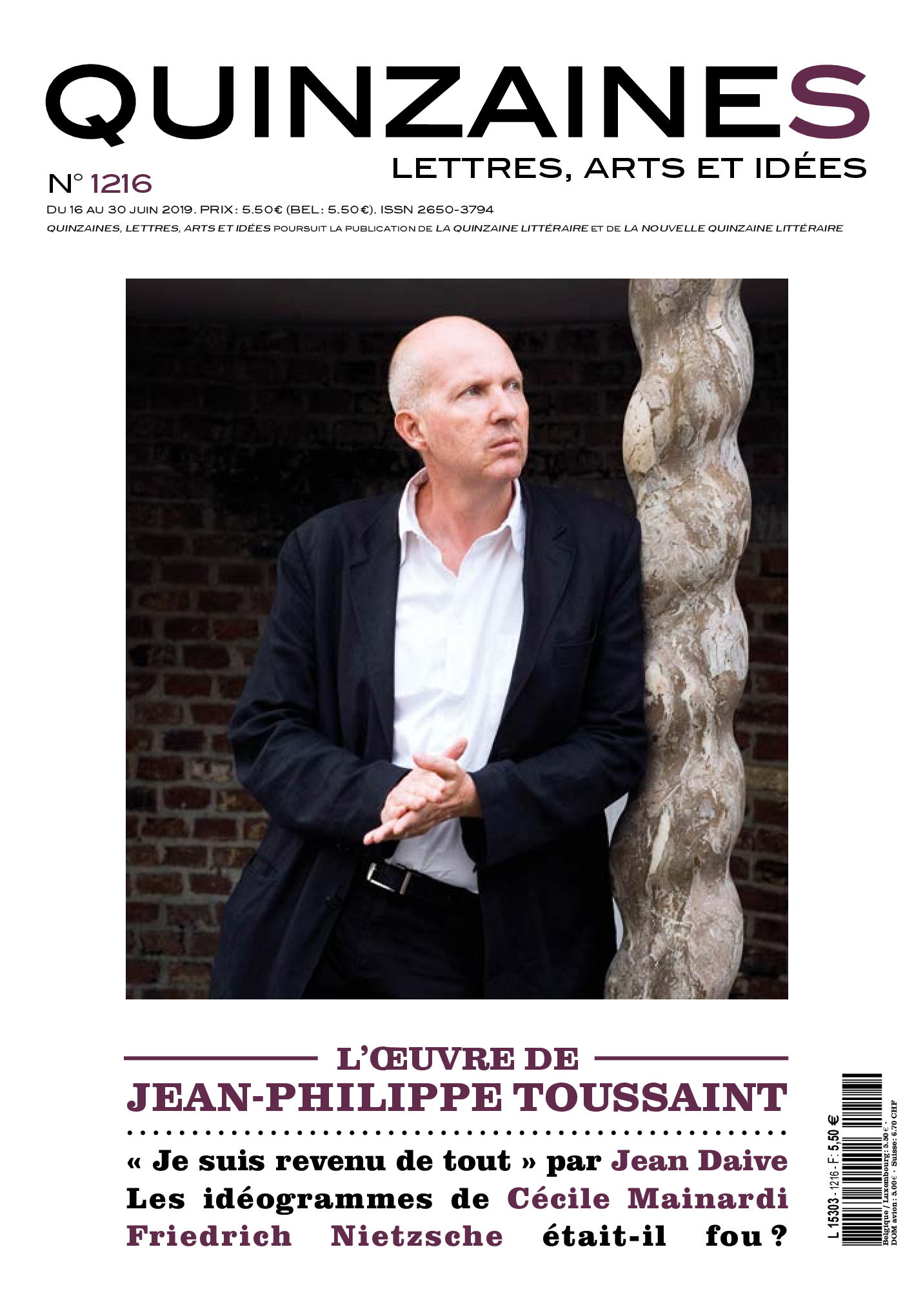

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)