S’il était déjà possible de recomposer la tétralogie du « cycle de Marie » – Faire l’amour (2002), Fuir (2005), La Vérité sur Marie (2009) et Nue (2013) –, il manquait une sorte d’unité formelle. La chambre d’échos que crée le volume unique ne fonctionnait pas encore entre les quatre parties séparées, entre le début de Faire l’amour dans la chambre discordante du grand hôtel de Shinjuku à Tokyo et la chambre nuptiale, mariale, de Nue dans la maison paternelle de l’île d’Elbe, la Rivercina, où a lieu la résolution finale.
M.M.M.M. ne raconte pas qu’une histoire, et nous pouvons en révéler le dénouement sans nuire à sa portée. Un livre qui repose sur l’énigme romanesque de son intrigue ne présente guère d’intérêt. Une fois qu’on en a percé le secret, la baudruche se dégonfle et l’écriture se délite. Or Toussaint, dans M.M.M.M., plus qu’une histoire, crée des mondes dans lesquels résonne le « contemporain », de Tokyo à l’île d’Elbe, en passant par la Chine, d’où la force particulière de ce livre.
M.M.M.M est le récit d’une joute amoureuse qui laisse peu de place aux autres personnages, à l’exception de Zhang Xiangzhi et de Li Qi (Fuir) ou de Jean-Baptiste de Ganay, le rival. Marie, Marie Madeleine Marguerite de Montalte, qui n’est jamais décrite physiquement, est une artiste contemporaine et styliste de mode qui dirige l’agence Allons-y Allons-o (clin d’œil à Pierrot le fou de Jean-Luc Godard), mais son appartenance sociale et la reconnaissance que celle-ci lui procure ne sont pas ce qui la caractérise réellement. Derrière ce masque (persona) se dissimule une autre femme, un visage multiple et complexe de femme qui pleure comme une Madeleine, qui effeuille sa passion comme une Marguerite ou qui porte la noblesse d’un père solitaire dans sa retraite de l’île d’Elbe, Montalte. Quant au narrateur, on ne sait rien de lui. Il est l’amant, l’aimé de Marie. On pourrait presque utiliser les concepts analytiques jungiens pour définir le chassé-croisé de leur face-à-face : le narrateur est l’anima, la part féminine de Marie, et Marie, l’animus, la part masculine du narrateur. Autour d’eux gravitent principalement les collaborateurs de Marie (dont Zhang Xiangzhi), Li Qi, la jeune femme avec qui le narrateur a une aventure, et Jean-Baptiste de Ganay, un riche promoteur de courses hippiques avec qui Marie a également une aventure. L’un et l’autre, Li Qi et Ganay (que le narrateur prénomme Jean-Christophe), servent de catalyseur à l’éducation sentimentale que constitue M.M.M.M.
Le nœud chronologique se serre, se resserre, dans la chambre du grand hôtel de Shinjuku à Tokyo. Là, les deux amants se séparent ; leur histoire, qui avait débuté sept ans plus tôt, semble se terminer. Le livre commence par une fin. Toussaint a agencé son livre en saisons, des saisons qui seraient des collections, comme on dit dans la mode « collection hiver », « collection été »… La première saison est donc une collection d’hiver. Marie et le narrateur se quittent parce qu’en faisant l’amour leur amour se défait, parce qu’ils ne font plus que l’amour et qu’ils ne s’aiment plus (première partie). Ensuite, nous revivons l’été précédant la séparation, en Chine, quand le narrateur rencontre Li Qi. À l’instant même où ils essaient, dans une position plutôt inconfortable, de « faire l’amour » dans la cabine des toilettes du train entre Shanghai et Pékin, le téléphone portable du narrateur retentit et Marie lui annonce que son père est mort. La nouvelle précipite ainsi leurs retrouvailles à l’île d’Elbe pour les obsèques (deuxième partie) – des retrouvailles endeuillées qui n’empêcheront pas la rupture latente de Tokyo. Dans le printemps et l’été qui suivent l’hiver japonais, Marie (avec Ganay) et le narrateur (avec une autre Marie) font l’épreuve de leur désamour. Toussaint inverse l’ordre de succession. Nous sommes tout d’abord en été, un été caniculaire pendant lequel Jean-Baptiste de Ganay meurt d’une crise cardiaque, alors qu’il était dans l’appartement de Marie, et nous apprendrons plus tard, rétrospectivement (dans La Vérité sur Marie et dans Nue), ce qu’il s’est passé auparavant durant le printemps. Et puis, de nouveau, l’île d’Elbe va réunir les deux amants, le narrateur demeurant pour Marie l’appui inébranlable dont elle a besoin, surtout après la mort de son père et l’accident tragique de Jean-Baptiste de Ganay. Quelque chose brûle, les brûle à l’image du « grand incendie » qui a lieu sur l’île cet été-là (troisième partie). Enfin, l’automne arrive, un automne qui s’étire et qui dénude les réticences tenant à distance Marie et le narrateur. Maurizio, le vieux gardien de la maison paternelle, décède et, pour une dernière fois, ils vont retourner ensemble sur leur île, cette île d’Elbe qui les aimante. Un an s’est écoulé depuis la séparation de l’hiver japonais et, à proximité du petit cimetière de Portoferraio, Marie annonce au narrateur qu’elle est enceinte. Ils avaient encore fait l’amour en désespoir de cause après l’incendie de l’été, et le voyage d’hiver s’achève par une renaissance italienne que Toussaint compare à une Annonciation de Botticelli, l’Annunciazione di Cestello, qui est au musée des Offices de Florence. Il a choisi cette représentation, commente-t-il, en raison de la « réticence » que la Vierge exprimerait : plus un Noli me tangere christique qu’un geste de recueillement traduisant l’état d’esprit de Marie, l’état d’esprit des incessants refus qui déchirent la trame de M.M.M.M (quatrième partie).
Si l’écriture, au départ, a été qualifiée de minimaliste ou d’impassible, plus du côté de Beckett, dans M.M.M.M., on est davantage du côté de Proust. Pourtant, on devinait déjà, dans La Salle de bain (Minuit, 1985), entre le narrateur et Edmondsson une relation paradoxale (les piques du jeu de fléchettes ?) que portera à son comble la tétralogie. De plus, Toussaint n’a pas entièrement abandonné sa très fine ironie : de légères touches produisent dans la narration une subtile distanciation. Après l’errance dans les rues de Tokyo qui mène à la séparation, lorsque le narrateur enfonce son doigt dans le « trou du cul » de Marie, nous lisons une façon dérisoire de ponctuer l’impasse, le cul-de-sac de leur amour qui se défait, plus qu’il ne se fait. L’érotisme, chez Toussaint, à la différence de trop nombreux romanciers contemporains, ne cède jamais à la facilité pornographique. Marie est une femme dont la consistance résiste à la fantasmagorie masculine. Avec M.M.M.M., le narrateur sort de sa salle de bain pascalienne, éteint sa télévision. On pénètre dans des zones inexplorées, l’écriture gagne en ampleur et en sensualité. Quand Marie et le narrateur, à la fin de la troisième partie, enfantent sans le savoir le fruit de leur amour après l’incendie sur l’île d’Elbe, Toussaint souligne que Marie apparaît, devant le narrateur, dépouillée de « sa dimension imaginaire pour s’incarner dans le réel », « en réalité de chair ».
L’invention formelle, visuelle, de certaines scènes estune véritable réussite : la méditation aquatique dans la piscine située au sommet de la tour du grand hôtel de Shinjuku (Faire l’amour) ou l’hallucinante chevauchée borgésienne du pur-sang Zahir à l’aéroport de Tokyo et son transfert dans la soute de l’avion comme métaphore indomptable de l’Amour (La Vérité sur Marie). « Dans la nouvelle éponyme de Borges, le Zahir est cet être qui a la terrible vertu de ne jamais pouvoir être oublié dès lors qu’on l’a aperçu une seule fois », note Toussaint.Le défilé au Spiral de Tokyo de la « robe en miel » est une des autres scènes frappantes. À la suite d’un faux pas, une jeune mannequin est piquée de toutes parts par l’essaim d’abeilles qui bourdonnaient autour de la robe en miel. Toussaint ne donne aucune explication à la cruauté de cette scène, véritable art poétique, qui se situe comme dissociée du continuum narratif dans le prologue de Nue. La seule chose que nous savons est que Marie – par souci ou par folie de perfection – a transformé la curée du mannequin en performance artistique. Peut-être l’une des vérités sur Marie ou sur Toussaint lui-même, voire sur les excès de l’art contemporain (l’apiculteur corse convié à participer à la confection de la robe en miel, un dénommé Toussaint Tristani ou Cristiani, lui, assez dubitatif, préfère se retirer de l’affaire).
Il faudrait encore mentionner la savante construction du livre, car, à côté de ces scènes cruciales et de l’agencement qui rythme les amours saisonnières de Marie et du narrateur, Toussaint a ménagé des blancs typographiques pour ponctuer les différents moments qui éclairent l’apprentissage amoureux, de la séparation japonaise à l’annonciation italienne (on en dénombre quatorze, sauf erreur et sans les deux grands blancs de Faire l’amour). Chacun d’eux marque une étape, un progrès ou un recul dans le cheminement chaotique de M.M.M.M., la partie d’échecs entre les « blancs » et les « noirs » que se livrent les deux amants.
Beaucoup d’effusions, jusqu’aux larmes, rapprochent Marie et le narrateur, les ruptures suscitant des étreintes écartelées par des pulsions contradictoires. À plusieurs reprises, notamment lors d’une baignade de Marie à l’île d’Elbe, le narrateur a peur de la perdre, éprouvant par là même la vieille terreur antique d’Orphée et Eurydice. Quand Marie et le narrateur se retrouvent par hasard dans l’hippodrome où doit se dérouler la course avec Zahir qu’organise Jean-Baptiste de Ganay, ils se croisent, impuissants, sur deux escalators opposés : l’un descend (celui du narrateur) et l’autre monte, soulève, enlève Marie avec Ganay « vers l’Hadès » (La Vérité sur Marie). Autrement, au cours du vernissage au Contemporary Art Space de Shinagawa, où Marie rencontre pour la première fois Jean-Baptiste de Ganay, Toussaint imagine une scène très rocambolesque, quasi stendhalienne. Le narrateur est caché sur le toit du musée et observe par un hublot les invités. Parmi ceux-ci, Marie, à qui, parvenant à lire sur ses lèvres, il adresse un pathétique « je t’aime » : « Je t’aime, Marie, lui dis-je, mais aucun son ne sortit de ma bouche… » (Nue). Toutefois, leur amour n’est pas sans violence (en arrière-fond de l’annonciation virginale sur l’île d’Elbe, on respire par exemple les relents âcres d’une chocolaterie qui vient de brûler). Nous sommes avertis dès l’incipit de M.M.M.M. avec le flacon d’acide chlorhydrique que le narrateur garde sur lui dans l’idée de le jeter « à la gueule de quelqu’un » et qui pulvérise une pauvre petite fleur à la fin de Faire l’amour. À Marie Desplechin, Toussaint répondait qu’il cherchait à créer une « énergie romanesque pure[1] ». Tel est bien ce que le lecteur expérimente et ce que communiquent justement les quatre parties maintenant réunies, une énergie, parfois violente, et une pureté qui emportent la lecture, qui ne la lâchent plus ; une énergie et une pureté que conjugue Marie et qui subjuguent le narrateur.
Marie rappelle lointainement la femme souveraine, la reine, la domina de la poésie courtoise ; elle est encore une amazone qui assiste impavide, vêtue en cavalière, aux obsèques de son père ou qui, à l’instar du pur-sang Zahir métamorphosé en Pégase, réduit à néant la Chimère. Mais il y a aussi en elle une fragilité, une émotivité de larmes qui lave les impuretés de l’amour et qui attend son saint Georges pour qu’il la délivre du monstre la retenant prisonnière. De même, par son nom, Marie évoque naturellement une idée de virginité, celle qui finit par se révéler dans les ultimes pages du roman. D’elle, Toussaint dit qu’on pourrait parler de disposition océanique : « Marie avait ce don, cette capacité singulière, cette faculté miraculeuse, de parvenir, dans l’instant, à ne faire plus qu’un avec le monde, de connaître l’harmonie entre soi et l’univers, dans une dissolution absolue de sa propre conscience. » D’elle, comme l’indique l’exergue de M.M.M.M. en référence à la Vita nova de Dante, si Toussaint n’a pas dit ce qui jamais ne fut dit d’aucune, il aura dit ce qui rarement, dans le roman français au tournant du XXIe siècle, se dit d’une femme.
[1]. Cf. Le Monde daté du 18 septembre 2009. Repris dans le livret d’« entretiens littéraires » qui accompagne la publication de M.M.M.M.
Apostille : nous signalons la création du spectacle Marie Madeleine Marguerite de Montalte de Jean-Philippe Toussaint et du groupe The Delano Orchestra.
Jean-Pierre Ferrini
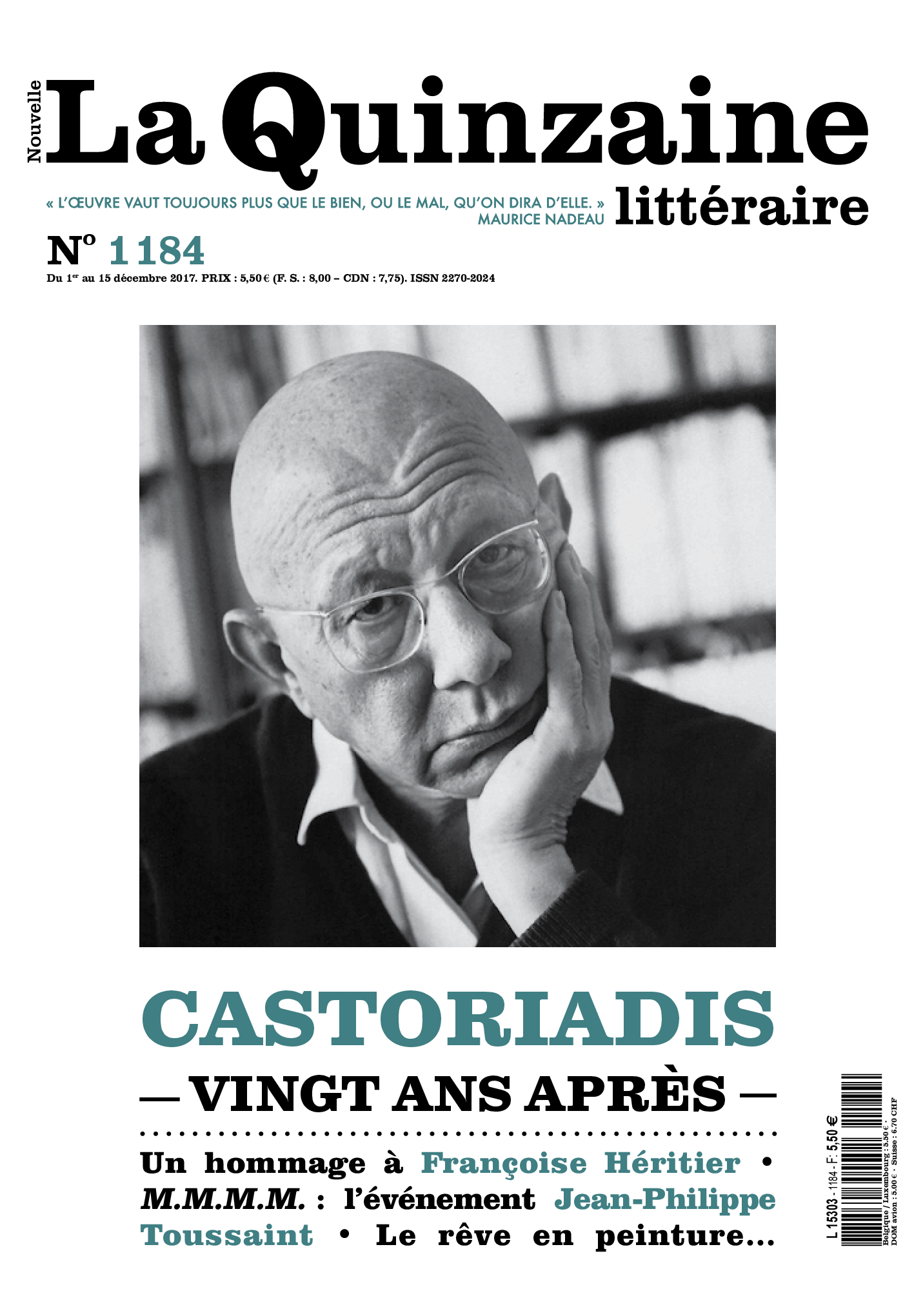

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)