Il n’était pas de la race des prolifiques, Allen ou Mocky, de ceux qui produisent des films comme un pommier ses pommes, annuellement. Douze longs métrages en trente ans, le bilan comptable aurait pu être plus fourni – mais l’économie dispose. Sur ces douze, trois échecs critiques et publics, trois titres quasi inconnus, en tout cas peu vus, et six films inoubliables, que des dizaines de visions n’ont pas usés. On pourrait ne prendre en compte que ces derniers, laisser de côté les ratages, comme on le fait avec certains, oubliant chez Truffaut Une belle fille comme moi pour mieux se souvenir de Tirez sur le pianiste ou jouant chez Chabrol Betty contre Les Magiciens. Opération impossible avec Demy. S’il était besoin d’un nom pour justifier la vieille « politique des auteurs », on hésiterait entre Resnais et lui. Du sommet au sous-sol, de Lola à Parking, tous ses films lui appartiennent toujours pleinement, comme le silence après Mozart. Pour reprendre le titre du documentaire que lui a consacré Agnès Varda en 1995, il y a bien un univers de Jacques Demy, transparent et compact, avec ses correspondances, ses rimes croisées, ses clins d’œil, ses mythologies internes, ses autocitations, qui permettent de le reconnaître au premier regard, même sous ses aspects les moins favorables. On rechigne devant Trois places pour le 26, ses maladresses, l’explicitation lourde de thèmes jusque-là esquissés/esquivés (l’inceste) – mais pas question de l’écarter du panorama : il a sa place dans le tableau général, au même titre que les chefs-d’œuvre sans taches, Parapluies, Demoiselles ou Chambre en ville.
C’est le parti qu’a pris avec raison Olivier Père, dans le superbe album publié au moment du vingtenaire par les éditions de La Martinière – avant même d’avoir eu ce dernier en main, nous avions souligné il y a peu la beauté de leurs ouvrages sur le cinéma américain, concoctés par Patrick Brion. Celui-ci ne dépare pas la collection : mise en pages et documentation, tout est sous le double signe de la qualité et rareté, jusqu’à la relecture soignée (une seule coquille sur 280 pages). Traiter tous les films avec le même souci, présentation, analyse, anecdotes, permet de donner une place qu’ils occupent rarement aux quelques titres négligés, comme Le Joueur de flûte (1972), recréation inventive du bas Moyen Âge allemand dans laquelle Donovan, remarquable chanteur trop oublié, menait rats et enfants à la rivière, ou Lady Oscar (1979), demeuré inédit des années durant et sorti à la sauvette, troublante variation sur l’éonisme, adaptation, trente ans avant la mode, d’un manga japonais que Demy a intégré sans effort à son univers. Sans oublier La Naissance du jour, téléfilm de 1980, peut-être la plus juste représentation du monde de Colette à l’écran, et une des plus sensibles interprétations de Danièle Delorme, modulant sa partition.
Les amateurs anciens n’apprendront rien qu’ils ne connaissent – mais retrouver ce qui a fabriqué l’étoffe de nos rêves, Lola, « qui rit à tout propos/Et qui dit l’amour c’est beau », définitivement confondue avec l’image de Nantes, les éblouissantes jumelles rochefortaises, les robes couleur de lune de Peau d’âne et la nudité masquée sous sa fourrure de Dominique Sanda dans le passage Pommeraye, est un antidote à la tristesse de l’époque. Chaque film de Demy s’est inscrit dans un moment de notre histoire, il est rassurant de vérifier qu’aucun ne s’est perdu dans le bruit de cataracte du temps.
Dans un plan de Lola, un cinéma nantais affiche Retour au paradis (1), Gary Cooper dans le Pacifique Sud, à Matareva. Lorsque Michel Boujut débarque à Paris, le 13 mai 1961, choisissant la désertion plutôt que de rejoindre son régiment en partance pour l’Algérie, les journaux annoncent la mort de l’acteur. Le lien est ténu, mais effectif. Quoique nés à dix ans d’écart, le cinéaste et le critique font partie des générations que Coop a guidé sur les chemins de l’aventure, en lancier du Bengale, sergent York, Dr. Wassel ou shérif Kane seul contre tous. Sa disparition coïncide pour le jeune soldat réfractaire à un basculement de destin : refuser de porter les armes était une action rien moins que confortable en cette période guerrière, qui contraignait à la clandestinité et à l’exil, et ils ne furent pas si nombreux ceux qui prirent ce chemin. L’éloignement amoindrit les reliefs du paysage, mais en ce début des années 60, le camp de l’anti-France n’était pas bien considéré, et c’est une litote, par un pays encore majoritairement derrière ses dirigeants – sinon, le Manifeste des 121 n’aurait pas créé tant de remous. Ce n’est pas sur un coup de tête que Boujut déserte, il a été nourri aux bonnes sources par son père le poète (2), a lu les bons ouvrages (La Permission, de Daniel Anselme, les premières publications de François Maspero) et recherche le contact avec les réseaux Jeanson – ou ce qu’il en reste après le procès du septembre précédent.
En attendant de pouvoir être pris en charge par la filière qui lui permettra de quitter la France, il se cache, et comment mieux se cacher à Paris que dans les cinémas ? Les salles multiples n’avaient pas encore colonisé le Quartier latin et en quelques sauts de puce, on pouvait passer d’un écran à l’autre, une vingtaine, sur six arpents du 5e arrondissement. Quinze jours ailleurs, donc, dans la pénombre permanente du Celtic, du Bonaparte, du Boul’Mich’, du Cluny, du Latin, lieux transformés depuis en mangeoires collectives ou en marchands d’habits, à engloutir ce que l’on pouvait découvrir en cette furieuse période, Hiroshima mon amour, À bout de souffle, Shadows, La Dolce Vita, Quand la ville dort, Les Contes de la lune vague ou La Fille à la valise, de Valerio Zurlini – on en passe. Ingérer autant de chefs-d’œuvre en un temps aussi court ne peut avoir que deux conséquences : l’overdose fatale (on n’en peut plus et on fait carrière dans l’épicerie) ou l’éblouissement durable. Réfugié à Lausanne, ville déjà recommandable pour les cinéphiles, grâce à Freddy Buache et sa cinémathèque, Boujut entama le trajet que l’on sait – critique, introducteur du nouveau cinéma suisse en France, chroniqueur à Charlie-Hebdo lorsque celui-ci marchait encore la tête haute, spécialiste ès jazz (3). Ce n’est pas parce que l’on reste familier de ces quelques aspects du passé, que le souvenir de la librairie La Joie de lire ou de l’odeur de l’escalier du Studio-Parnasse nous émeuvent encore, que ce court ouvrage nous a si fort retenu. C’est par la justesse du ton adopté, sans nostalgie ni posture, la manière vagabonde avec laquelle Boujut explore sa préhistoire et la puissance des fantômes qu’il réveille – toutes choses capables de toucher les lecteurs innocents, et pas seulement les survivants qui, comme il est dit dans Panégyrique, tome I, « entre la rue du Four et la rue de Buci, où leur jeunesse s’est perdue, en buvant quelques verres, ont pu sentir avec certitude qu’ils ne feraient jamais rien de mieux »…
- Signé Mark Robson, 1953. Le même Robson dont l’affiche des Ponts de Toko-ri (1955) surgissait dans Les Herbes folles de Resnais, l’an dernier. Cet honnête réalisateur n’imaginait sans doute pas une telle pérennité.
- L’Association des Amis de Pierre Boujut et de la Tour de Feu (11, rue Laporte-Bisquit, 16200 Jarnac) publie un très intéressant bulletin, Les Feux de la Tour.
- Et amateur éclairé de Bob Dylan, ce qui couronne l’ensemble.

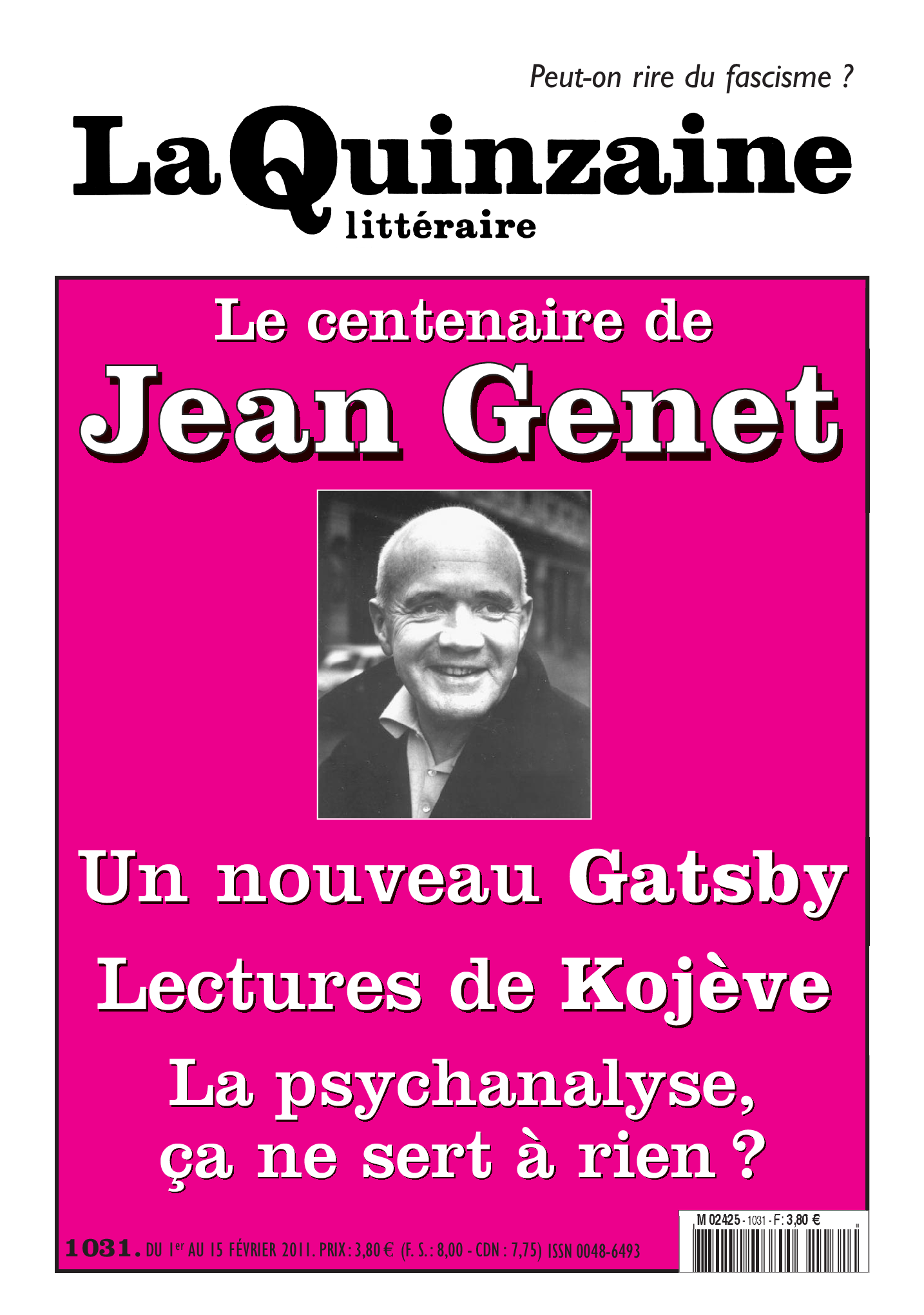

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)