On a sans doute oublié aujourd’hui quelle fut l’aura de Louise Michel en son temps. De son vivant même, elle fut héroïsée. Hugo lui consacra un poème, Viro major (« plus grande qu’un homme »),dans L’Année terrible, où il célèbre « Ton oubli de toi-même à secourir les autres » ;Verlaine lui rendit hommage, de même que Rimbaud (« Jeanne-Marie a des mains fortes, / Mains sombres que l’été tanna […] Sur le bronze des mitrailleuses / à travers Paris insurgé »). Sa mort donna lieu à d’impressionnantes manifestations, avec plusieurs milliers de personnes qui suivirent ses funérailles.
Les Mémoires de Louise Michel parurent en 1886, la même année que L’Insurgé de Jules Vallès. Quinze ans après les massacres épouvantables de la « semaine sanglante », le temps était venu de faire un bilan, pour léguer à l’histoire la mémoire des acteurs et témoins. C’est d’ailleurs pourquoi il s’agit véritablement de « mémoires », et non d’autobiographie : les souvenirs personnels sont constamment tissés dans la relation des événements collectifs. Le texte équilibre en écho une voix émouvante et souvent poétique, nourrie des souvenirs d’enfance, avec le récit historique d’un témoin privilégié, soutenu par le ton pamphlétaire de la militante.
La participation de Louise Michel aux combats de la Commune est racontée par elle-même avec une sorte de détachement tranquille qui refuse autant le pathos que l’autoglorification : « Il n’y a pas d’héroïsme, il n’y a que le devoir et la passion révolutionnaire dont il ne faut pas plus faire une vertu qu’on n’en ferait une de l’amour ou du fanatisme. » Sa participation aux combats n’est jamais présentée comme un engagement risqué ; seulement le prolongement d’une conviction enracinée. Fidélité à soi qui est aussi une fidélité aux autres, les laissés-pour-compte de la société pour qui elle se bat. Les transcriptions de ses interrogatoires au cours de ses procès montrent une fermeté admirable dans la revendication de ses actes. À Versailles où elle est interrogée en 1871, elle répond : « je demandais la République universelle et sociale, et, pour y parvenir, le développement de toutes les hautes facultés » ; « J’ai agi d’après ma conscience et mes convictions » ; « à Issy, je me suis servie d’un sabre pour rallier les fédérés ; à Clamart, j’ai tiré avec le fusil d’un mort, et, à Montmartre, je me suis servie d’un fusil que j’avais ramassé. » Au cours de son procès, le 16 décembre de la même année, elle affirmera : « Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendue ; j’appartiens tout entière à la révolution sociale, et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. »
Au moment de leur parution, un journaliste écrivit de ces Mémoires : « Il y a des passages qui ressemblent à des rocs, d’où jaillit l’espérance comme jaillit l’eau vive d’un rocher » (Eugène Chatelain, juin 1886). C’était, à juste raison, rendre compte de la discontinuité du texte, qui procède globalement « à sauts et à gambades ». Passant d’un souvenir personnel à un développement historique, s’autorisant à intervalles réguliers « encore une parenthèse », il fait éclater l’ordre attendu du discours pour accueillir une émotion ou un souvenir prégnant. On l’a reproché à Louise Michel, sans comprendre que l’unité souterraine de son écriture n’est pas celle de la chronologie, mais celle de la vie sensible et affective, dont l’engagement politique n’est qu’une des composantes. Régulièrement le texte s’ouvre ainsi en flambées d’indignation ou en images soudainement revenues du passé, au rythme saccadé des résurgences visuelles : « Je revois le voyage sur la Virginie […] Je revois dans leurs détails les sites de là-bas. »
L’engagement politique de Louise Michel puise dans une sensibilité au malheur d’autrui dominée par la figure maternelle, sa « pauvre mère » comme elle l’écrit souvent. Les Mémoires s’ouvrent pathétiquement sur un hommage à la mère et à Marie Ferré, amie et victime innocente de la Commune : « Ma mère ! / Mon amie ! / Va, mon livre sur les tombes où elles dorment ! » Le texte se refermera en miroir sur une adresse à ces « mortes bien-aimées » par celle qui se dit « courbée sur la terre où vous dormez ». Autant qu’un livre de souvenirs et un manifeste d’ardeur politique, c’est donc ici un livre de deuil, de pitié et de fidélité douloureuse, comme un « dialogue des morts » qui tente de renouer le lien brisé : « J’ai le mal du pays comme j’ai le mal des morts ». L’écriture se fait stèle, monument funéraire, à la fois hommage et déploration, « tombeau » sans cesse réébauché. La conscience de Louise Michel est hantée par la loi fatale du glissement de toute existence dans le néant. Évoquant ses compagnes d’infortune condamnées à l’exil en Nouvelle-Calédonie et mortes depuis, elle les glorifie dans l’éclat de leur malheur : « Dormez en paix, les vaillantes, sous les cyclones, sous les flots ou dans la fosse commune ; vous êtes les heureuses ! »
Cette fidélité se nourrit de la mémoire toujours vive des années de formation, à Vroncourt en Haute-Marne, où se mêlent les visages aimés et l’amour de la nature. Pour la jeune Louise, « grande, maigre, hérissée, sauvage et hardie à la fois, brûlée du soleil et souvent décorée de déchirures rattachées avec des épingles », la figure maternelle suscite une admiration sans partage pour sa simplicité vertueuse : « Jamais je n’ai vu de femme plus honnête. / Jamais je n’ai vu plus de réserve et de délicatesse ; jamais plus grand courage ; car elle ne se plaignait jamais et pourtant sa vie fut une vie de douleur. » Quant aux images du monde naturel, qui surgissent même au milieu des souvenirs de combat urbain, elles ont rien moins qu’un rôle ornemental. Comme chez Michelet elles donnent à l’aspiration révolutionnaire la caution d’un dynamisme végétal : « Ce n’est pas une miette de pain, c’est la moisson du monde entier qu’il faut à la race humaine toute entière, ses exploiteurs et ses exploités. » Louise Michel ne fait nulle référence aux lectures qui ont pu nourrir sa pensée, son ardeur combattante est portée par un imaginaire qui apparie la libération des opprimés à une loi naturelle, dans « l’accroissement immense de tous les progrès dans la lumière et la liberté ». Dix ans après les événements de la Commune, elle écrira pareillement, dans La Révolution sociale : « Coule, coule, sang du captif ; / Germe, grandis, moisson vengeresse ! » L’indignation porte d’ailleurs tout autant sur la misère des opprimés de la société que sur la situation des femmes (« Gare pour le vieux monde le jour où les femmes diront : C’est assez comme cela ! »),et le sort réservé aux animaux : « toujours la bête muette subit son sort avec la résignation des races domptées ».
Mémorialiste de son temps, Louise Michel embrasse toute la réalité historique des événements dont elle a été à la fois l’actrice et le témoin : elle éclaire, certes en historienne engagée, et par éclats dispersés, les différentes phases et les différents aspects de l’insurrection : le contexte de Paris assiégé par l’ennemi, la veulerie et la traîtrise du gouvernement, l’insurrection qui se répand comme une traînée de poudre aux quatre coins de Paris, les barricades, la défense héroïque des combattants, les incendies, l’arrivée terrifiante des versaillais, les exécutions sommaires et les exécutions d’otages, les arrestations et les comparutions devant les tribunaux, les condamnations à mort et l’exil des déportés en Nouvelle-Calédonie. Ses souvenirs sont accablants pour la répression qui s’abattit sur Paris insurgé. En 1881, dans La Révolution sociale, elle retrouvera le lyrisme révolutionnaire, apocalyptique et incandescent, qui a porté son engagement : « Avez-vous vu sur la Seine, rouge comme une aurore du reflet de l’incendie, couler deux longs ruisseaux de sang ? / Avez-vous entendu les râles de mourants qu’on ensevelissait sous la chaux vive avec les morts ? » À Satory, où les versaillais exécutaient les prisonniers, « on leur mettait sur le dos une pelle et une pioche pour faire leur trou, et on allait les fusiller. / La décharge s’égrenait dans le silence de la nuit. » Ainsi fut assassiné Ferré, condamné à la peine de mort ; après avoir été « sommée de livrer son fils » sa mère mourut folle à Sainte-Anne. Quant aux déportés en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel égrène la liste funèbre de ceux qui « sont restés, tombés, là-bas, dans le grand sommeil », avec les « ombres frêles et charmantes de jeunes filles et de petits enfants ».
Sur le contexte social et politique de l’engagement de Louise Michel, l’ouvrage d’Édith Thomas apporte des compléments d’information très utiles. Les « Pétroleuses » parut d’abord en 1963. Le livre ne trouva alors guère d’écho mais il marque une date essentielle, et même fondatrice, dans le dévoilement et l’étude du rôle des femmes dans l’histoire, comme dans la connaissance de leur participation à la Commune. À partir d’un travail impressionnant sur les archives, qui n’avait jamais été entrepris, Édith Thomas a rendu leur existence à des milliers de femmes anonymes, héroïnes méconnues aux côtés de Louise Michel. Ayant tenu un rôle important dans la résistance intellectuelle de la France occupée, et proche du Parti communiste, son point de vue peut paraître aujourd’hui parfois un peu schématique, notamment quand elle tend à essentialiser la condition féminine. Mais l’ouvrage regorge d’informations éclairantes sur la situation sociale des femmes sous le Second Empire, leurs déplorables conditions de travail, la contrainte du concubinage ou de la prostitution, conséquences obligées de leur statut. On comprend le terme de « pétroleuses » dont on accabla les communardes, accusées souvent à tort d’avoir incendié Paris au moyen de pétrole. Et l’on voit revivre toutes ces inconnues anonymes, « ambulancières, cantinières, soldats », auxquelles elle rend leur nom, leur dignité et leur histoire : « Mme Oudot, du 208e bataillon de Ménilmontant », Honorine Siméon, qui a fait « sous le feu de l’ennemi une corvée de cartouches », Mme de Rochebrune, qui « venge la mort de son mari, le fusil au poing »…
Les Mémoires de Louise Michel ne constituent pas qu’un témoignage sur un moment effervescent et tragique de l’histoire. La voix qu’on y entend est plurielle : celle de la jeune fille qu’elle a été se mêle à celle de l’institutrice, de l’insurgée, de la révolutionnaire anarchiste, de la victime et de l’oratrice. Cette polyphonie est en elle-même une contestation antiacadémique et une revendication féministe. Elle ouvre également la possibilité d’une écriture littéraire, en une époque qui prolonge le « sacre de l’écrivain » dont a parlé Paul Bénichou : ce moment privilégié où la pratique littéraire revendique la même dignité que l’action politique ou la pensée religieuse, et insuffle son ardeur rhétorique aux discours tribuniciens. L’exercice du verbe n’est pas chez Louise Michel l’habillage d’une pensée politique, il lui est consubstantiel, lié à une conviction démocratique : « Pareille au drame, qui n’existe plus sur les théâtres parce qu’il se déroule réel dans les rues avec les foules de la légende nouvelle, la poésie appartient désormais à tous. » Louise Michel émaille son livre de ses propres poèmes ; mais, comme chez Jules Vallès, c’est plutôt dans la prose qu’elle trouve son souffle, l’élan de la phrase se confondant avec l’inspiration révolutionnaire. Aux images élégiaques des souvenirs d’enfance font écho, dans un registre plus soutenu, celles de la Nouvelle-Calédonie, terre d’exil qui lui inspire pourtant des visions nocturnes et fantastiques qui font penser à Hugo (à qui, jeune enfant, elle avait envoyé des vers) : « C’est le vent, les flots, la mer qui, ces jours-là, chantent les bardits de la tempête ! Il semble, par moments, qu’on s’en aille avec eux hurlant avec le chœur terrible. On se sent porté sur les ailes qui battent dans le noir du ciel sur le noir des flots. »
Daniel Bergez
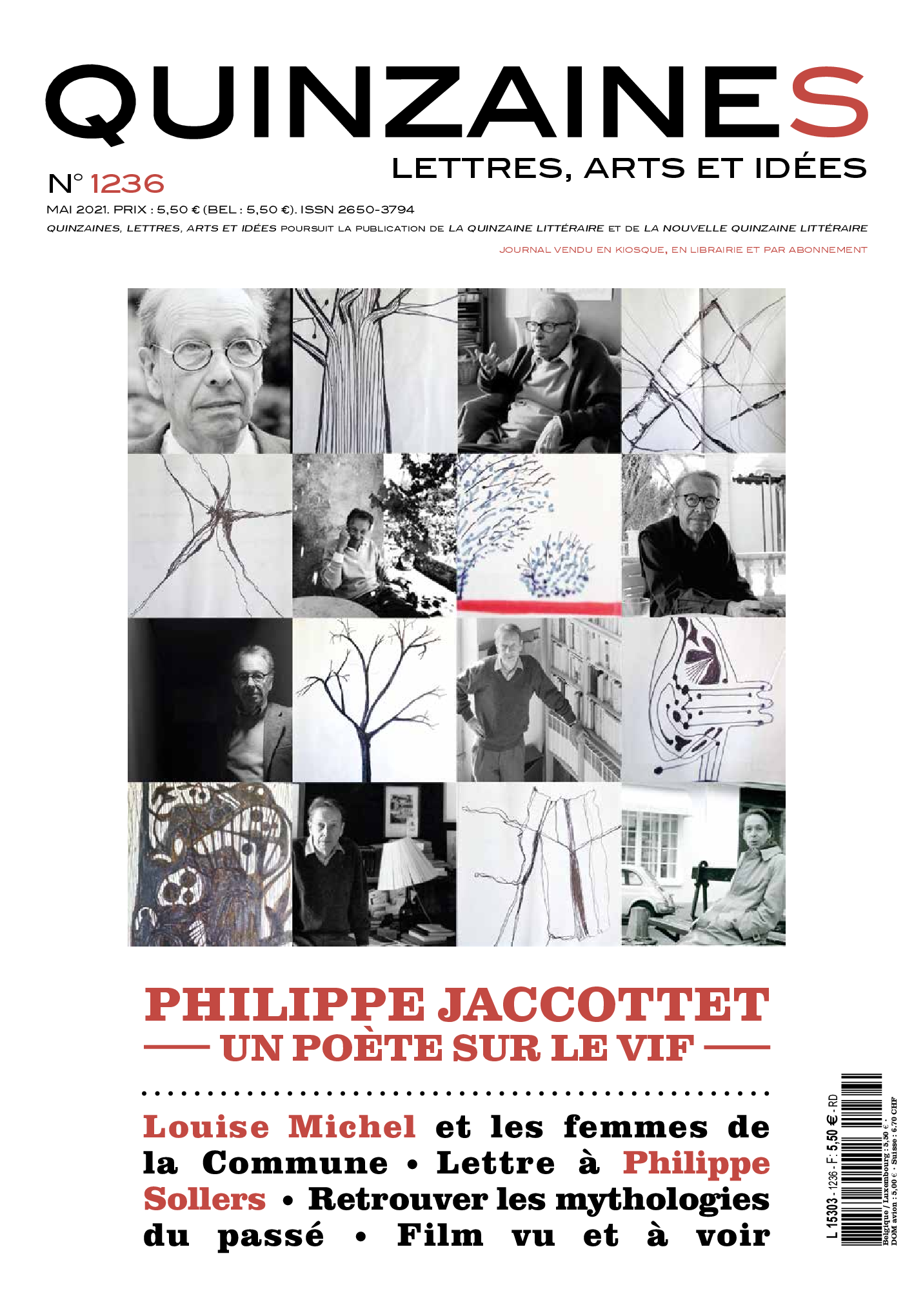

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)