Le recueil traduit comporte six nouvelles dont la parution en revue s’étend sur huit années de la dernière partie de la carrière de Kawabata, couronné quatre ans avant son suicide en 1972. On connaît de lui une déclaration célèbre sur « la traditionnelle tristesse spirituelle des Japonais », unique sujet possible pour un écrivain depuis la défaite de son pays en 1945, ce qui en dit long sur le traumatisme créé par cette défaite et sur la couleur étrangement mélancolique qui imprègne la pensée de l’auteur.
Le Japon moderne, né en 1868 du triomphe paradoxal remporté sur l’Occident colonisateur grâce à une reddition apparemment sans conditions devant la technologie et les valeurs occidentales, s’effondre en 1945. Le rêve impérialiste, soutenu par l’immense majorité des Japonais, aboutit en fin de compte à l’empilement de cadavres déchiquetés par les bombes, une image qui hante l’imaginaire des personnages de Kawabata, et dont la terrible réalité sert de toile de fond aux micro-drames individuels de l’après-guerre.
L’homme encore jeune qui, dans « Première neige sur le mont Fuji », a peur de tomber de nouveau amoureux du corps de son ex-femme (elle a accepté de passer une nuit en sa compagnie près du volcan sacré, symbole même du Japon) use du souvenir de cette image de mort et de putréfaction comme d’un antidote radical à ses bouffées de désir. Il ne se passera donc rien dans la chambre partagée. Transformer, sans avoir recours à aucune phrase explicite, l’histoire somme toute banale de retrouvailles qui échouent en une parabole du destin dépressif d’un pays dévitalisé par le drame collectif qu’il vient de vivre : tout Kawabata est dans cette étonnante capacité à recroqueviller l’immense désarroi d’une communauté entière en un bonsaï de fiction.
Les cinq autres nouvelles sont de la même perfection. Centrées sur la peinture de minuties relationnelles qui, prises au pied de la lettre, semblent se réduire à d’infimes anecdotes mettant en scène des moments de gêne entre personnages empêchés de communiquer librement, elles laissent dériver très loin leurs résonances secrètes. Ainsi le saisissant récit intitulé « En silence » a-t-il pour protagonistes un jeune visiteur mal à l’aise et un vieil écrivain aphasique qu’il s’est fait un devoir – une corvée – d’aller visiter. Dans « Terre natale », le narrateur rêve et retrouve dans son village une série de doubles de lui-même et de ses proches : entre ces figures saisies à différents âges de la vie, le courant passe mal. « Gouttes de pluie » et « Une rangée d’arbres » ont pour décor les appartements de familles aux prises avec de minuscules incidents du quotidien. « La jeune fille et son odeur » a l’air de traiter des raisons de l’attirance sexuelle dans un couple clandestin.
Il faut du temps pour découvrir que le vrai sujet d’« En silence » est l’emprise qu’une femme-serpent, un fantôme, exerce sur son père impuissant, muré par la maladie dans une affreuse dépendance. Du temps pour repérer dans « Terre natale » les traces de l’impossible tentative de réconciliation entre un fils et son père disparu, dans « Gouttes de pluie » le récit biaisé d’une jalousie de femmes, dans « Une rangée d’arbres », texte le plus apparemment anodin de la série, le récit en creux d’une mésentente familiale ayant entraîné l’exil du garçon et celui, mieux dissimulé encore, de l’angoisse des parents à l’idée du mariage prochain de leur fille, après lequel ils seront définitivement seuls.
Quant au dernier conte cruel, sous une trame délicatement érotique, n’est-ce pas le parfum, non d’une jeunesse fleurie, qui s’exhale, mais celui, entêtant et morbide, de l’atmosphère incestueuse entourant les rapports d’un père sans moralité avec sa fille à la peau fragrante ?
Maurice Mourier
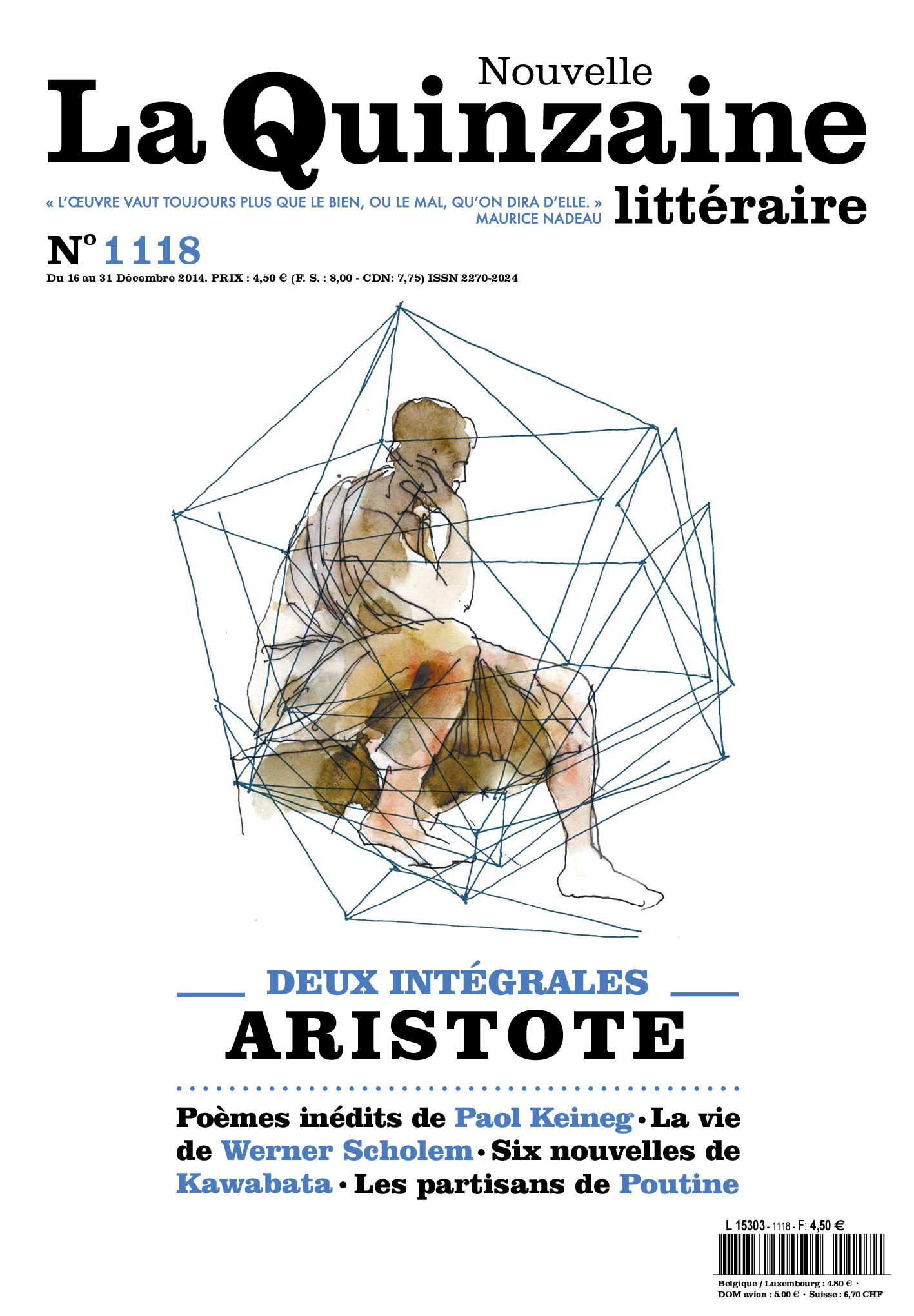

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)