Omar Merzoug : Vous êtes professeur honoraire au Collège de France et vous avez accepté de participer à notre numéro thématique consacré à la critique littéraire, j’aimerais vous demander : comment êtes-vous devenu vous-même critique littéraire ?
Marc Fumaroli : C’est en suivant deux étapes que je suis devenu critique littéraire. J’ai commencé par la philologie, par la lecture attentive, en tenant compte de tout le contexte possible, de textes anciens, remontant au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. S’intercale une étape intermédiaire où j’ai pratiqué la critique théâtrale et où je me suis ingénié en quelque sorte à décider si telle interprétation, telle mise en scène était fidèle à l’esprit du texte ou le trahissait en profondeur, ce qui d’ailleurs se produisait de plus en plus souvent dès les années 1960. La troisième étape a consisté à faire du journalisme, en ayant à l’esprit le modèle inimitable de Sainte-Beuve. Je m’efforçais de faire aimer ou de faire partager le goût que je pouvais avoir pour un livre récemment publié, qu’il s’agisse du reste d’essais, d’ouvrages d’histoire ou de fiction. J’ai aussi été amené à faire des recensions longues, argumentées, méticuleuses même d’ouvrages savants, dans ma spécialité, l’histoire littéraire, l’histoire des idées ou l’histoire tout court dans des revues savantes comme XVIIe siècle ou la Revue d’histoire littéraire de la France ou des revues étrangères comme le Times Literary Supplement de Londres qui tout en étant un magazine à la disposition de tous n’en est pas moins une revue savante. Toutes ces expériences différentes s’adressent à des publics très divers. En somme, la première étape de mon parcours était une étape intra-universitaire : je m’adressais à un public de pairs pour être jugé par mes pairs. Ensuite j’ai écrit pour un public plus large de lecteurs cultivés et j’en suis arrivé à rédiger des articles pour le grand public qui compte beaucoup de personnes intéressées, curieuses, d’amateurs comme on disait au XVIIIe siècle. Ils sont le sel de la terre. Ce parcours entrepris dans tous les secteurs de la critique, m’a fait prendre conscience de l’existence en France d’une véritable schizophrénie entre la critique savante et excellente que l’on trouve dans les revues spécialisées et la critique journalistique qui est d’une facilité, d’une partialité ou d’une superficialité que je trouve vraiment désastreuse. J’évoquais tout à l’heure le Times Literary Supplement, j’aurais pu citer le London Review of books, le New York Review of Books, ce sont des magazines à la portée du grand public et qui sont d’une tenue, d’une qualité, d’une exigence auxquelles les revues savantes elles-mêmes n’auraient rien à reprendre. Voilà des gens qui respectent le public.
O. M. : De grands écrivains affirment parfois que la critique littéraire ne leur apprend strictement rien, que pensez-vous de cette formule ?
M. F. : C’est une formule terroriste, intimidante, c’est aussi une posture que certains écrivains ont adoptée ; c’est probablement vrai en partie, il y a effectivement une certaine hargne journalistique qui est toujours tentée de dénigrer un livre par principe, mais il y a aussi une espèce de servilité journalistique qui est tentée de parler seulement des livres dont par intérêt elle souhaite faire la promotion. Effectivement, il y a un degré de critique journalistique qui est très contestable, mais on ne peut pas enfermer la critique littéraire dans ce genre-là, c’est un genre mineur et tout à fait à dédaigner. Il me semble que nous avons en France une tradition, que Chateaubriand appellerait la critique des beautés. Mais même quand elle n’est pas la critique des beautés au sens où il l’entend, quand elle est chez Sainte-Beuve, une critique beaucoup plus subtile et d’une acuité morale et d’une finesse esthétique exceptionnelles reconnues par Baudelaire notamment, il me semble que là on ait beaucoup à apprendre. Les écrivains eux-mêmes – Sainte-Beuve en était un, souvent sont d’excellents critiques pour les modernes ou même les contemporains. J’en veux pour exemple Michel Butor qui est un admirable critique littéraire dans les trois Répertoires, ou Milan Kundera qui a signé plusieurs recueils de critiques tout à fait excellentes. Mais il me semble que cette sorte d’ostracisme contre la critique savante me paraît insincère et infondé. Il est très important pour la vie de la littérature qu’il n’y ait pas seulement des professeurs de littérature ou des coteries d’écrivains, il faut que des deux côtés se détachent d’excellents critiques qui fassent le pont entre les inventeurs, les créateurs et le grand, le moyen public et le public cultivé.
O. M. : À lire vos travaux, on s’aperçoit qu’à vos yeux la liberté du critique est une condition indispensable à son bon fonctionnement, vous parliez tout à l’heure de Sainte-Beuve et si on prend les quarante dernières années, diriez-vous que cette liberté n’existe plus, qu’elle est menacée par la servilité et l’empressement dont font preuve certains critiques, comment jugez-vous l’évolution de la critique journalistique ?
M. F. : En fait, la critique littéraire en France a été très brillante depuis le XIXe siècle et elle a formé le tissu conjonctif de la littérature vivante. J’ai cité Sainte-Beuve, j’aurais pu citer Charles Du Bos, André Rouveyre un peu trop oublié aujourd’hui, Remy de Gourmont, Thibaudet, et après la guerre encore dans Le Monde, il y avait un rez-de-chaussée imposant occupé tour à tour par Émile Henriot, Pierre-Henri Simon et Bertrand Poirot-Delpech. Je suis très content d’écrire de temps en temps dans Le Monde, organe qui a abrité de grandes signatures. Mais dans l’ensemble la critique actuelle est souvent une critique de coterie journalistique ou littéraire, il manque des magistrats de la critique qui sachent faire l’aller et retour entre la tradition et l’actualité. Tous les noms que j’ai cités, de Sainte-Beuve à Henriot, étaient des magistrats de la critique, ils jouissaient d’une grande indépendance d’esprit, ils avaient sans doute leurs limites, mais ces limites étaient d’ordre spirituel ; ce n’étaient pas des limites à la liberté de leur jugement, il me semble que maintenant les attachés de presse, tout le système de la promotion et de publicité exerce sur la critique dont la mémoire a raccourci une très forte pression et que celle-ci est assez disposée à se laisser manœuvrer.
O. M. : Est-ce que, dans votre travail de critique littéraire, vous vous sentez créatif ? Et diriez-vous que la création est une dimension très importante de l’exercice critique ?
M. F. : Je crois qu’en fait un écrivain travaille sur une matière qui lui est en grande partie donnée – contrairement à ce qu’un vain peuple pense, par les lectures qu’il a faites d’autres écrivains. La littérature s’engendre elle-même. Distinguer entre le travail du critique qui serait secondaire si j’ose dire et presque stérile, à tout le moins négatif, et l’invention et la création qui sortiraient du néant ou d’une subjectivité en éruption, c’est une doctrine erronée. En fin de compte le critique peut très bien aller jusqu’à lire un texte au point de pouvoir le recréer. Je songe à mon ami Citati, voyez son livre récent intitulé Le Mal absolu, son beau livre sur Proust, on a l’impression que c’est parce qu’il a lu à fond Proust, qu’il en a pénétré les différents replis, qu’il peut le reprendre à son compte, le répéter au sens kierkegaardien d’une manière créative, d’une manière qui rend Proust d’autant plus vivant qu’il est animé par une voix qui n’est pas la sienne. Il me semble que là le cercle est clos. Le critique devient créateur et, me semble-t-il, on pourrait inverser le mouvement et dire qu’un grand créateur est nécessairement un grand critique parce qu’il est nécessairement un grand lecteur. J’ai cité Citati, on peut aussi évoquer Kundera, on voit bien que sans Cervantès, sans Rabelais, sans Swift, il n’y aurait pas de Kundera et en définitive il a passé sa vie au fond à nous donner les fruits de son voyage chez Cervantès, Swift ou Rabelais.
O. M. : Vous êtes un spécialiste renommé du XVIIe siècle, mais vous avez consacré nombre de travaux au XVIIIe siècle, qu’est-ce qui d’après vous distingue la critique littéraire telle qu’elle s’exerçait à ce moment-là de la nôtre ?
M. F. : La critique littéraire d’Ancien Régime et du tout début du XIXe siècle, période où Chateaubriand connaît sa gloire, ne peut passervir de modèle. Le journalisme étant peu développé, la critique sous l’Ancien Régime, celle du Mercure de France, est très sommaire, ou systématiquement élogieuse. Dans le Journal des savants, on ne rend compte que de travaux d’ordre historique ou philologique. Dans les périodiques du XVIIIe siècle commence néanmoins avec le genre de la recension-essai, un nouvel âge de la critique et de la littérature. C’est au début du XIXe que la critique s’impose danslesjournaux, c’est le cas de Sainte-Beuve et de Théophile Gautier qui tenaient un feuilleton. Un auteur comme Sainte-Beuve est aussi un romancier et un poète,Théophile Gautier est un dramaturge, un romancier et un poète, ils donnent leurs avissur les derniers livres et même souvent les classiques relus par eux, dans leur perspective. Et là on assiste à l’apparition d’une tradition, qui va perdurer jusqu’à nos jours après la Seconde Guerre mondiale, dans les pays anglo-saxons et même en Allemagne dans les pages dites culturelles de certains de leurs quotidiens, le supplément du Frankfurter Allgemeine Zeitung ou de Die Zeit, née au XIXe siècle, d’une critique journalistique approfondie et digne d’une revue savante. Mais je dois dire que c’est en France que les choses se sont détériorées le plus. À mon avis, l’une des raisons pour lesquelles la littérature française est dans une phase si narcissique, marginalisée et stérile, c’est que la critique n’exerce pas sa fonction qui est de trier et d’aider le public à lire les ouvrages qui le méritent, récents ou anciens. Il paraît de bonslivres maisilssont obombrés par la masse de livres qui ne s’imposent pas et qui néanmoinstiennent une place disproportionnée dans des « suppléments littéraires » qui le sont toujours moins, allant dans le sens de suppléments culturels.
O. M. : Le critique littéraire idéal pour vous, ce serait…
M. F. : Le critique littéraire idéal pour moi, ce serait un homme qui aurait une double vie, deux fois cent ans devant lui. Pendant les cent premières années, il serait critique littéraire et ensuite il deviendrait créateur.
Omar Merzoug
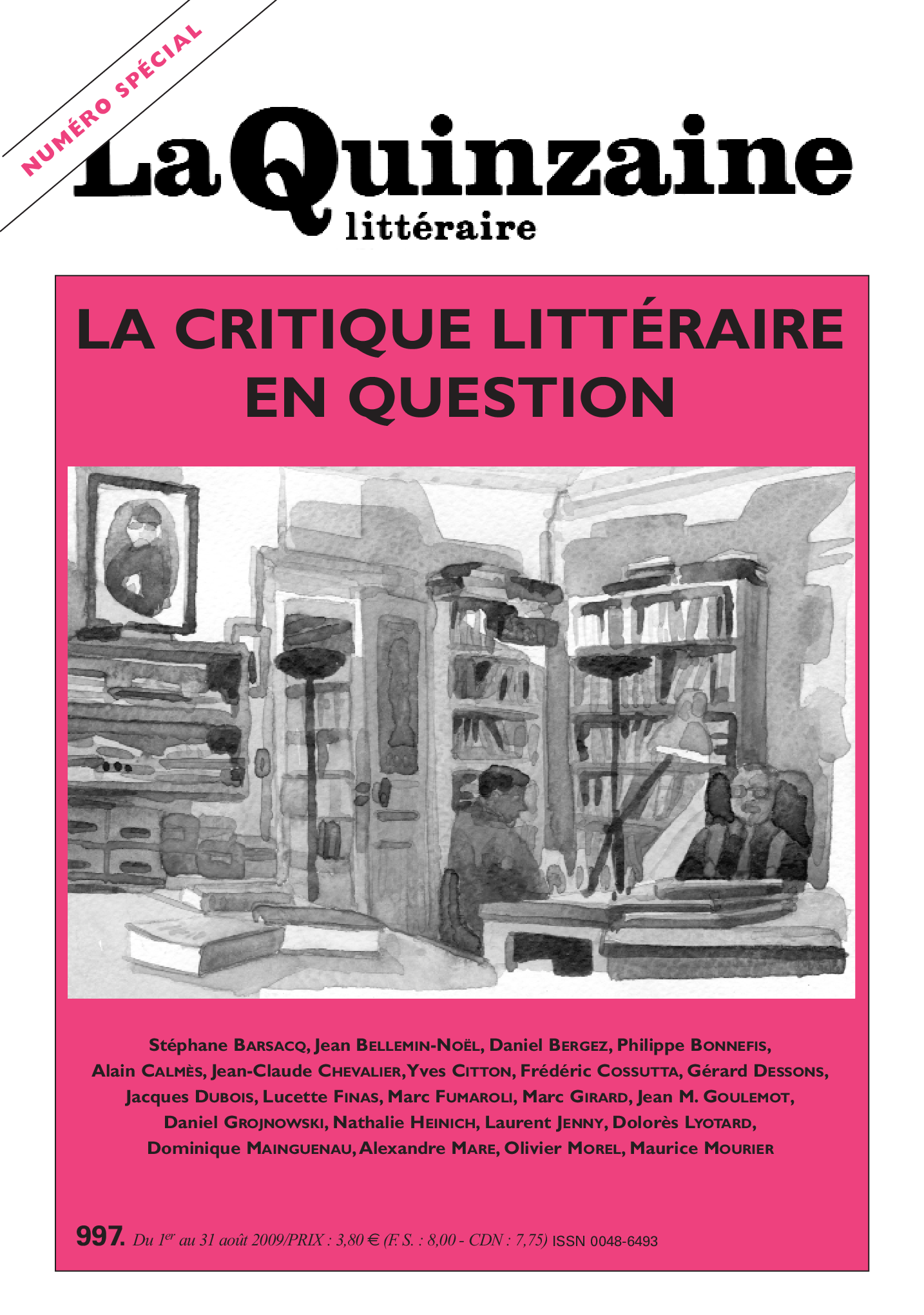

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)