Dans une vie précédente, Joseph Ponthus fut éducateur de rue. Il a raconté dans Nous… la cité son action auprès de quelques jeunes gens et témoigné de leur vie en les aidant à écrire et en contextualisant leurs récits. Rapportant le passage de l’un d’entre eux au tribunal, il écrivait : « Une juge remplaçante débarque et expédie les affaires avec l’habitude du travail à la chaîne, condamne à la louche pour huit mois ferme.1 » Le travailleur social va pouvoir confronter cette image convenue à la réalité du travail à la chaîne dans son nouveau livre.
Su...

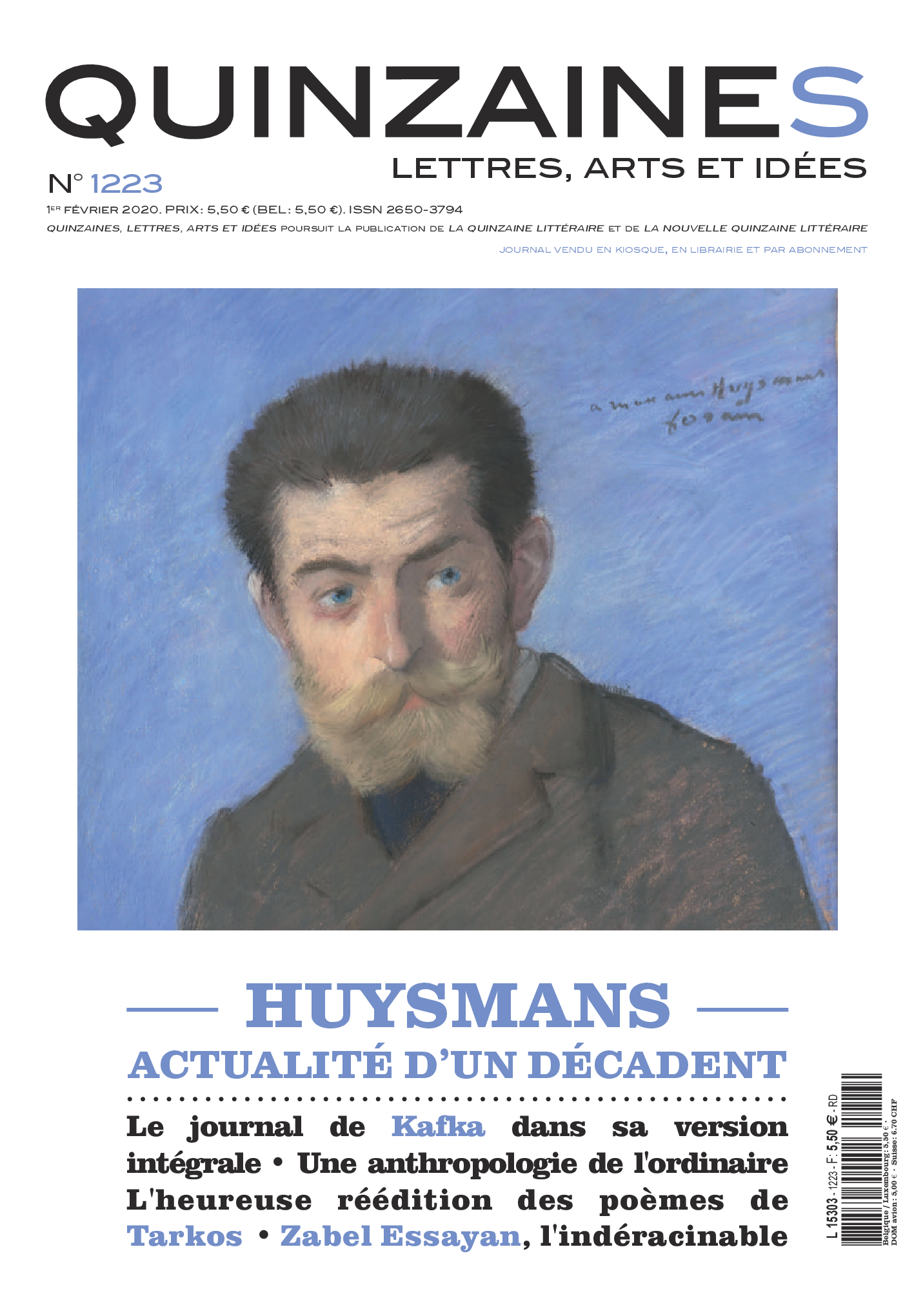

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)