Il suffit de presque rien pour que la mémoire se réveille, que les époques se confondent ou se mêlent. Ce « lac immense et blanc » est l’étendue neigeuse qui s’ouvrait devant la narratrice, ses amis et surtout Antoine, l’homme qu’elle aimait en ces années soixante-trois ou soixante-quatre, avec qui elle militait, sur le plateau de l’Aubrac. On peut choisir un meilleur endroit pour fomenter la révolution ou du moins convaincre les masses. Antoine, Lise et Jean espéraient entraîner les paysans et inventer un monde ; le premier nommé était le plus exalté. La narratrice a perdu sa trace quand l’Histoire semblait leur donner raison en mai 68, ce mois qui « amorcerait l’insidieuse érosion de [leurs] certitudes ». À moins qu’Antoine n’ait disparu pour mener une autre vie, pris par un amour qui le bouleversait.
Une même neige empêche la narratrice de retrouver, à la gare d’Austerlitz, un Italien qu’elle croise chaque mercredi au Café lunaire. Il est originaire de Ferrare, ville qu’elle aime, où elle se sent de fortes attaches et elle voudrait en parler avec lui. Cela ne sera pas possible, et ainsi se déroule la matinée, sous le signe des impossibilités, des rencontres qui n’auront pas lieu, et des souvenirs qui reviennent, s’estompent, puis retrouvent forme grâce à un nom propre.
« Je réinvente ma vie dans le désordre en mélangeant les temps, les lieux, les êtres chers, mais c’est tout de même ma vraie vie », écrit la narratrice. Ce récit s’apparente en effet à une rêverie sur les lieux, sur les êtres, sur les époques. Les fils s’entremêlent, se nouent et se dénouent et le lecteur se laisse prendre à ce tissage subtil, discret. Paris, l’Aubrac solitaire et neigeux, Ferrare, ville de Bassani, d’Antonioni et de Visconti qui tourna Ossessione tout près de la cité romagnole, sont les espaces dans lesquels va et vient la narratrice, physiquement ou par la pensée. La ville italienne apparaît souvent dans l’œuvre de Michèle Lesbre et ce n’est pas un hasard. À côté de villes célèbres comme Venise ou Florence, voire Bologne et Ravenne, Ferrare est à part. C’est une ville secrète que le Roman de Ferrare de Bassani a transfigurée. C’est un dédale propice au songe, au rêve nocturne ou éveillé, à laquelle elle pense « comme à un amour inachevé » : « Quelque chose de moi est resté là-bas, quelque chose d’indéfinissable. » On aime s’y égarer et c’est d’une certaine façon ce que cherche la narratrice. Elle s’y sent très vite chez elle. Sa vraie vie est ailleurs que dans le bureau où l’attend un chef tatillon, soupçonneux. Ailleurs aussi que dans le présent. L’Aubrac est un Temps plus qu’un lieu : le monument dédié à 14-18 le réveille : « Les morts dont les noms figuraient sur les listes devenaient mes morts, quelque chose vacillait en moi et me faisait grandir, comme me faisait grandir l’amour avec Antoine, dans cette campagne isolée du monde. » Et pourtant, nulle nostalgie d’une époque meilleure dans ce récit, non, juste le constat qu’il faut trouver les chemins de traverse. Dialoguer avec un corbeau freux sur un banc du Jardin des Plantes est aussi une façon de suivre sa pente avec légèreté.
Un lac immense et blanc est habité, comme tous les romans de Michèle Lesbre par les livres et les écrivains qu’elle aime et qu’elle lit. Non pour aligner des citations, mais plutôt parce que leurs phrases alimentent les siennes. C’est le cas ici de Marguerite Duras, dont elle évoque Moderato cantabile. Un élément de dialogue qui n’était pas dans le récit apparaît dans le film qu’en a tiré Peter Brook avec la romancière : « Je crois que je n’étais pas faite pour une longue durée de bonheur, je crois que j’étais faite pour vivre de très courts instants, avec certains hommes. » La phrase résonne en elle, et fera écho longtemps, souvent, déterminant sa vie pour partie, après la disparition d’Antoine.
L’Histoire aussi est présente, de façon très indirecte, par des détours et détails, comme la soif de justice d’Antoine, qui affichait dans sa chambre la liste des morts de Charonne pour signifier son horreur, ou bien le souvenir de Laura Betti, comédienne qu’on voyait dans les films de Bertolucci ou de Pasolini. Elle pleure cette mort qui est aussi disparition d’un temps, d’une période de sa vie. Un voyage à Prague pendant l’été 72, au moment du procès Dubcek, rappelle combien l’Histoire s’est faite brutale, destructrice. De quoi se sentir seul.
La dernière phrase du récit, isolée dans son paragraphe, résume ce sentiment par une sensation : « J’ai froid. »
Norbert Czarny
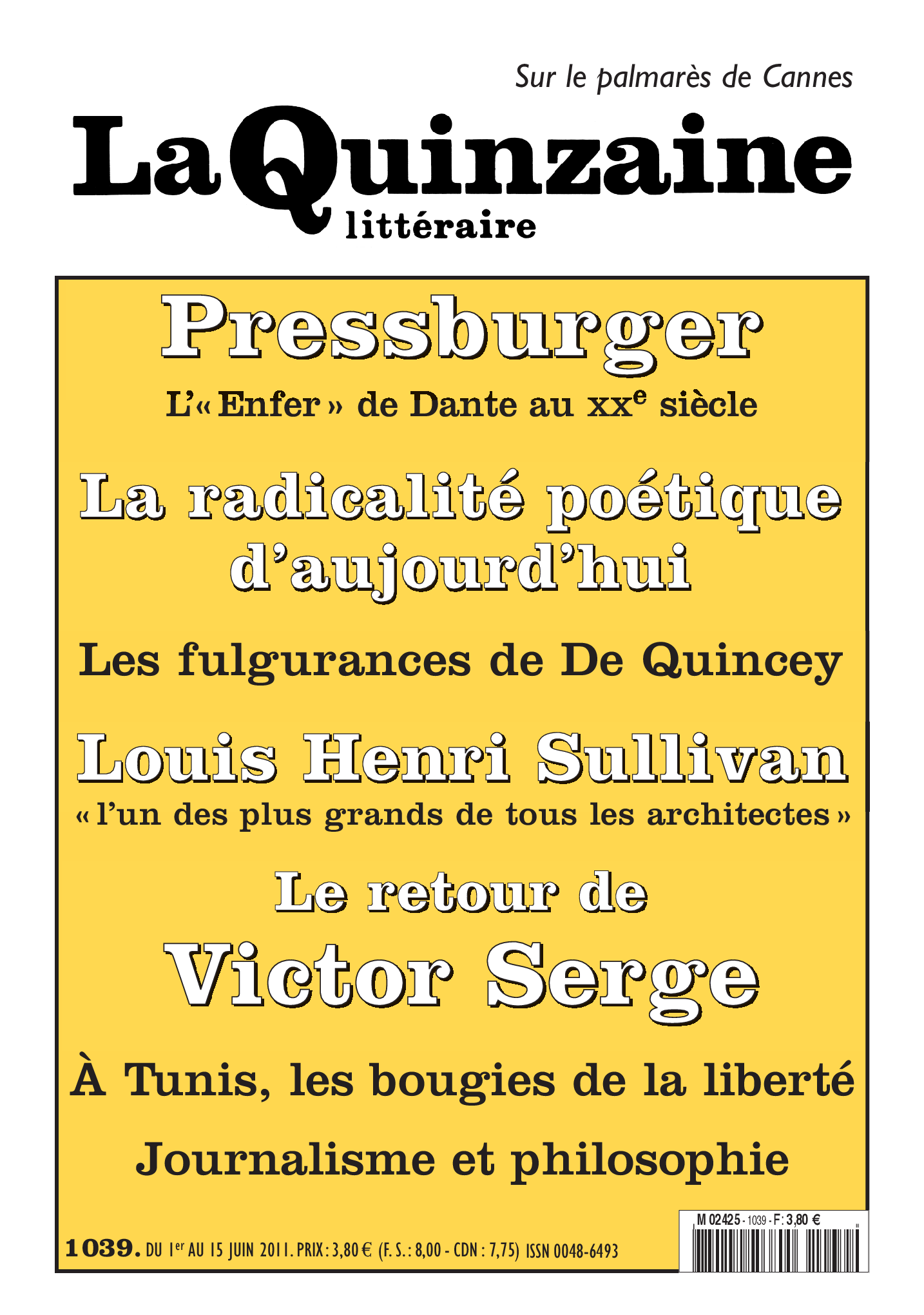

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)