On se souvient sans doute que Jean-Paul Sartre avait conçu le récit de son enfance, Les mots (1964), en deux parties distinctes, « Lire » d’abord, « Écrire » ensuite. D’aucuns ont souligné par la suite qu’écrire ne va jamais sans lire et que la coupure opérée était sinon factice tout du moins artificielle. C’est pourtant dans une large mesure le schéma que reprend ici l’auteur du Roi vient quand il veut. Car, précisément, dans J’écris l’Iliade Pierre Michon entreprend de nous raconter comment, auteur célébré, encensé, invité un peu partout, il ne parvient pas à réécrire, ou même à écrire son Iliade, c’est-à-dire L’Iliade d’Homère telle qu’il la comprend et telle qu’elle l’enthousiasme, avant d’en avoir fini avec ses trop nombreuses lectures, tous ces livres qui ont envahi sa demeure.
Tout commençait pourtant bien dans cette histoire. Dans le premier chapitre nous était retracé comment l’auteur était devenu, mais sans le savoir encore, Pierre Michon. Sans le développer davantage et avec un certain aplomb, celui-ci désigne par ce patronyme une œuvre forte, brutale parfois, zébrée souvent d’illuminations marquantes, pleine de rythmes et de rhétorique, et qui est la signature de cet homme de lettres depuis Vies minuscules (1984) et les récits de quelques dizaines de pages seulement, mais fulgurantes, qui lui ont succédé. C’était donc en 1971, le jeune homme né en 1945 se rendait à Lyon en train pour y effectuer ce que l’on nommait alors ses « trois jours » (remplacés depuis par la journée Défense et citoyenneté). Bourré de caféine et d’« amphés », d’anxiolytiques et de « leur contraire » afin de déjouer les tests de l’armée et d’être réformé, il observe lors d’un arrêt du convoi en pleine nuit le spectacle de la grue à eau approvisionnant la locomotive à vapeur (une des dernières en circulation). Et ce qu’il perçoit, dans un dérèglement systématique de tous les sens autant antimilitariste que rimbaldien, est une scène hallucinée, proche des visions surnaturelles de Zola décrivant dans La bête humaine la Lison, la fascinante machine que chérit tant son mécanicien, Jacques Lantier. Engagé tel qu’il l’est dans son combat contre l’armée, il ne parvient alors plus à dormir et parcourt les wagons jusqu’à sa rencontre avec une femme d’âge mûr qui, lit-il dans son regard, voudra bien qu’il assouvisse avec elle son désir débordant, transgressif, trophée s’offrant sans mot au vainqueur, à celui qui s’est changé en véritable (et encore futur) écrivain. Dans le chapitre suivant, « Le rêve d’Homère », c’est l’inverse : c’est la toujours jeune Hélène de Troie qui vient oniriquement remercier le vieil aveugle de lui avoir consacré son poème. Dans cette scène, « Hélène veut. Homère veut. Il va refendre la fente du ventre. Couper la césure. Du bout des doigts, il l’ouvre. » On le constate, le style de Pierre Michon a évolué depuis ses débuts. Il est devenu plus sec, plus direct, et son propos plus cru. Et s’il retourne à ce premier texte de notre littérature occidentale, n’est-ce pas que s’y trouvait exprimé, dès le départ, que l’amour et la guerre sont étroitement mêlés ? Certains reprocheront sans doute à l’auteur ces scènes loin de l’esprit de notre époque de consentement et de respect dû à l’autre, des scènes d’un érotisme souvent violent, traduisant des relations compliquées, conflictuelles entre hommes et femmes, des relations qui n’excluent pas les pulsions mauvaises, voire sadiques. C’est le cas par exemple de l’histoire de Pasiphaé, qui est reprise ici dans un chapitre marquant, d’une sexualité terriblement débridée et explicite. Mais le propos de Pierre Michon ne concerne peut-être pas tant les autres que lui-même. Il y a chez son narrateur, qui se nomme Pierre Michon quoiqu’on puisse douter qu’il soit tout le temps lui, l’auteur, une telle envie que cela passe aussi, sans doute, par ces pages d’une obscénité explosive. L’homme de lettres revient sur le long silence qui a suivi Les Onze et sur l’admiration que cela paradoxalement a provoqué : « je me monumentalisais », écrit-il avec autant d’humour que d’amertume. Il en veut aussi à ces journalistes recevant de manière routinière les nouveaux ouvrages des auteurs trop bien installés comme lui dans le paysage littéraire. Il va jusqu’à critiquer par le biais d’un écrivain qu’il invente pour ce récit le style qui avait été le sien : « J’ai détruit cette histoire, affirme ce Sylvain Dellile à qui un éditeur avait commandé un livre sur un personnage autour d’Homère, on aurait dit du Michon. À la fois sadique et gnangnan. » L’un de ces récits érotiques les plus ahurissants, au demeurant, est celui qui est fait par un autre personnage, un cinéaste flirtant avec le X, nommé Pierre Meyne. Outre les mêmes initiales, l’écrivain partage avec ce si peu sympathique protagoniste de son livre une même enfance campagnarde, des phantasmes sexuels qui étaient déjà ceux de La Grande Beune (1995) ainsi que, dans les deux récits toujours, un même rôle crucial accordé à un instituteur (on peut se souvenir aussi que le propre père de l’auteur, dont l’absence est si vivement ressentie dans Vies minuscules, exerçait cette profession). Ces jeux de masques et d’avatars ne trompent personne et certainement pas le très rusé Pierre Michon qui n’en use que pour outrer un peu plus son image déjà bien écornée.
Le récit, on l’aura compris, alterne certains moments choisis de la vie du narrateur et les scènes antiques homériques, mythologiques et l’un des intérêts de ce texte dense consisterait à suivre la façon dont une situation d’aujourd’hui influe sur le choix et la réécriture de tel épisode de la Grèce ancienne. Ainsi, par exemple, une aventure qu’il a avec une femme qui « aimait apparaître nue et se montrer longtemps » donne-t-elle lieu, dans le chapitre suivant, à une reformulation de l’histoire d’Actéon métamorphosé en cerf pour avoir surpris Artémis nue au bain. Le mythe, ô combien voyeuriste, est bien connu mais il est terriblement revivifié ici par l’expérience personnelle.
À cette circulation interne des motifs, il faut ajouter une formidable réflexion sur la littérature. À l’instar des gens de peu de Vies minuscules, les auteurs majuscules comme il faut bien les nommer lui indiquent aussi, à leur façon, comment il pourra écrire son existence passablement cabossée et devenir Pierre Michon. L’ouvrage s’engage alors dans un dialogue spéculatif avec les sommets de la littérature occidentale, avec Homère, bien sûr, mais aussi Shakespeare ou Borges, tous écrivains soit aveugles, soit auteurs contestés de leurs œuvres (ont-ils réellement existé ? est-ce eux qui ont écrit leurs livres ? etc.) C’est cette idée que le père du texte est autant celui qui l’a écrit que celui qui se l’approprie, qui le fait sien, qui le prolonge ou le termine, dans un geste de reprise féconde. J’écris l’Iliade raconte alors comment l’écrivain creusois que « le goût de noircir du papier […] avait abandonné », après une descente aux enfers littéraires et existentiels, à travers un jeu subtil d’échos avec les « monuments » du passé, retrouve foi en ses capacités créatrices. L’ensemble s’achève dans un immense brasier, un gigantesque potlatch que l’auteur fait de toute sa bibliothèque, des volumes de philosophie aux B.D. érotiques, des livres d’Histoire aux textes littéraires des auteurs majuscules, justement. Ce geste, jubilatoire et libératoire, qui dure tout le dernier chapitre, lui permet de se remettre à sa table enfin rase et d’écrire à son tour L’Iliade, celle d’hier et d’aujourd’hui.
Thierry Romagné

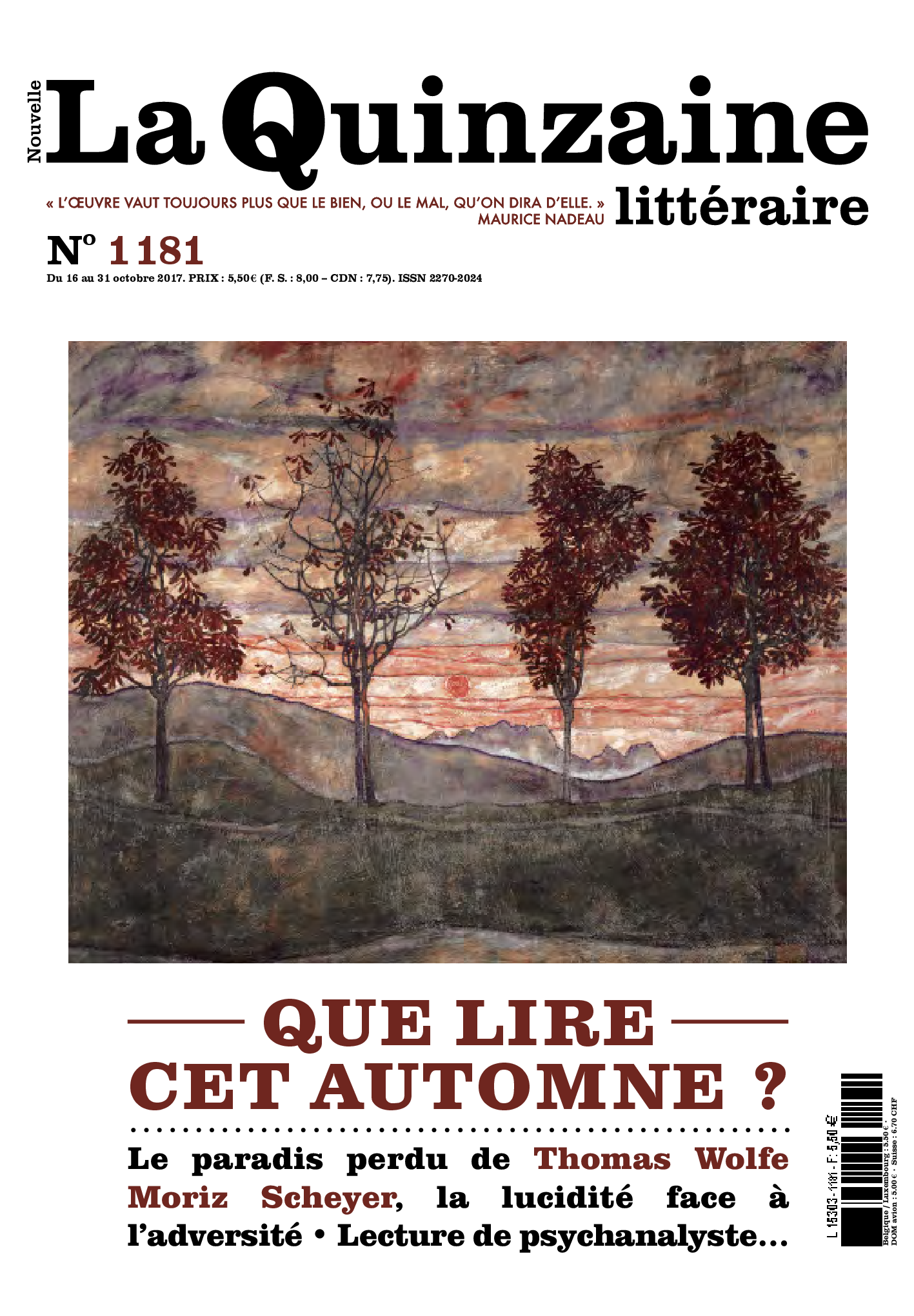
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)