Une fille d’Alger relate le destin d’une femme, Hélène Samia Lapérade, avec pour toile de fond la fin de la guerre d’Algérie, de 1960 à 1962. Après le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, l’Algérie s’est acheminée inexorablement et dans la douleur vers l’indépendance, que les accords d’Évian ont ratifiée le 18 mars 1962, mettant un terme à cent trente-deux ans de colonisation (1830-1962) et huit années de guerre (1954-1962).
Aussi, avec Une fille d’Alger, Jean-Michel Devésa tente de faire revivre des événements qui continuent de remuer obscurément la ...

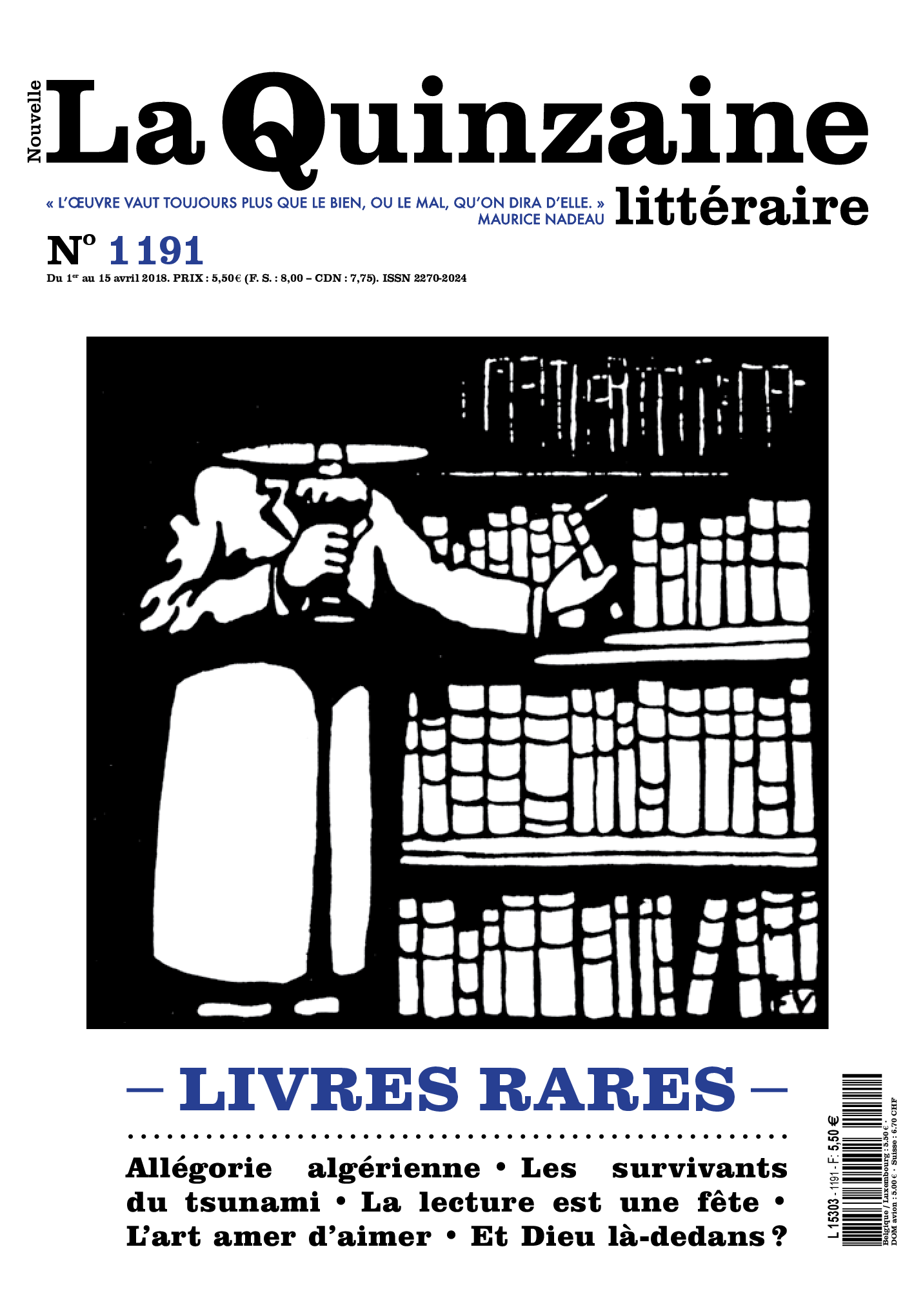

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)