On ne quitte guère la péninsule indochinoise, cadre de Kampuchéa, mais cette fois-ci l’épicentre du roman est Nha Trang, au bord de la mer, au Viêt-Nam. Là vit Alexandre Yersin. Son nom est oublié, sinon par les élèves qui ont fréquenté le lycée de Hanoï, et par celles et ceux qui savent quel rôle il a joué dans l’éradication de la peste. Yersin, biologiste, médecin, explorateur et, on le verra, bien autre chose encore, a découvert le microbe véhiculé par les rats et quelques insectes qu’il a pu observer à travers son microscope. « Yersinia pestis » : c’est ce qui restera de lui à travers les siècles, quand on se rappellera que cette maladie terrible a détruit au Moyen Âge la moitié de la population européenne, et qu’à la fin du XIXe siècle elle ravageait encore des villes chinoises. Mais Yersin est avant tout, pour ce qui nous intéresse, un personnage de Patrick Deville, croisant d’autres personnages de Deville nommés Pasteur, Conrad, Brazza, Loti ou Rimbaud.
C’est en effet parmi tous ces contemporains qu’il faut envisager Yersin. Né à Morges, en Suisse, orphelin de père très tôt, Yersin étudie l’anatomie à Marbourg. Il aurait pu devenir allemand, il entre dans la « bande à Pasteur », fréquente Roux, « l’orphelin de Confolens », part comme médecin sur le bateau qui fait la navette entre Manille et Saigon, puis ouvre la route terrestre entre l’Annam et le Kampuchéa. Il découvre le site naturel de ce qui sera Dalat, une sorte de Suisse vietnamienne ; on y bâtira des chalets et villas cossus, comme à Monaco ou Deauville, et puis il s’installe à Nha Trang, un paradis qu’il développe et transforme comme on crée une utopie, avec sa bande. Il invente, il cherche, il cultive. Un jour, il se met à écrire, et à traduire. Il y meurt en 1943, alors que les occupants japonais arrivent sur les lieux.
Yersin aurait pu connaître la célébrité, la gloire, la fortune. Parmi les découvertes qui sont liées à son nom, celle du caoutchouc. Mais il ne s’appelle pas Dunlop… ou encore une boisson qui ressemble au coca. Et puis tout ce qui touche aux maladies infectieuses, et qui ravage l’Asie. Mais cela l’intéresse moins que de chercher, d’explorer, en somme d’être sans cesse sur la brèche. Ce n’est pas pour rien un personnage de Deville, qui évoque en parallèle les explorateurs traversant l’Afrique dans Equatoria, ou l’Asie comme Mouhot, dans Kampuchéa. Et bien sûr, en arrière-plan, incarnant à la fois l’optimisme du siècle industriel et la menace d’une Europe qui colonise, exploite et détruit autant qu’elle bâtit, les écrivains comme Verne, Rimbaud et Conrad. Deville montre un contexte, décrit un monde en gestation. Les rivalités entre l’Allemagne de Bismarck, la France et l’Angleterre se jouent sur d’autres continents et l’on sait comment elles dégénéreront en 1914. On est cependant étonné d’apprendre qu’elles se jouent aussi dans les laboratoires et que Koch ou Pasteur, ce n’est pas la même cause. La géopolitique a aussi beaucoup à faire avec tout cela. Ainsi l’Angleterre supporte-t-elle mal qu’entre Bombay et Shanghai un savant français œuvre en Indochine, brisant une continuité territoriale et politique.
Yersin n’entre pas dans ces calculs et la politique n’est pas son fort. Il se lie d’amitié avec Paul Doumer, « orphelin d’Aurillac », inventeur de l’impôt sur le revenu, gouverneur d’Indochine ; il est proche de Lyautey, dreyfusard convaincu bien qu’il porte l’uniforme. C’est un républicain aussi résolu que ses amis, sans pour autant s’engager. La science, le savoir, la découverte, une activité incessante, voilà ce qui le motive d’abord. Deville insiste beaucoup, et à juste titre, sur les « bandes ». Parfois on est de deux bandes, comme Paul Gegauff, ami de Chabrol et de Robbe-Grillet, entre Nouvelle Vague et Nouveau Roman, mais en général on n’est que d’une : la bande à Pasteur, la bande des Parnassiens ou celle de la rue Blomet, qui dans les années trente, à quelques pas de l’Institut dirigé par Roux ou d’autres pasteuriens, réunit Miró, Leiris, Masson ou Desnos. Ces bandes dont on fait partie ou pas donnent un air du temps, créent des devoirs ou des liens, aident souvent qui en est. Yersin n’en est pas toujours. Sa misanthropie, son envie perpétuelle d’être ailleurs, en mouvement, se concilient mal avec les rites et l’appartenance aux confréries. Déjà, à Marbourg, il n’en était pas. Yersin est un orphelin ; le narrateur insiste sur ce terme, et établit le lien avec ses contemporains qui le sont, comme lui. Ne pas avoir connu ou vécu avec son père vous met dans une situation singulière, vous rend conquérant, ou curieux à tout le moins.
Tout le long du roman, un autre voisinage ou cousinage est mis en relief. Rimbaud, celui qui déjà a quitté les anciens parapets de l’Europe, est le contemporain capital de Yersin. Ils ne se rencontreront jamais et le poète devenu négociant meurt alors que Yersin n’en est qu’à la moitié de sa vie d’inventeur, mais une phrase de Sciascia que le narrateur a soulignée unit les deux hommes : « La science, comme la poésie, se trouve, on le sait, à un pas de la folie. » La présence des mères, Vitalie et Fanny, à qui sont adressées de nombreuses lettres, est un lien de plus entre les deux hommes. Mais surtout le besoin d’être ailleurs et d’explorer. On ne saurait parler de ce roman sans dire le rôle du « fantôme du futur », ce narrateur qui enquête dans les lieux fréquentés par Yersin, « carnet à couverture en peau de taupe » en main qui circule à travers l’espace comme dans le temps. Ce scribe dilate, contracte, joue de l’ellipse, des parallèles et des va-et-vient entre Afrique et Asie, fait alterner des scènes de débâcle en 1940 et les heures glorieuses de la Troisième République pour dresser le portrait d’une époque qui deviendra la nôtre. Certains passages, et notamment les premières pages, suite de phrases nominales ou de propositions juxtaposées, ressemblent aux images d’un film qui défilerait très vite, de façon presque saccadée. D’autres fois, la lenteur des paquebots, la moiteur des climats tropicaux imprègnent les pages. Deville est virtuose, élégant, précis toujours, plus sûr que jamais d’un art qu’on a découvert en d’autres temps quand il publiait Ces deux-là. La beauté de l’ultime paragraphe sonne étrangement, à la fois pleine de sérénité et désaccordée, ample et détachée, comme le corps et l’âme du vieillard qui s’en va.
Et puis il y a l’humour. Les démêlés de Yersin avec les animaux ressemblent à des scènes de cirque ; le pigeon, qui n’avait déjà pas un très beau rôle dans Des éclairs d’Echenoz (avec quoi l’histoire de Yersin a quelque rapport), perd quelques plumes dans Peste & Choléra. Les mésaventures du médecin en Chine, sauvant par miracle un Chinois évangélisé, ont aussi quelque chose de drôle. De même quand le biographe s’inquiète pour son héros percé d’un coup de lance par un bandit annamite. Et soupire à le savoir sauvé. On joue avec le genre romanesque, et le lecteur qui y croirait. Mais on ne s’arrêtera pas à cela. Il y a du Yersin chez Deville, comme il y avait du Brazza ou du Mouhot. Le romancier est un encyclopédiste. Le projet qui le mène d’Amérique en Asie (et où demain ?), son goût pour la vulgarisation et son besoin d’être toujours ailleurs suscitent cette belle ressemblance.
Lisant ce roman, on sent tout ce qui unit Deville à son héros. Jamais, sans doute, le romancier de Saint-Nazaire (il en est question de façon oblique ici) ne rédigera son autobiographie. Elle serait vaine ; il s’est déjà incarné dans des figures d’aventuriers, de voyageurs, et de ces vies qu’il raconte on répétera ce qu’il écrit : « Le calcul est simple : si chacun d’entre nous écrivait ne serait-ce que dix Vies au cours de la sienne aucune ne serait oubliée. Aucune ne serait effacée. Chacune atteindrait à la postérité, et ce serait justice. » ❘
Norbert Czarny
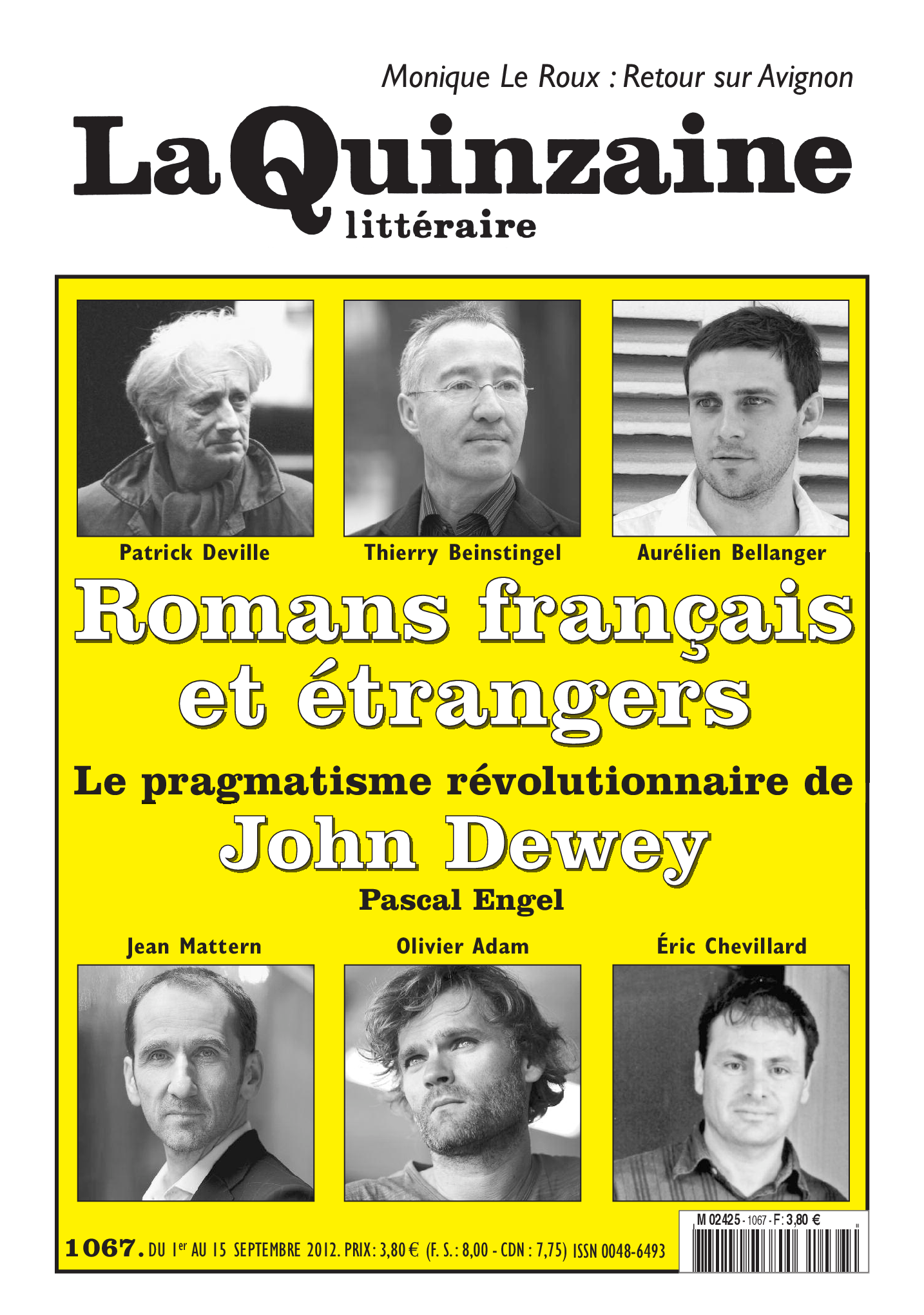
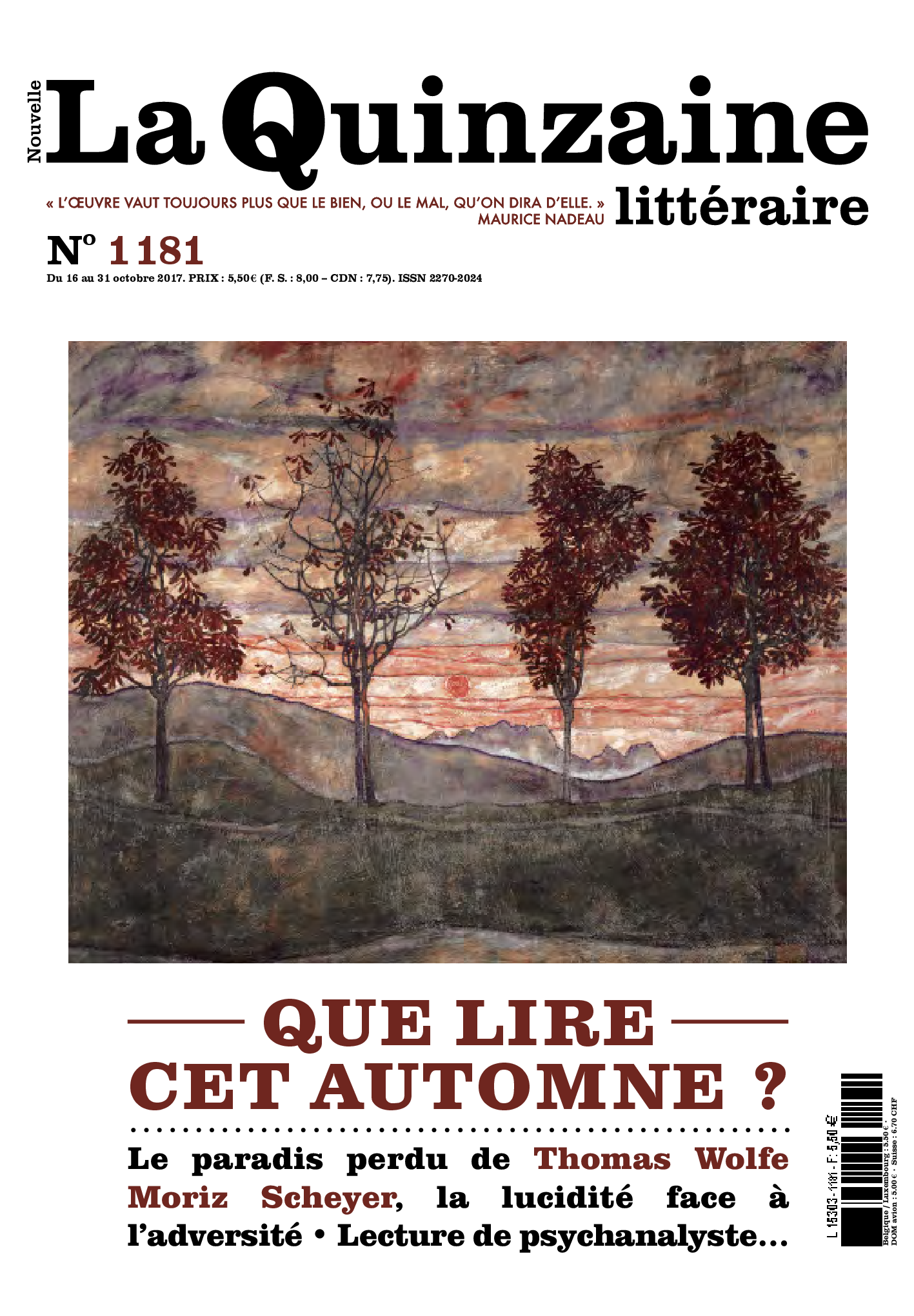
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)