D’un côté, un « vous », qui s’adresse à, ou donne à voir ou entendre, « l’ancêtre ». De l’autre, un « tu » pour la jeune femme qui vient d’être embauchée dans l’entreprise de papiers peints, décoration et meubles de salon, « l’alliance du design et de la qualité », comme le dit un de ces slogans sans fond. On les verra tous deux, de façon alternée, comme dans un montage cinématographique, avant de les voir ensemble. D’abord pour le moment de la confrontation, ensuite parce que les événements ont bouleversé tous les plans initiaux, et que, quatre années après que les faits principaux se sont déroulés, leur désertion les unit.
Ils désertent est, comme la plupart des romans de Beinstingel, un roman évoquant le monde du travail, et surtout les mots qui vont avec : « aucun métier ne peut sans doute être exercé sans la valeur d’une parole », dit la jeune femme enfin libre, à la fin du roman et c’est bien du manque de mots, de leur perte de sens, que souffrent les hommes. L’ancêtre aime les mots. Il se rend de magasin en magasin, propose ses rouleaux de papiers peints. Il s’amuse à piéger ses clients avec les bains, s’attache aux nuances, montre, en une belle tirade sur le pourpre, l’incarnat et la framboise écrasée, que le rouge n’existe pas. Il travaille en poète et ne peut se déplacer sans ses échantillons reliés – ses « œuvres complètes » –, qui racontent l’histoire d’un pays à travers ses motifs peints, et sa Correspondance de Rimbaud, avec une nette préférence pour les lettres professionnelles, neutres, factuelles, que le poète adressait à d’autres négociants. L’ancêtre ressemble à tous les VRP, fréquente de petits hôtels sans charme, achète des barres chocolatées dans des stations-service d’autoroute, et il a fait deux fois l’aller-retour de la Terre à la Lune dans sa voiture. Ou dans ses voitures puisqu’il en change comme de décor dans la maison qu’il rejoint chaque fin de semaine. Longtemps, il y a retrouvé femme et enfants, et puis son épouse est « partie en goguette », ne supportant plus cette existence à distance. Son fils est « commercial », acceptant mal la dénomination de VRP, et il reproduit la vie de son père à l’identique : bagout ravageur, grosse clientèle, ascension matérielle sinon sociale, et échec sentimental puisque sa femme et lui se séparent.
La solitude est sans doute ce qui unit l’héroïne et l’ancêtre, avant même qu’ils se rencontrent. Mal aimée par une « Folcoche » qui ne supporte pas que sa fille réussisse et s’affranchisse du milieu familial, incapable de rencontrer un homme, d’être aimée et de bâtir une existence, sinon dans le rêve, la jeune femme partage ces espaces vides, que lui aussi connaît. On entre dans des appartements sans vie, on se retrouve sur des aires d’autoroutes ou dans des bureaux garnis de toiles passe-partout prétentieuses. Tous deux éprouvent le besoin d’un ancrage qu’un très beau passage du roman résume : « Ainsi, c’est cela l’espace, l’existence, quelque chose de réel, d’humain, une terre cultivée, patiemment retournée, et non pas ce qu’on désigne par bas-côté, bas morceau d’une vie que la vitesse rétrécit de jour en jour. Et vous avez compris tout ce qui était caché dans la peau des voyages, tout ce qui s’était trouvé étouffé dans le bruit d’une modernité. Et cette immobilité retrouvée, soudaine, décidée, provoquait des sensations, élevait des sentiments, engendrait des mots nouveaux. » Dans son précédent roman (1), c’est un peu ce que Beinstingel qualifiait de retour aux mots sauvages, à ces mots de la poésie en somme, comme rendus à leur sens quand tout dans un parler quotidien tend à les affadir, à en détruire la nuance, la puissance et la beauté.
On comprend qu’entre l’ancêtre et celle qui doit le chasser, le licencier, la proximité des mots fera son œuvre. Il aime Rimbaud, elle retrouve Hannah Arendt, lue pendant ses études, oubliée sous les slogans publicitaires qu’elle ingurgitait et régurgitait dans sa vie professionnelle et on voudrait mettre en exergue cette phrase de la philosophe que la jeune femme relit : « On peut parfaitement concevoir que l’époque moderne – qui commença par une explosion d’activité humaine si neuve, si riche de promesses – s’achève dans la passivité la plus inerte, la plus stérile que l’Histoire ait jamais connue. »
L’explosion se produira dans le roman, aussi, quand à bout de forces, celle qui était promise à la plus belle des carrières renonce à tout dans un moment de crise nerveuse. Elle sauve sa peau, comme lui la sauve en se retirant des affaires ou se tirant d’affaire, c’est selon. L’écriture de Beinstingel n’est pas celle d’un pur romancier, et encore moins d’un réaliste ou d’un écrivain engagé qui défendrait une thèse. Son ancêtre comme la jeune « chasseuse » sont des êtres complexes, pris dans des contradictions. Lui a l’apparence du vieux représentant de commerce qui aime bien manger et fumer ses cigarettes, celui dont se moquent les jeunes commerciaux dynamiques, à qui leur patron promet de les laisser « intranquilles » (sait-il seulement quel poète lisboète inventa ce bel adjectif ?). Elle ressemble à ces jeunes femmes sûres d’elles, nerveuses et ambitieuses, qui pourraient remplir les séries télévisées, si ce n’est que les fêlures ne manquent pas : un père mort trop tôt de maladie, une origine sociale modeste qu’on craint de trahir, une tristesse infinie que l’emménagement dans un appartement à soi, en « cœur de ville », ne rend pas moins vive. Les retrouvailles avec une amie rencontrée au Cap-Vert lors de vacances, la rencontre avec l’ancêtre, le retour aux livres, et à ce qu’ils offrent en partage, la sauveront du pire.
On aime cette langue à la fois précise et poétique, qui joue du son autant que du sens, qui s’empare des infinitifs, le mode impersonnel par excellence, pour dire l’ennui infini d’une vie de famille sans vie ni famille, qui mêle les mots de Rimbaud à ceux de l’autoroute et du paysage contemporain en une belle page (p. 139) qu’on aimerait citer en entier. On aime cette attention aux êtres, à leur fragilité, et aux possibilités qui s’offrent à eux de déserter, parfois. ❘
- Retour aux mots sauvages, Fayard, 2010. Cf. QL n° 1 024.

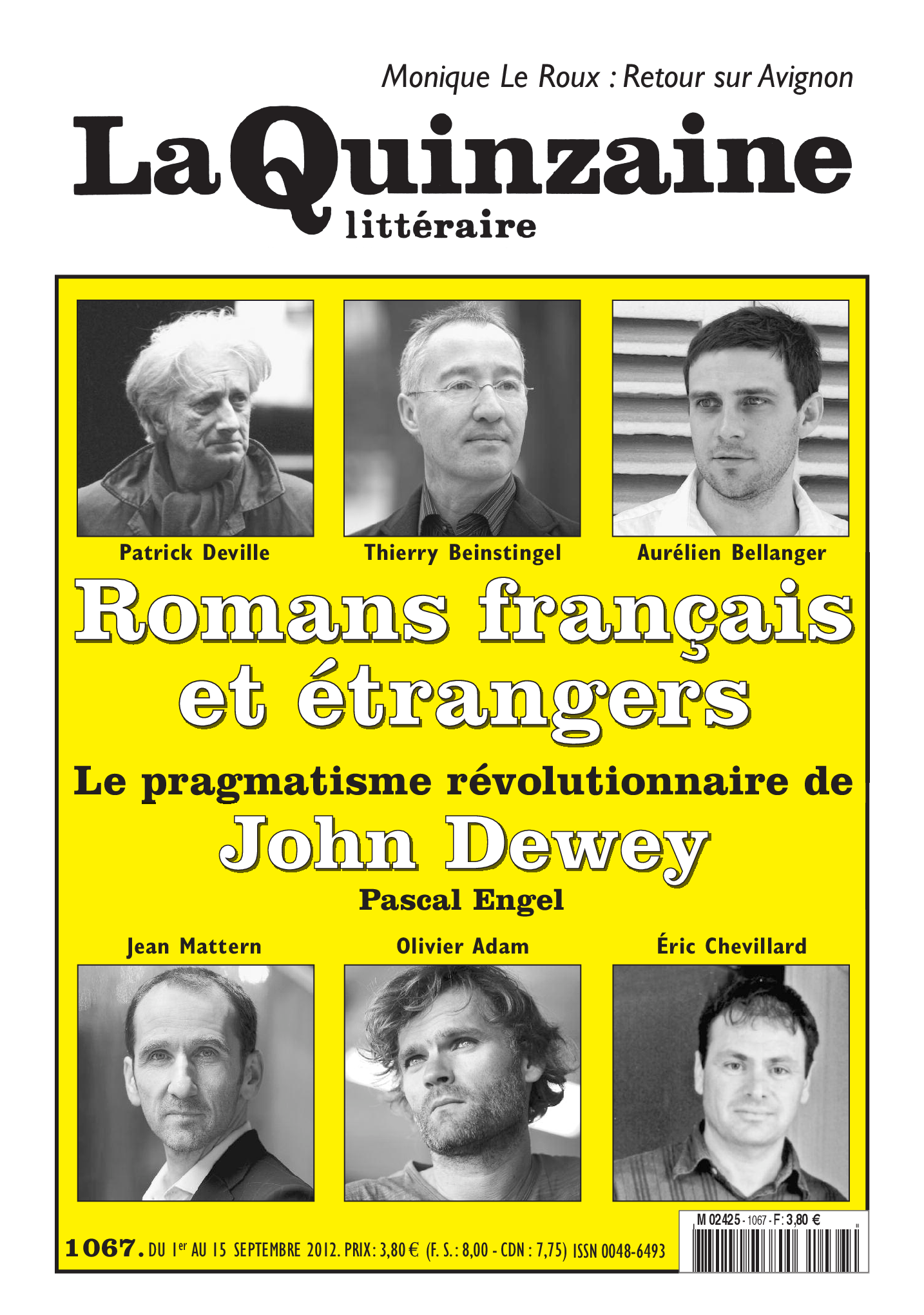

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)