Jean Levi est sinologue. Il part donc de la Chine, ou bien y revient, au fil de ces six essais qui nous en apprennent beaucoup sur l’Empire du Milieu, sur l’exemplarité et la longévité phénoménales de ce parangon du totalitarisme. Mais, loin de se cantonner à l’examen de son modèle, qu’il s’agisse de la Chine d’autrefois ou de celle d’aujourd’hui, il ne dissimule pas que sa cible principale se confond avec notre monde à nous, victime consentante d’une manière d’asphyxie du libre arbitre que l’oxymore totalitarisme démocratique exprimerait peut-être assez bien.
Voyons d’abord la Chine. L’automne des interminables luttes féodales qui culminèrent au temps des Royaumes Combattants (- 475-421), et au cours desquelles pourtant s’élaborèrent les grandes doctrines, celles de Confucius et de Lao-Tseu, est brutalement clos par la prise de pouvoir de Ts’in Che Houang-ti. C’est lui le père du système impérial. Il l’installa sur le massacre, la mégalomanie apparemment la plus insensée (la construction de la Grande Muraille, où périrent 700 000 esclaves), l’auto-da-fé des lettrés et des livres. Bien, voilà un excellent début, et qui conditionne tout le reste.
En effet à la table rase de toutes les libertés en quoi va désormais consister le rêve impérial et impérialiste d’un État centralisé, corseté, fonctionnant sur la délation, la corruption et la terreur, il faut une solide armature idéologique. Elle sera pour l’essentiel fabriquée à partir de l’idéal de société policée qu’avait imaginée Confucius à partir d’une structure familiale fondée sur l’asservissement des descendants et le culte des ancêtres. Mais ce que la subtilité des analyses de Jean Levi nous permet de comprendre, c’est que la prison sociale de l’Empire chinois tient debout, malgré de périodiques soubresauts, non sur l’arbitraire d’un seul mais sur l’acceptation par toute une masse hétérogène des lois les plus liberticides parce que ces lois sont perçues comme « naturelles ». Le souverain n’est pas seulement un tyran sanguinaire entouré par des brutes bornées à sa dévotion entière. Muré dans la tour d’ivoire de son palais, il résume en son corps même, en sa personne physique au premier chef, l’organisation et l’harmonie du Ciel et des saisons. S’il ne mourait pas un jour, si son cadavre ne se mettait pas à puer malgré les tombereaux de harengs saurs dont on le flanque, si l’on parvenait à dissimuler éternellement son trépas, son autorité (même pas religieuse, en un sens purement formelle mais conforme en son essence à l’autorité même du réel) n’aurait aucune raison de s’éteindre.
Formidable technique d’abrutissement ! Mais elle s’appuie sur une connaissance et un maniement très fins des passions humaines, en effet on ne peut plus naturelles : la peur (de la faim, de la souffrance, de la mort), l’appât du gain, le besoin (inné ?) qui obsède l’animal doué de déraison d’écraser son voisin, de le dépasser en « réussite », de le détruire.
Ainsi se maintient l’Empire, du parvenu féroce et abject que fut Ts’in Che Houang-ti, hissé sur le trône par un négociant milliardaire qui devint son Premier ministre et s’empressa de persécuter les marchands ses rivaux, jusqu’à Mao et au-delà. Bien sûr, les mœurs se sont un peu adoucies et la Chine d’après Tian-An-Men n’est plus tout à fait celle qui faisait tirer sur les étudiants et les ouvriers. Mais les principes fondamentaux de la sujétion demeurent. Aujourd’hui encore c’est sur un merveilleux tour de passe-passe conceptuel que s’affermit le consensus d’une société tout entière lancée dans l’acquisition du mieux-être. Il n’y a plus de corps impérial (depuis Mao) susceptible d’incarner un corpus de lois directement issues de la nature des êtres et des choses. Les lois, désormais, ce sont celles du marché, dont la main invisible, puissance tutélaire et naturelle (quand les théories économiques dissidentes sont présentées comme théoriques précisément et ne tenant pas compte des pulsions naturelles de l’homme), régule la croissance harmonieuse de la nation chinoise sur la voie triomphale du développement accéléré.
Ici se boucle une démonstration rigoureuse dont la validité est universelle et par conséquent s’applique non seulement à la Chine totalitaire, qui en apparence civilise ses pratiques, tout en persévérant dans son être par des moyens nouveaux, mais à toutes nos démocraties. Ne sont-elles pas en train de troquer, elles aussi, leurs idéaux de liberté – et il n’est de liberté qu’individuelle, comme le savait déjà le Tao – contre une soumission, en partie inconsciente, aux dogmes d’essence totalitaire de la croissance à tout-va et le culte du profit ? Il suffit de voir comment certaine pensée citoyenne de l’égalisation, au moins partielle, de la richesse et de la pauvreté planétaires, un temps remise en selle par la profonde crise financière et économique des deux années écoulées, s’est trouvée de nouveau reléguée au rang des ringardises, dès qu’une lueur probablement surestimée de redémarrage des pays riches a recommencé à poindre.
On suppose bien que pour penser vraiment, c’est-à-dire penser à contre-courant, il faut se donner du mal et que l’issue d’un tel travail n’incite pas à une franche rigolade. Il serait erroné pourtant de croire ce livre austère et de triste compagnie. Certes les différents essais qui le composent traitent de questions graves à la discussion serrée desquelles l’exemple chinois sert souvent d’amorce, jamais de prétexte artificiel. Confucius à qui l’on demandait quel serait son premier acte s’il avait le pouvoir suprême répondit : changer les noms. L’étude des rouages intimes du totalitarisme, depuis la magistrale étude de Victor Klemperer sur la lingua tertii imperii, la dénaturation de l’allemand par l’idiome hurlé des nazis, ne saurait se dispenser d’une réflexion sur la langue. Elle est ici superbement menée à partir de la Cacanie de Musil et des considérations linguistiques de Wittgenstein, et le résultat n’est pas drôle.
Pas plus qu’il n’est divertissant, en principe, de s’appuyer sur une boutade de Tchouang-Tseu, continuateur de Lao-Tseu et du Tao, pour approfondir le questionnement de la sophistique, où les Chinois étaient depuis longtemps passés maîtres, et se demander ce qui est le plus dangereux pour la liberté : une langue dont chaque mot n’aurait qu’une seule acception, ou une langue que l’abus de la métaphore éloignerait de toute référence non biaisée au réel. En fin de compte, c’est bien la première la plus totalitaire, n’est-ce pas ? puisqu’elle interdit l’imaginaire et la poésie. Mais la lecture attentive de l’essai qui donne son titre au livre de Jean Levi prouve que rien n’est simple en ces domaines aventureux de l’esprit.
Et ne devrait-il pas être sinistre, le chapitre sur l’autocritique en Chine ? Celui sur la commémoration (de Tian-An-Men en l’occurrence) comme forme innocemment perverse de l’oubli ? Celui enfin, coda de l’ensemble, sur la réalité historique des massacres, qui reconvoque celui des lettrés par le Premier Empereur, mais aussi réfute Pierre Vidal-Naquet commentateur sceptique du suicide collectif des Zélotes juifs assiégés par les Romains à Masada (en 73 de notre ère) chez Flavius Josèphe ?
Eh bien ! non, car l’humour est ici partout présent. Il est parfois grinçant – comme dans ce dernier exemple où l’auteur aboutit, en suggérant que le pire est toujours sûr, à une critique acerbe et juste (à notre avis) de la discipline historique elle-même. Parfois, plutôt allègre, il fait partie intégrante de la force subversive du livre. Ainsi en va-t-il de l’autocritique en Chine, qui aujourd’hui conduit un père rédigeant celle de son fils (écolier rétif, il a insulté sa maîtresse notoirement nulle) à se valoriser par sa virtuosité dans l’art de l’auto-dénigrement absurde. Ou de l’épatante affirmation que les guerriers d’argile exhumés du tombeau de Ts’in Che Houang-ti, la crapule impériale, sont des faux manufacturés à l’époque maoïste et admirés universellement par consentement tacite à la laideur (une des marques les plus révélatrices du totalitarisme… et des goûts actuels de notre démocratie de masse !).
La Chine est un cheval et l’Univers une idée ne vous ennuiera pas. Il fera peut-être bouillir votre bile et vous vous esclafferez parfois en reconnaissant chez l’auteur quelques idées de traverse qui vous sont chères. Penser fatigue, mais exalte aussi à condition de disposer d’un bon guide. Penser en tout cas, n’étant plus la chose du monde la mieux partagée, masse les méninges et par là fomente l’euphorie.
Paraît également Le Petit Monde du Tchouang-Tseu de Jean Levi aux éditions Philippe Picquier.
Dans le prochain numéro de La Quinzaine littéraire, un entretien de Jean Levi avec Gilles Nadeau (NDLR).
Le Grand Empereur et les guerriers d’argile
« J’aimerais agrandir votre porte !
– Commencez par la vôtre avant de penser à la mienne !
– C’est que, justement, la mienne a besoin de la vôtre pour s’agrandir ! »
La Chine impériale devait naître de cet échange entre un prince et un capitaine d’industrie.
Dans la quarante-troisième année du roi Ts’in le Resplendissant (ou si on préfère en l’an 264 avant notre ère), un commerçant-entrepreneur du nom de Liu Pou-wei, en voyage d’affaires dans la riche et populeuse cité de Han-tan, croisa le piteux équipage d’un des princes du Ts’in qui y avait été envoyé en otage, et eut l’idée d’investir dans un roi, comme il faisait négoce de chevaux et de laques.
Grâce aux capitaux de Liu Pou-wei, le pauvre et obscur Yi-jen, dernier-né des vingt fils du Prince héritier, soudoya si bien l’entourage de son père le Dauphin qu’il put « agrandir sa porte » au point de ceindre la couronne du Ts’in. Il devenait ainsi le plus puissant monarque de la Terre-sous-le-Ciel tandis que son bailleur de fonds, Liu Pou-wei, était nommé Premier ministre.
Le roi Yi-jen eut un fils d’une concubine offerte par le marchand. Ce fut Ts’in Che Houang-ti, fondateur de l’empire de Chine, constructeur de la Grande Muraille, massacreur des lettrés et unificateur des caractères d’écriture.
Ainsi le règne de l’Auguste Empereur est-il placé sous le double signe de la démesure et de la contradiction.
Il dut son trône à l’intrigue et à la corruption, mais promulgua des lois si inflexibles que nul n’osait leur faire entorse ; il régna grâce aux manœuvres d’un marchand qui était peut-être son véritable père et il poursuivit le négoce de sa haine, proscrivant le commerce et déportant tous ceux qui s’y livraient. Lui qui écartait avec horreur l’idée que la mort puisse un jour clore ses paupières d’un sommeil définitif, il fit travailler sept cent mille forçats à l’édification de son tombeau. Il fonda une dynastie qui ne connut que deux règnes, mais jeta les bases d’un État qui perdura deux millénaires. L’homme dont les institutions forcent l’admiration des historiens en raison de leur efficacité et de leur rationalité fut guidé toute sa vie par le rêve démentiel de devenir immortel.
L’unification de la Chine par l’Auguste Empereur fut certes le fruit d’un long processus entamé avant sa naissance. Mais la conquête réalisée, il imprima réellement son empreinte au nouvel empire. Pour montrer que son avènement marquait une ère de paix, il confisqua toutes les armes et les fit fondre en douze gigantesques statues qui flanquaient les degrés de marbre menant à ses palais. Puis il se donna le titre divin d’Auguste Premier Empereur et décréta qu’en vertu de la succession des cycles historiques par destruction des éléments, il régnerait par l’hiver, saison des châtiments, qui a le noir pour couleur, six pour emblème et l’eau pour élément.
Il procéda à l’unification des mesures et calibra jusqu’à l’écartement des essieux. Il supprima les fiefs et les royaumes, transformés en circonscriptions administratives. Le Premier ministre lui-même se chargea de la simplification de l’écriture, éliminant les variantes régionales. Certes, l’uniformisation du territoire, la standardisation des poids et des mesures assuraient une gestion plus commode et plus efficace de l’immense empire, mais elles visaient surtout à instaurer dans la société le même ordre nécessaire et inéluctable qui régissait le cosmos. Et comme nul ne devait échapper à la norme commune, sages, excentriques, illuminés, fous, simples, parasites, clochards, génies, écologistes et autres marginaux – tous ceux qui ne se pliaient pas au moule – furent éliminés. Dans chaque hameau furent placardées les listes des hommes remarquables dont la tête était mise à prix.
La confiscation et l’autodafé de tous les ouvrages autres que techniques en 213 avant notre ère ainsi que l’exécution de cinq cents lettrés répondaient à des préoccupations analogues. L’ordre absolu ne pouvait régner que si les institutions étaient soustraites à tout jugement ; il requérait donc l’éradication de la pensée.
Jean Levi, La Chine est un cheval et l’Univers une idée,
© MAURICE NADEAU, pp. 11-14.

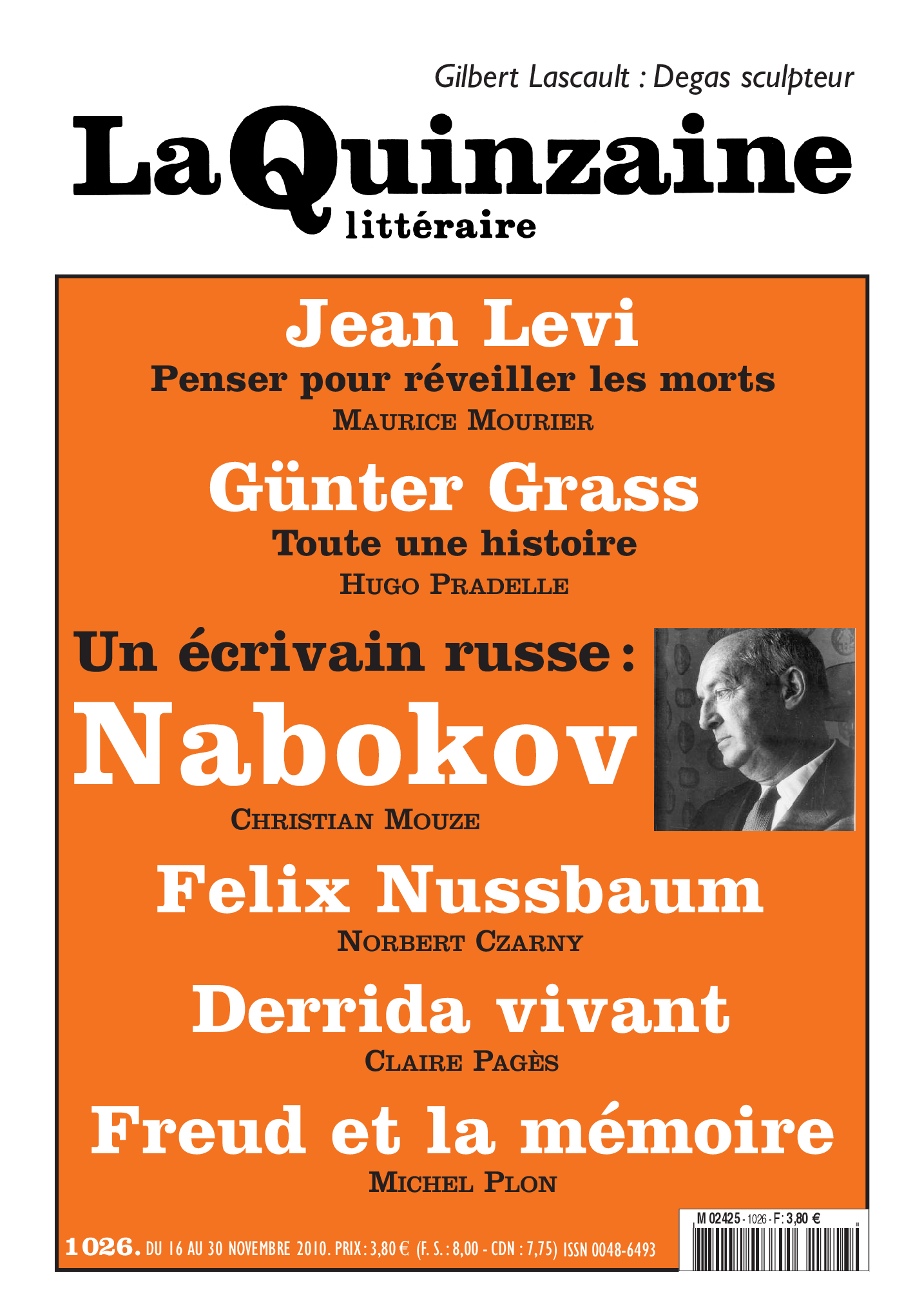

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)