Le roman précédent reposait sur une structure en deux parties, très simple : d’abord le récit chargé de bruit et de fureur de la pêche tragique, terminée par la mort de l’ami, cet épisode initial et initiatique étant orchestré, dans un registre élisabéthain, par la lutte hallucinée des marins contre la tempête, dans leurs barques non pontées, au péril de la moindre bourrasque et du froid mortel qui glace jusqu’au cœur l’homme que la vague et la pluie ont mouillé une seule fois.
Puis à terre on passait du déchaînement wagnérien des cuivres à une savante petite musique de nuit : le « gamin » revivait dans la chaleur d’un foyer étrange, dominé par une libre créature accueillant dans son lit les marins de passage. Il s’habituait peu à peu à l’atmosphère de la communauté villageoise, à son pasteur obsédé par les corbeaux, qui sont le diable en personne, à l’humeur fantasque du vieil aveugle, aux personnalités fortes mais le plus souvent dépressives des mâles d’une société essentiellement pauvre, très inégalitaire pourtant, soumise à l’autorité de fait du riche patron du « Grand Magasin » local, dispensateur des denrées importées du continent et sans lesquelles la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Café, alcool, tabac arrivent d’Angleterre et bien sûr du Danemark. C’est en effet le royaume danois qui contrôle entièrement alors la minuscule population islandaise. Nous sommes en 1880, l’Islande est une colonie à laquelle une relative marge d’indépendance ne sera concédée qu’en 1904. Elle ne subsiste, péniblement, que du poisson qu’il faut aller chercher dans les eaux dangereuses de l’Atlantique septentrional. Seule autre ressource, culturelle donc morale, de ce pays de glace oublié de Dieu, sa littérature, celle des sagas de l’an mil, toujours lues, apprises, vénérées.
Le schéma de La Tristesse des anges reprend en l’inversant celui d’Entre ciel et terre. On croit d’abord à la poursuite des « universités » du « gamin » dans le cadre presque serein du café-hôtel où sa tâche principale est d’apprendre assez bien l’anglais pour être capable de traduire Othello le soir au vieux Kolbeinn. En même temps, il aide un autre loup de mer décati, et passablement ivrogne, à remettre à flot son navire, qui gisait sur cales depuis des mois, à reconstituer son équipage pour une nouvelle expédition. Et parallèlement, c’est de son âge, il tombe amoureux, lui qui ne possède aucun bien, sauf une évidente aptitude au rêve et à la poésie, don encouragé par un aubergiste généreux, et il faut que l’élue de ses sens soit la fille du méprisant tenancier du magasin aux trésors. Voilà qui semble annoncer des péripéties à la David Copperfield.
Mais cette existence en somme confortable se trouve à nouveau bouleversée, car le postier Jens, un colosse taiseux et à demi fou, se retrouve, par la disgrâce du supérieur qui le hait, obligé de transporter trois lourdes sacoches de courrier vers une poussière de hameaux côtiers perdus, et il ne peut partir seul car il faut traverser des fjords en canot et l’homme a peur de la mer. À la petite musique de nuit du quotidien villageois succède alors brusquement « le voyage », qui occupe les deux tiers du livre. Nous sommes en avril, ce devrait être le printemps après des mois de nuit, mais le printemps, en Islande, surtout au nord de cette grande île volcanique située juste au-dessous du cercle polaire arctique, peut se faire attendre longtemps. Pour l’heure, dans l’économie d’un texte qui va s’interrompre d’une manière abrupte (avant peut-être une nouvelle suite, car nous avons affaire à une saga moderne), ce printemps de fleurs et d’oiseaux n’arrivera jamais.
Les deux protagonistes, Jens et « le gamin », contraints de s’épauler sans l’avoir choisi, s’affrontent dans une intrigue sans événement autre que les étapes d’une incessante empoignade avec le vent et la neige. Une intrigue, si l’on veut, picaresque, et potentiellement drôle. Tous les éléments d’un comique chaplinesque où l’émotion affleure sous le gag y figurent : le grand et le petit, celui qui ne dit mot et le partner que rien ne peut empêcher de parler, l’absurdité d’un périple dont le plus clair résultat est de nourrir en feuilles de chou aux nouvelles éventées des paysans plongés dans les affres d’une survie obscure, le ballet grotesque de deux pantins perdus dans le blizzard et qui luttent désespérément en maugréant l’un contre l’autre, afin d’essayer en vain d’écarter de leur visage les tourbillons coupants de la neige.
Littérairement, une menace pèse sur le récit : comment introduire de la variété dans la linéarité essentielle d’une situation dont les composantes sont en si petit nombre (un duo, la folle uniformité d’une tempête qui ne faiblit jamais, un paysage invisible car la neige l’oblitère, une absence apparente d’enjeu) ? Mais cette menace jamais ne se matérialise, jamais le lecteur ne ressent la moindre lassitude. Il vibre au contraire à chacune des épreuves de ce chemin de croix sans récupération romantique ou mystique possible, puisque les anges qui perdent leurs plumes blanches par millions sont ici métaphoriques d’une indifférence aux souffrances des hommes qui tombe sans arrêt du ciel. Bien que la mécanique narrative joue de la répétition, c’est avec le même tremblement que le lecteur assiste au déroulement de ce chemin de croix et à ses stations successives : combat contre les éléments, chute et quasi-perdition, sauvetage et repos provisoire dans la ferme providentielle de pauvres gens qui se privent pour donner à souper à leurs hôtes inattendus et leur cèdent le grabat où se consument des vies, ou plus loin au presbytère du pasteur qui a perdu la foi, enfin dans le logis plus sinistre encore de malheureux pleurant une femme morte.
Ce n’est pas seulement la disparité toute relative des décors qui sauve le texte de la monotonie. Rien de plus riche et complexe psychologiquement que les êtres de rencontre qui peuplent 230 pages inspirées. Stefánsson a pour ces comparses tant d’amour qu’aucun d’entre eux ne demeure un simple faire-valoir. Comme les personnages secondaires de Balzac, dont Albert Béguin disait qu’ils avaient tous du génie, celui de leur créateur, les moindres figures qui surgissent ici dans un contexte le plus souvent sordide resplendissent d’attachante singularité. Il faut souligner que l’inculture, dans cette Europe si reculée, dans l’espace mais aussi dans le temps, n’a nulle part ici sa place. Le pasteur neurasthénique vit ses insomnies trop arrosées entouré de livres, mais la fermière sans pain de la première station en conserve jalousement quelques-uns et aspire à en lire d’autres. Quant au géant de la troisième station, qui se reproche amèrement son ivrognerie et la violence bestiale qu’elle fomente en lui, il jouit d’un cerveau en parfait état de marche et les paroles qu’il prononce montrent une qualité intellectuelle et sensible de lettré, qui fait bon ménage avec sa croyance aux fantômes, et l’ensemble du gaillard, qui va disparaître sans doute à la fin dans l’abîme vertigineux où s’engloutit le texte, sonne étonnamment juste.
De bout en bout, La Tristesse des anges est enveloppé dans une atmosphère de mort, ce qui n’en fait pas du tout un livre morbide. Il rayonne au contraire une sorte de force et presque d’allégresse vitale communicative, justement parce que la première leçon dispensée, à l’orée du texte, par la voix hors temps qui s’y fait entendre, est celle de défunts qui continuent à vivre dans l’au-delà en ressassant de vieux rêves inassouvis, et comptent sur les vivants pour, en s’accomplissant pleinement mais sans oublier leurs ascendants, ne pas les décevoir.
L’empathie de cette œuvre s’étend en somme à l’univers entier, morts compris, auxquels il convient de ne pas céder quand ils cherchent à vous séduire jusqu’à renoncer à la lutte, jusqu’à partager leur survie ralentie, mais qui sont capables aussi d’intervenir auprès des vivants pour les guider vers le salut. Ainsi, dans la dernière et inoubliable séquence, la morte qu’on avait conservée dans un cercueil de fortune, au fond du « fumoir » de la ferme isolée, en espérant une éclaircie pour la conduire enfin en terre consacrée, cette morte qui fut belle et qui maintenant sent le mouton fumé quand s’offre l’aide des deux voyageurs pour la faire glisser, tel un traîneau, sur la neige, s’était d’abord matérialisée en secourable fantôme et avait conduit les pas des deux mourants vers la maison enfouie, impossible à repérer sous la neige. Et ce n’est pas sa faute si la pente du chemin devient bientôt assez déclive pour transformer le traîneau en bobsleigh et jeter les trois convoyeurs mortuaires dans un gouffre qui est peut-être celui du néant.
Ces thèmes excessifs, Stefánsson les traite avec une sûreté d’écriture extraordinaire. Le mode habituel de la narration, chez lui, est la phrase souple, longue, sinueuse, qui englobe sans solution de continuité la description, le dialogue et la voix off du narrateur proprement dit, qui ne se refuse jamais à insérer dans la trame de l’histoire un commentaire, ironique parfois, sentencieux souvent mais sans jamais verser dans la pastorale, et juge avec un faux détachement teinté de bienveillance les actes et les pensées de ses personnages. L’émotion submerge-t-elle l’un d’entre eux, sans crier gare le texte vire au dialogue direct, avec un naturel confondant, comme si l’auteur était persuadé qu’il n’a d’autre règle à suivre que celle de coller du mieux possible à sa propre « rage de l’expression ». Et c’est le cas en effet, en vertu de ce privilège exorbitant des poètes du plus haut lignage, qui est de faire souffler le vent dans la direction exacte où ils veulent.
Mais n’allez pas croire que cette liberté d’allure et de ton dispense Stefánsson de tout souci de réalisme. Peu d’écrivains disposent d’une faculté d’observation et de restitution de la « chose vue » aussi aiguë. Il est à cet égard le digne continuateur de Dickens, qu’il admire. Dans la première ferme, qui s’offre en havre aux voyageurs épuisés, le regard passe avec prestesse de la fillette qui tousse et ne survivra pas à la séquelle interminable de l’hiver, au petit dernier larmoyant qui ne peut s’endormir qu’entre les pattes et sous la langue miséricordieuse du chien. Au presbytère, le cabinet du pasteur, tapissé de volumes, luit comme une châsse dans l’immensité froide du bâtiment secoué par le vent mauvais. La dernière ferme, dont on ignore longtemps qu’elle abrite sur ses arrières un cadavre en décomposition commencée, une vieille femme qui devrait être morte et dont la longévité amoindrie nargue la forme en creux de la jeune mère qui a disparu, se dresse de temps à autre sur sa couche souillée et réclame du café, image terrible et ambiguë de la mort dans la vie. L’œil du peintre l’a capturée et nous la jette à la face comme une vision d’Egon Schiele. Cette vision d’un enfer bien terrestre, nous ne l’oublierons plus.
Maurice Mourier
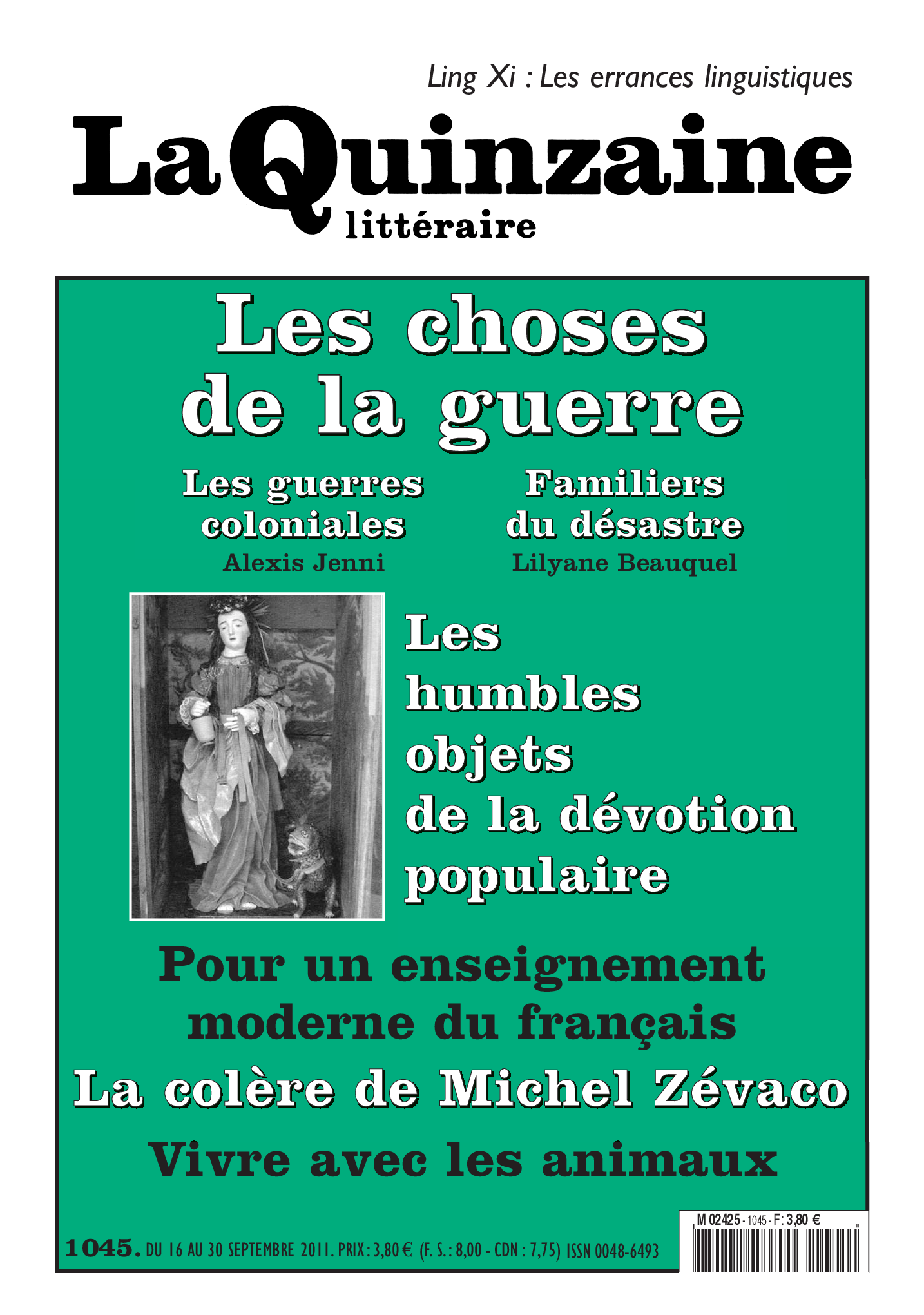

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)