À la fin, nous sommes toujours seuls, étrécis, singulièrement compacts, comme égarés au bord de notre vie, emportés par le mouvement d’un « passé opiniâtre », réduits à une existence minuscule totalement inscrite dans un présent qui grossit démesurément, circonscrite par la survie et « la précarité des choses ». Emily, matriarche de la famille Maxwell, n’échappe pas à la règle et, arrivée « à un âge où tout n’était que stagnation et attente », s’abîme dans un quotidien que viennent seulement troubler quelques incidents mineurs et les questions qui la hantent à la manière de fantômes domestiques qui accompagnent « le peu qui lui restait de vie ».
Le roman de Stewart O’Nan, avec une économie de moyens et une efficacité frappantes, nous fait plonger dans la répétition à peine troublée de la vie d’une vieille femme, ses habitudes, découvrant son quotidien fait d’attentes et d’activités répétitives et ritualisées – ses sorties avec sa belle-sœur Arlene, superbe personnage obstiné et émouvant, ancienne institutrice qui fume comme un pompier et continue à conduire malgré sa vue qui baisse dangereusement, les passages de sa femme de ménage, l’aide régulière de ses voisins, ses promenades avec son chien cacochyme, les listes qu’elle fait pour tout, sa passion du jardinage, l’écoute de musique classique… – qu’entrecoupent les visites brèves et compliquées de sa parentèle un peu paumée. O’Nan décrit avec un talent évident, dans une langue paisible et précise, le vide de la répétition, y instillant une angoisse discrète, le trouble profond qui perturbe les êtres, faisant éclater le temps qu’ils sentent « filer sous leurs pieds, tel un courant sous-marin ».
Pourtant, l’enjeu semble ailleurs, dans le débordement d’une trame qui paraît si commune, une manière d’écart, ce qui ne s’y nomme pas. Emily, Alone est évidemment un roman de la solitude qui semble consubstantielle au vieillissement, qui désigne l’existence comme une perte permanente, un renoncement à sa vie propre, au passé, à l’angoisse de la disparition en même temps qu’à son désir sourd. Pourtant, le Alone du titre original, que l’on ne retrouve pas dans la traduction, dit autre chose que la pure solitude, il relie le récit à sa source, un roman précédent (1) qui, sous une forme contraire, en proférait les prémisses. En effet, Emily se trouvait déjà au centre d’un récit choral très long qui se déroulait le temps d’une semaine de vacances dans le cottage familial qu’elle avait décidé de vendre après la mort de son époux et de toutes les réminiscences angoissées que tous les personnages – ses enfants, Kenneth et Margaret, les leurs, Sam, Justin, Ella et Sarah, Arlene et elle-même – semblaient devoir revivre à mesure qu’ils renonçaient à une part d’eux-mêmes et de leur passé sublimé. Ici, le récit semble se réduire à la mesure de la vie d’un personnage qui passe de la partie au tout, faisant du roman le lieu d’une concentration, d’une précision, d’un approfondissement. La tristesse, comme la joie, demeure singulière, intime, repliée au fond de soi. O’Nan semble devoir l’en extirper avec obstination et tendresse.
Nous passons de la symphonie au récital, du chœur au solo, du collectif à l’individuel. Le roman entreprend de fouiller, avec plus de précision, le sentiment de la perte, de ce qui se désagrège, ce qu’elle « avait l’impression de perdre morceau par morceau ». O’Nan y appuie en faisant le choix de la brièveté, de l’unicité d’un point de vue qui semble contredire le récit précédent, l’apurant, le restreignant tout en en reprenant les éléments. Ce n’est nullement un hasard si les deux livres débutent par une scène quasi identique, où Emily prend en charge un rapport entre les objets, leur matérialité, et la mémoire, la dévidant au rythme de leur saisissement présent qui provoque un retour sur les fondements d’une vie typiquement américaine, discrète, matérielle, silencieuse. O’Nan, écrivain hétéroclite, s’attache à dire quelque chose de l’Amérique, de ceux qui la peuplent, des sentiments singuliers qui nourrissent son identité, de leurs propres héritages. Nous sommes néanmoins assez loin des bavardages ennuyeux de Ford ou des approches sociologiques boursouflées de Franzen, mais plus près de la profondeur roborative de Yates, de sa discrétion, de son épure (2). Comme nombre de personnages de leurs romans, Emily conforme l’égarement de l’individu, sa réduction, son rétrécissement face à l’énormité du temps.
Pourtant, le roman paraît comme habité par un sentiment d’inassouvissement absolu, tenu entre le regret de l’inaccomplissement et la joie de se reconnaître. Il s’y love une vision morale du monde claire qui confine au malaise. Emily demeure sujette, « après toutes ces années, à une forme de désir inassouvi » en même temps qu’« elle avait envie de revenir en arrière ». Le cœur du récit se loge dans cet interstice paradoxal, entre deux formes d’impératifs qui structurent sa vie. Ainsi, le passage du temps conforme une disproportion entre cause et conséquence, ce qui produit un effet et la place démesurée de la pensée qu’il provoque. Ce qui demeure du passé fait signe par-delà les années évanouies, s’entrechoque avec un présent vide qu’il faut vivre néanmoins. O’Nan livre alors un étrange récit d’apprentissage inversé qui signifie le passage du temps, son apprivoisement, sa découverte réjouie malgré tout. Emily apprend à vivre une autre vie, en découvre la liberté étrange, presque invraisemblable. Il en ressort un apaisement, une sérénité retrouvée, un optimisme étrange qui poussent une femme arrivée au bout de son existence à entreprendre le présent comme une succession d’aventures infimes et stupéfiantes qu’il faut avoir le courage de vivre vraiment.
- Nos plus beaux souvenirs, Points Seuil, 2005. Le titre original (Wish you were here) enrichit l’interprétation du roman, le grandit en quelque sorte.
- Nous pensons à la trilogie de Richard Ford consacrée à Franck Bascombe (en particulier L’État des lieux) aux Corrections de Jonathan Franzen et à La Fenêtre panoramique, Easter Parade ou Un été à Cold Spring de Richard Yates. Notons que Ford et Yates semblent constituer des modèles pour O’Nan.

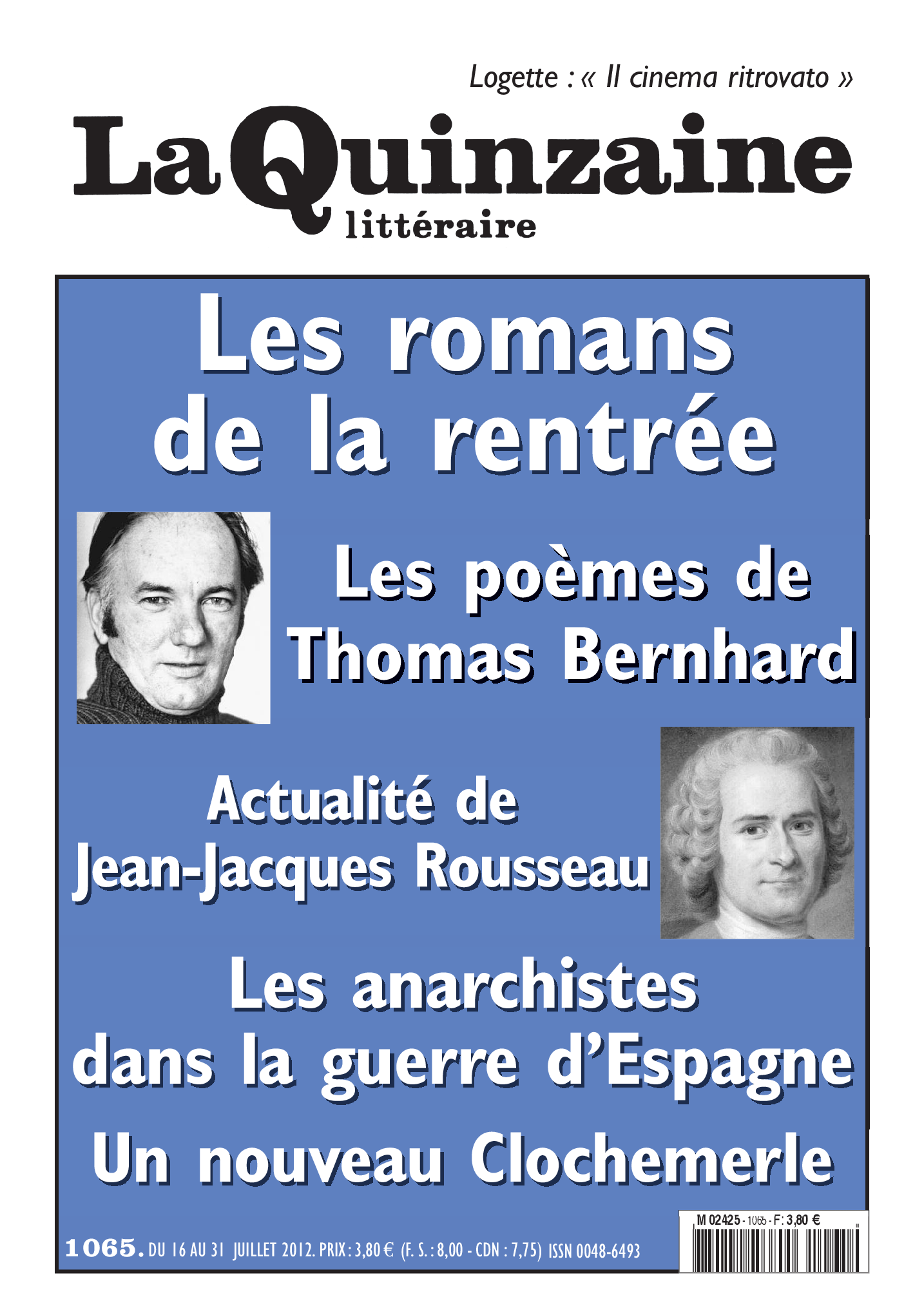

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)