Il y a d’abord la force du titre, Le Roman inépuisable, qui semble particulièrement adapté à l’énergie déployée depuis des années par Philippe Le Guillou, écrivain et passeur, comme l’un de ses derniers ouvrages le laisse entendre[1], investie dans la défense d’un genre dont on annonce la fin depuis les années 1930. L’idée du titre viendrait d’une lecture forte, celle du Roman du roman de Jacques Laurent, qui lui donne son sous-titre. Le projet prend la forme d’un héritage : « À mon tour je rêve le roman, vulnérable, et surtout résistant, vivace, coriace, traçant les contours de son champ émotionnel. »
Il s’agit bien d’une série de chants ou de « déambulations » dans les parages du sacré, où l’enthousiasme est lisible partout, à l’image de l’incroyable professeur qu’il fut lorsque je le rencontrai au milieu des années 1980 à l’occasion d’un remplacement de notre professeur de spécialité qui, souffrant, ne pouvait poursuivre son cours sur Une vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly. Ce remplaçant inconnu de nous n’était à l’évidence ni un philosophe, ni un théoricien, mais un spécialiste de l’imaginaire et du style. Une tout autre école que celle qui dominait à l’époque, mais branchée sur les mêmes fondamentaux structuralistes, quoi que l’auteur en dise. Que l’imaginaire d’un auteur soit structuré comme un langage et que le langage du style soit l’expression de cette logique interne, ce jeune professeur nous le livrait sans lourdeur ; nous étions directement aux sources actives du prodige narratif et symbolique, dans l’architecture du son, dans le vitrail des images associées, dans les ondes enchaînées du verbe et de la poésie. Nous nous retrouvions devant un professeur dont l’efficacité provenait de sa profonde empathie avec le texte, autrement dit un écrivain qui en commentait un autre du point de vue de la structure de l’imaginaire. Dans l’intuition libre et la rigueur du propos, nous étions bien dans un AUTRE espace théorique, mais en quelque sorte vécu. C’est ce que l’on retrouve ici, avec une strate supplémentaire due au recul, à la franchise, à l’affirmation de plus en plus nette des choix qui ont à voir avec une quête de définition intérieure. Présenté par l’auteur comme une « bibliothèque élective », ce livre relève aussi d’une histoire littéraire de soi et du roman du lecteur. Cet essai se développe donc comme un grand acte de nomination : il découpe dans l’histoire de la littérature ce qui spécifiquement fait source et racine dans la construction d’une identité d’écrivain. La matière de Bretagne, d’abord, mille fois revendiquée, à laquelle l’œuvre souvent a porté ses propres alluvions sous la forme d’un cycle celtique ramifié (lire le morceau de bravoure que constitue Livres des guerriers d’or), mais aussi des « moments », comme le « moment Rabelais » que Philippe Le Guillou évoque avec force.
La capacité à admirer est ici partout présente, à l’image de ces pages fines sur La Princesse de Clèves qui donnent envie de relire encore ce récit de cristal et de vie. L'essai interrompt pourtant rapidement le défilé des époques, et les parenthèses fusent un peu partout au profit de bonds temporels et d’entrelacs entre les œuvres des siècles passés et les figures plus récentes, où l’attraction des figures sulfureuses de la littérature de droite se mêle à un goût radical pour des auteurs politiquement opposés. Rien d’étouffant pourtant ici, mais plutôt une liberté de choix parfaitement assumée, à contre-courant parfois de nos manuels et de nos anthologies classiques :
« En matière de lectures et de goûts littéraires, on l’aura compris, la contrainte n’est pas ma chose, l’exhaustivité encore moins, une bibliothèque constituée de haillons et de segments erratiques ne me dérange guère et je saute, avec une certaine allégresse, de Madame de Lafayette à Laclos. On ne me trouvera pas en dévotion aux pieds de Gil Blas et du Paysan parvenu, pas même de Manon Lescaut [...] J’ai bien conscience, et je m’en flatterais presque, d’être littérairement incorrect. »
Dans ce contexte de liberté et presque d’anarchie temporelle (« Il n’est de vraie critique que passionnelle, libre, subjective, emportée »), le fil conducteur est pourtant parfaitement clair : animé par des citations soigneusement sélectionnées, parfois longues, le propos vise au plaisir infini du texte, lorsqu’il est source de plaisir, d’étonnement, de sidération, de grâce. On déambule ainsi dans un florilège où les découvertes ou redécouvertes sont nombreuses, et il semble souvent qu’on réapprenne à lire, de près, ce qui se cachait au fin fond du roman de Laclos, au détour d’une phrase de Senancour, de Chateaubriand ou de Proust, bien sûr, l’une des références majeures. On se prend même à désirer relire Vie de Rancé, ce qui relève de l’exploit. Le XIXe siècle occupe de fait une place importante dans cette « bibliothèque intérieure », les siècles précédents étant évacués en cinquante pages. Le feu passionnel s’emporte alors très vite du côté de Stendhal (très belles pages sur Lucien Leuwen) que l’auteur joue contre Balzac (« le réalisme balzacien s’apparente à un registre noirci ») avec une exception (heureuse) pour Béatrix, Hugo, Flaubert (collectionné et adulé pour Madame Bovary contre L’Éducation sentimentale), se refroidit brutalement au contact de Zola, se rallume près de George Sand, s’enthousiasme devant la singularité de Huysmans, de Bloy, de Barbey d’Aurevilly, se souvient de l’enfance auprès de Maurice Leblanc et de Jules Verne.
On traverse ainsi le temps, avec la crise du roman au début du XXe siècle et Gide, puis étrangement Tournier, longuement commenté, prince de l’imaginaire. Croisant la biographie du jeune hypokhâgneux qu’il fut et fonctionnant comme révélateur, bien souvent évoqué dans les essais précédents, voici Marcel Proust, l’éblouissement. Puis les découvertes contemporaines, les rencontres, avec Patrick Grainville. Peu à peu (et si l’on y prend garde, dès les premières pages), la chronologie personnelle prend le pas sur l’histoire littéraire, la mémoire et l’émotion imposent leur tempo à ce qui ne peut être une anthologie, ni un manuel, ni un cours. Plus on avance, plus l’évidence s’impose. Ce qui apparaît, dans cette liberté d’écriture que rien ne semble contenir, c’est que l’essai absorbe son auteur même, non pas dans un processus d’assimilation aux grands auteurs dont il est question, mais dans un jeu d’images qui concerne plutôt l’autoportrait en romancier, situé souvent en abyme au fil des chapitres et par quoi il continue de se définir, à la fois comme professeur, essayiste et écrivain. Ce très beau temps de lecture de Lucien Leuwen en est un exemple dans cet ensemble foisonnant et parfois labyrinthique : soulignant la pertinence de la lecture de ce roman moins connu de Stendhal par Gilbert Durand, Philippe Le Guillou en vient à synthétiser son propre travail :
« Le romancier a beau se préoccuper de politique et d’histoire, il reste avant tout dépendant d’un imaginaire, de son imaginaire, et il n’est pas nécessaire de laisser libre cours à une fantasmatique débordante, ces figures secrètes sont tissues à la rêverie intérieure, profonde, de l’écrivain, elles dessinent une géographie subjective, qui est la marque propre de l’artiste ; le régime, diurne ou nocturne, des images donne au livre sa couleur singulière et l’éclairement est évidemment lié à ce régime qui puise aux sources de l’archétype. De la même manière, l’architecture symbolique des lieux, qu’ils soient élevés ou plongés dans la profondeur de la terre est essentielle et l’alternance des perspectives surplombantes et des chambres ou des chapelles enfouies confère au récit sa richesse son rythme et impose l’idée d’une cartographie mystérieuse sujette à la rêverie et au déchiffrement. »
De Rabelais au dernier prix Goncourt, le principe est le même : il est celui des fraternités, des affinités, des contacts frontaliers et des géographies croisées. C’est un essai sur le roman, et c’est une autobiographie. On se croyait pris dans une brillante lecture des grands auteurs, on entre en réalité dans le cœur émotionnel et le récit de soi, qui se reflète aux pages des livres. On voit grandir au fil des références et des commentaires une forme d’exofiction passionnante et vivante qui fait l’originalité de ce Roman inépuisable. Il ne serait pas impossible de deviner dans les centaines de personnages qu’il abrite une dissémination de l’identité centrale de l’auteur en autant d’instances imaginaires et de définir cet essai proliférant… comme roman.
[1] Philippe Le Guillou, Le Passeur, Mercure de France, 2019.
Luc Vigier
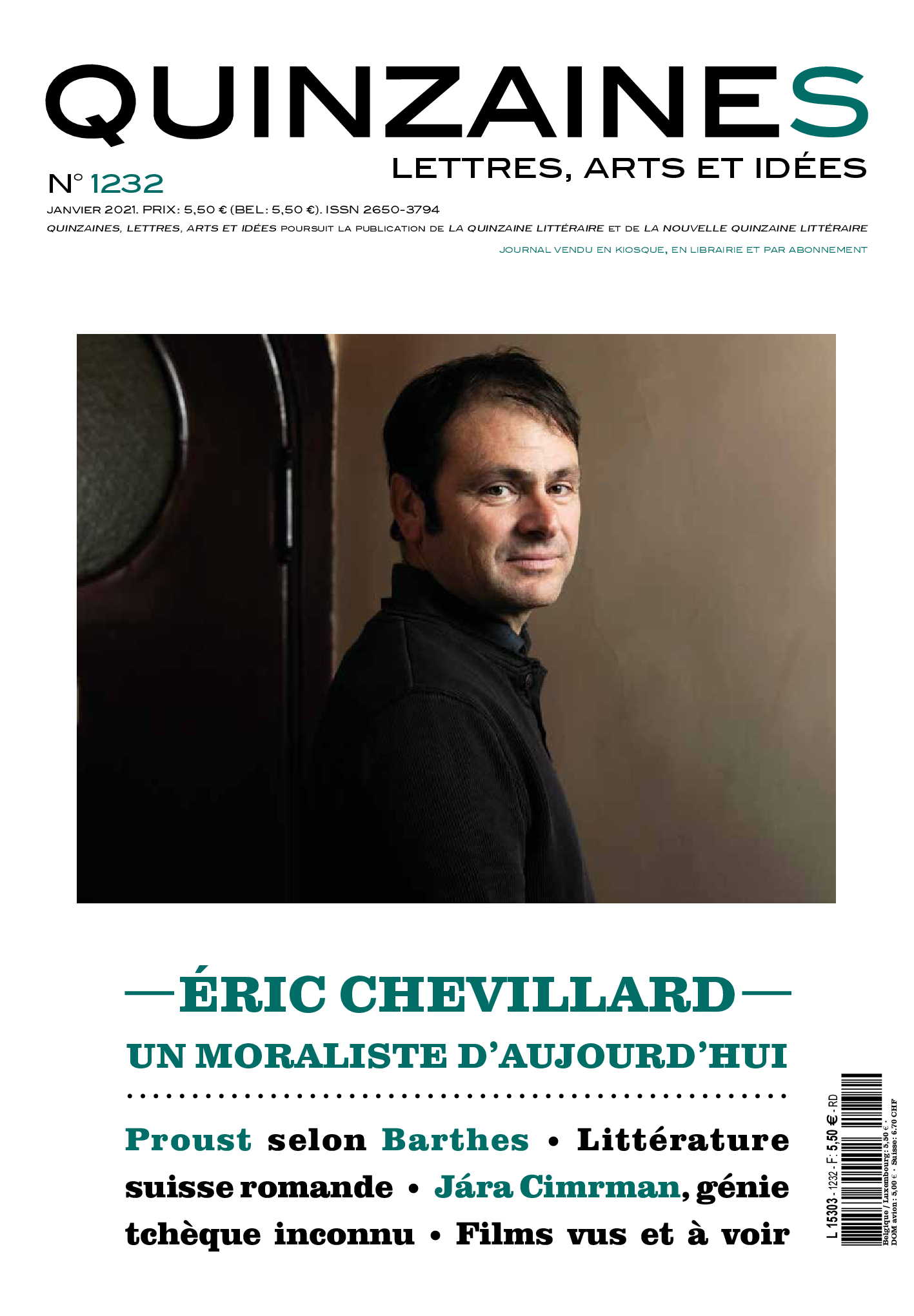

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)