Le fil qu’il tire est celui d’une pelote de laine nommée Allemagne, celui du voyage en Allemagne de Beckett dans les années 1936-1937, en pleine montée du nazisme. L’épiphanie retrouvée, exhumée, a pour nom la rencontre de Beckett avec l’œuvre du peintre Friedrich. Comment une création picturale peut-elle être un des affluents qui catalysent la genèse d’une œuvre ? Un réseau d’échos se tisse. Les flux de reconnaissance entre l’écrivain et l’artiste se prolongent dans l’évocation des affinités triangulaires entre Stéphane Lambert, Beckett et Friedrich, dans un jeu d’intercessions complexes.
Auteur de romans qui réinventent le genre romanesque au fil d’une écriture hantée (Charlot aime Monsieur, L’Homme de marbre, Mon corps mis à nu, Paris nécropole…), de recueils poétiques, d’essais fictionnels (L'Adieu au paysage : Les nymphéas de Claude Monet ; Mark Rothko : Rêver de ne pas être ; Nicolas de Staël : Le vertige et la foi), Stéphane Lambert s’installe ici dans les bruissements du pré-Godot et écoute les forces qui ont mené Beckett à mettre en forme le chaos de son malaise, le maelström de ses sensations. Comme dans ses approches intimes de Rothko, de Nicolas de Staël, ou encore dans son magnifique essai poétique sur François Muir, il a une façon tout à fait originale d’entrer en contact avec une œuvre : en tordant les frontières entre essai, biographie et fiction, en convoquant tous ces registres pour les fondre dans des œuvres-diamants nées de l’alliance du plus subjectif et de l’objectivité des faits récoltés, transfigurés en clés de vision.
Stéphane Lambert passe derrière les textes, derrière les toiles, dépassant la stérile opposition entre les partisans du Contre Sainte-Beuve – c’est-à-dire de l’autonomie des œuvres par rapport à la vie de leur auteur – et les adeptes d’une lecture biographique. Un radar aiguisé – une lecture en hypnose – repère le choc qu’éprouve Samuel Beckett à la découverte d’un tableau de Caspar David Friedrich, Zwei Männer in Betrachtung des Mondes (Deux hommes contemplant la lune), à Dresde en 1937. Beckett reconnut lui-même cette influence décisive, pointant cette rencontre comme une source d’inspiration d’En attendant Godot. Stéphane Lambert dévoile un phénomène d’après-coup qui complique la donne, qui, brisant la linéarité de l’influence, recouvre un premier face-à-face refoulé, enseveli, la sidération fascinée devant le célèbre tableau de Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer (Le Voyageur contemplant une mer de brume), découvert à la Kunsthalle de Hambourg en octobre 1936. Nulle gratuité dans ce jeu de pistes spéléologiques : outrepassant l’érudition, l’enseignement retiré du vaste travail de recherches, de documentations, Stéphane Lambert entrouvre un petit coin de l’édifice beckettien dans sa phase de construction et y décèle une expérience fondatrice, actée lors de la rencontre avec l’univers de Friedrich.
Une communauté des exclus, des solitaires, une confrérie d’initiés déchirés par l’absolu, brûlés par une sensibilité exacerbée, se trame au fil de connexions naturelles, quasi physiologiques. Comme un phénomène de génération spontanée, d’attraction magnétique entre « perdants » pariant pour d’autres régimes de vie. De même que Beckett a trouvé en Friedrich et dans Geulincx, un philosophe flamand du XVIIe siècle, des interlocuteurs, des funambules du désespoir, des alter ego, des miroirs, de même Stéphane Lambert reconnaît en Beckett un frère en butte à ce même effroi que procure l’exercice du vivre. L’auteur ne surplombe jamais les doubles qui l’ont choisi autant qu’il les a choisis. Une logique sensitive, viscérale, se met en place entre des créations où court une même sève, une même croissance végétale. Les analogies profondes entre les œuvres ne suivent pas le fil de la raison froide mais l’aiguillon de la survie : les créations de Friedrich et de Beckett témoignent de la nécessité de trouver une manière de composer avec l’invivable, avec la dévastation. Des œuvres véhiculent des énergies que d’autres artistes recueillent, à l’instar de l’image nietzschéenne des flèches lancées par un penseur et relancées par des héritiers. Pour Friedrich, pour Beckett, l’art est prière, l’art est un chemin emprunté pour créer un espace où exister sans sombrer.
Trouver une forme
La nécessité impérieuse de Beckett – « Trouver une forme. À cet état d’être dont il mesure toutes les limites. À son incapacité de vivre » – vibre de la même intensité que celle qui irrigue l’entreprise de Stéphane Lambert. La percée du savoir vers l’inconnu, la traversée des connaissances vers un savoir sauvage, premier, enfoui, le dépassement de l’intellect afin de regagner le langage du corps qu’entreprend Beckett, sont semblablement mis en œuvre dans Avant Godot. Les états de crise dégrisent, font tomber les faux-semblants, les voiles, révèlent l’absurdité de l’existence, sa contingence. Ils détrônent un savoir infatué, stérile, ancré dans une gymnastique conceptuelle qui rate le continent sauvage du corps. Pour trouver une issue à la débâcle psychique qui le frappe dans les années 1930, qui reviendra le terrasser tout au long de sa vie, Beckett doit se délivrer. De l’ombre de Joyce d’abord, ce géant des lettres qui obstrue le champ des possibles. Joyce dont il reprendra, sur le versant opposé, minimaliste, écorché, sans chair, l’appel à faire de la forme le contenu et du contenu la forme, à inventer un autre état de la langue. À la luxuriance accumulative, à la tour de Babel des langues intriquées, invaginées, que produit Joyce, Beckett opposera l’opération soustractive du décharnement linguistique, l’épuisement des combinatoires langagières.
Si le savoir se lézarde, il faut affronter l’insaisissable, sans filet, sans viatique, à mains nues : « Fracture de soi avec soi. Fracture de soi avec la réalité extérieure. Démission de l’ordre social ». Beckett se cogne à l’impuissance de la pensée, à la rupture entre lui et le monde. Une vie déconstruite, ensevelie dans le brouillard, ne peut se phraser dans une construction fictionnelle classique. Les mots doivent s’ouvrir sur l’expérience de l’émiettement, du vide. Ils doivent se délester de leurs mensonges rassurants, courir vers le non-mot, là où la pensée s’arrête, atteindre par leurs moyens propres cet état où vibrent les non-mots. Ces non-mots, Beckett les trouvera dans l’art du visible qui congédie le dicible, dans la peinture de Friedrich. Même si, comme le conceptualisera Deleuze, un créateur n’a pas à importer les découvertes venant d’un autre champ de création mais à expérimenter avec les ressources de sa discipline les métamorphoses vers un ailleurs. Pour ôter la chape intellectuelle du verbe, pour le rouvrir à ses pulsions non domestiquées, il faudra maltraiter le langage, l’excéder, faire basculer ses limites, bousculer les vocables, les éventrer jusqu’à leur faire toucher le non-mot, la puissance de choc de l’image. Joyce parlait de s’aventurer « près du cœur sauvage », ce dont Clarice Lispector se souviendra dans sa fulgurante fiction au titre emprunté à Joyce.
Ouvrir les mots à l’image
Nul, si ce n’est Artaud, n’a montré comme Beckett que l’écriture ne s’enlève qu’à partir de et sur l’impossibilité d’écrire, qu’elle ne jaillit que du fond de son impuissance, quand les mots se retournent sur leur avant, s’éventrent afin de toucher le réel pré-langagier, la rugueuse présence des choses. « Combien Beckett avait trouvé une forme littéraire pour dire ce qui ne pouvait être dit, qui relevait de l’en-deçà du cortex de la pensée et des sensations, comme si le texte matérialisait cette zone subconsciente, articulait cet espace d’avant le dire, formait un autre corps, le corps informe, émietté de l’innommable, qui de l’effacement tissait son existence comme une ombre rebelle, un mort qui ne serait pas né. » Surgi de la terreur, de la nuit, le seul dire qui se torde en graphèmes est celui de l’innommable, de l’indicible transmué en chant instable. Réinventant la langue, Beckett comme Artaud réinventent, rejouent leur naissance, leur corps. La lutte incessante que mène Beckett contre le langage entend pulvériser ses limites, dynamiter l’enceinte de l’écriture en y creusant du visuel, en y forant des trous. Le choix de Beckett sera de dépasser l’étroitesse du langage en y important l’image, c’est-à-dire le silence. Dans cette guerre déclarée au langage, le passage de l’anglais au français s’imposera comme une des modalités « pour explorer l’envers du connu ». Ici encore, Beckett s’éloignera de Joyce, se tenant du côté de la tentation du silence, de la tentation de déposer les armes du verbe comme Louis-René des Forêts, au plus loin de la jubilation de jouer avec les tribus folles des mots dont témoignent les œuvres de Joyce, Guyotat, Cixous, Valère Novarina.
Remplissant une fonction révélante, le tableau de Friedrich lui intime deux choses : primo, faire subir aux mots une transmutation afin de les doter de cette force d’interpellation immédiate que possède l’image ; secundo, « changer cette déréliction qu’il ressentait profondément en littérature », transformer l’impossible, l’obstacle, en ressort, en atout créateur. Friedrich, Geulincx, deux intercesseurs, deux passeurs voyageant entre monde des morts et monde des vivants, qui permettent à Beckett de trouver une issue littéraire et une issue existentielle, dès lors que les deux ne font qu’un. Dans la crise existentielle endurée, la philosophie de Geulincx agit comme un deuxième électrochoc, aux côtés de l’enseignement délivré par Friedrich. Vers 1936, Beckett traduit en anglais les écrits de Geulincx, ses réflexions sur l’hiatus entre l’homme et le monde, entre le corps et l’esprit. Trouver une forme littéraire, une forme esthétique, ce sera inventer une façon de se tenir dans l’existence.
Fasciné par les artistes qui œuvrent au bord de l’effacement, afin de se défaire du moi, d’atteindre des régions impersonnelles, Stéphane Lambert voit dans la création un mouvement de descente vers l’enfoui des sens, vers les disparus, les grands fonds dont on n’approche qu’à perdre les contours de l’ego. Ce rêve de « se décharger de soi », du fardeau d’être soi, de « chercher un au-delà de soi », habite les créatures de Beckett, de Murphy à Watt, de Vladimir et Estragon à Minnie et Willie, de Molloy et de Malone à Krapp. Ce motif de l’effacement, l’auteur en a révélé le rôle agissant chez Rothko, chez Nicolas de Staël.
Avec délicatesse, Stéphane Lambert révèle le fil qui relie la constellation Beckett/ Friedrich/lui-même : l’épreuve partagée d’une difficulté, d’une incapacité à vivre quand l’existence ne va pas de soi : « Créer pour résister au pire, qui est là, toujours prêt à exécution ». Créer comme issue pour qui se débat dans les eaux de l’inadaptation fondamentale, dans la solitude de qui n’est pas de plain-pied avec ce monde. Loin de recentrer les décentrés, l’écriture et la peinture disposent le site d’un autre vivre, à l’écart du plan habituel, sans lever la dislocation. De façon décisive, avec élégance, Stéphane Lambert fait un sort aux lectures bémolisant le tragique de Beckett (serait-ce afin de le rendre plus acceptable, moins troublant ? se demande-t-il). La noirceur de Beckett n’est pas soluble dans les eaux de l’humour.
Cette remarquable plongée dans les arcanes, dans les soubassements de la création est sertie dans une langue superbe. Sa lecture organique relève du registre de l’écoute intime. C’est par sa proximité avec les œuvres qui s’emparent de lui, par sa mise en abyme dans des univers frères que Stéphane Lambert éveille les œuvres à des puissances, des dimensions insoupçonnées jusqu’alors. Avec voyance, doté d’une formidable intuition, il débusque, déterre des pans de l’œuvre. En partant d’un épisode pouvant être vu comme périphérique (la rencontre de l’œuvre de Friedrich), il remonte, tel un sourcier, dans le massif des textes et touche le noyau central de l’œuvre. Son très bel essai sur Nicolas de Staël opérait déjà ainsi : l’air de rien, sous une guise impressionniste, en confrontant des échos de sensations entre lui et l’artiste élu, il met en lumière des zones d’ombre, part d’une échancrure dans la cathédrale des créations pour en soulever des motifs qui apportent des niveaux d’intelligibilité inédits. On croyait avoir tout dit sur le « mal vu mal dit » de Beckett ; qu’on se détrompe : un autre Beckett surgit des brumes des paysages romantiques de Friedrich. Les sans-boussole inventent des modes de navigation qui désarçonnent les textes, qui en dévoilent les tropismes souterrains, les nappes d’inconscient. Qui se retrouve défait par des forces du dedans ou du dehors peut trouver dans la création l’occasion de se refaire pour se défaire à nouveau. Se délestant du poids étouffant des exégèses, Stéphane Lambert rouvre des grands morts et lance ses joyaux de Petit Poucet. Magistral.
Signalons la parution du tome II de la correspondance de Beckett, Les Années Godot : Lettres II 1941-1956, traduit par André Topia, édité par George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn et Lois More Overbeck, Gallimard (768 p., 54 €).
Véronique Bergen
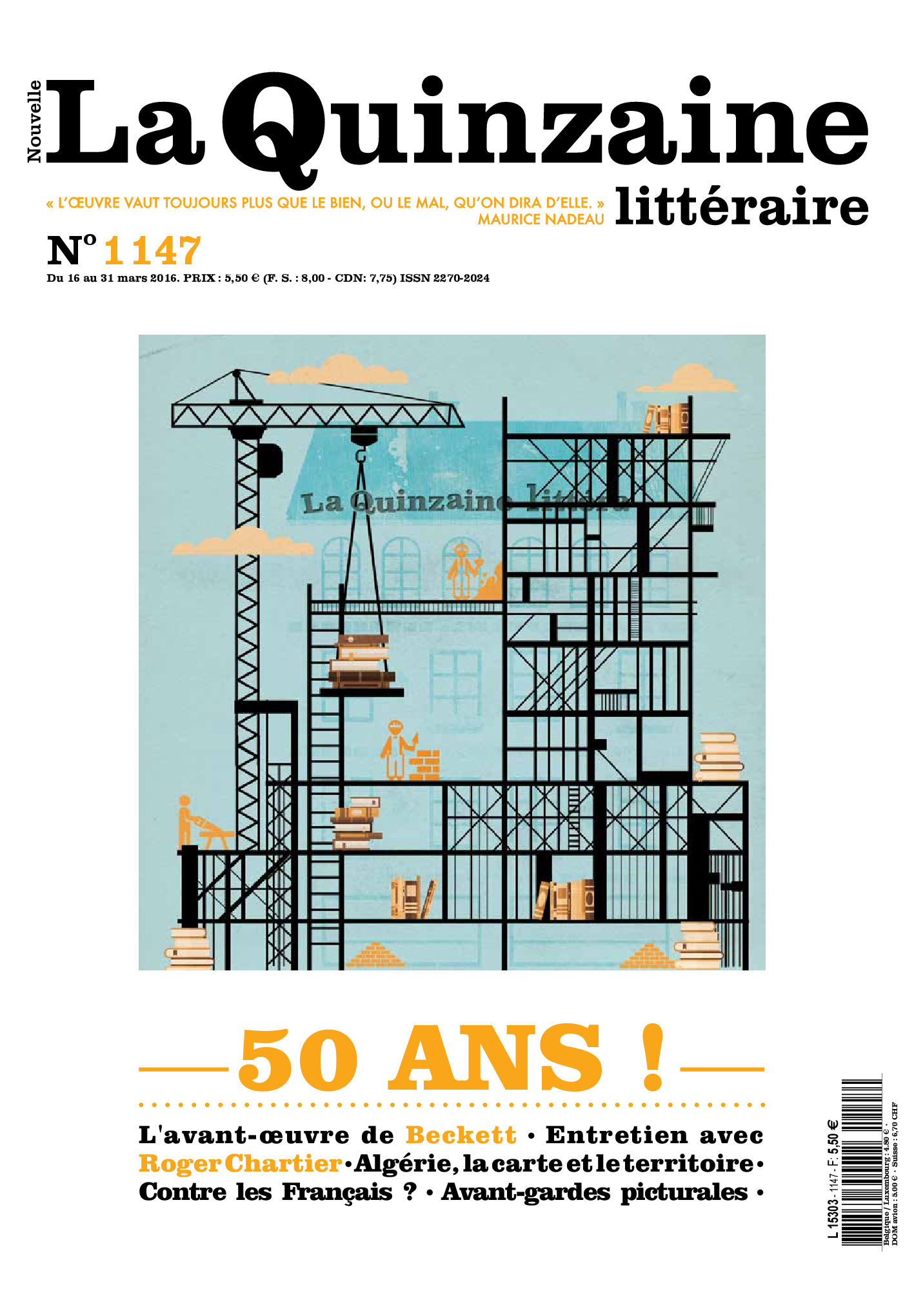

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)