Ainsi se présente aussi l’ensemble du roman. Des pans d’histoires se croisent, se mêlent et on n’en connaît pas tous les fils, on n’en a pas toujours les tenants et les aboutissants. Le conteur et narrateur a rencontré et écouté les quelque quarante personnages qui traversent ces sept cents pages. Les cafés, les hôtels, les réunions de famille, tous les lieux et circonstances sont bons pour tenter de rassembler ce qui va disparaître. Une sorte d’urgence anime ce narrateur, un peu comme elle poussait Marcel, le narrateur de Marcel Proust, à ne jamais s’arrêter d’écrire. Et puis le conte, n’est-ce pas en un autre Orient ce qui sauve Shéhérazade de la mort ? Raconter est une façon de survivre ou de vivre.
Le narrateur raconte mais son récit est souvent troué, débute de façon impromptue, in medias res, et reste inachevé. Ou plus exactement on en retrouve les protagonistes bien des pages après, un peu comme on perd de vue des êtres dans une ville, dans une vie. Ces sauts dans le temps ou dans l’espace du livre sont comme des jeux de miroirs, des éclats diffractés qui donnent à voir les personnages sous divers angles, dans des lumières changeantes.
Istanbul était un conte : presque tout est dans le titre, comme une essence que l’on respirera ensuite dans une sorte d’envoûtement. Levi est de la cité turque comme Bassani de Ferrare Shahar de Jérusalem et Durrell d’Alexandrie. La ville et ses noms de quartiers, de rues, suscite en elle-même une rêverie ininterrompue. Sa position géographique entre deux continents, entre Orient et Occident, la présence des eaux qui s’y rencontrent, celles de la mer Noire et celles de la Méditerranée créent un horizon, déterminent le trajet des personnages et bien sûr imprègnent l’atmosphère de ce roman. Dans son beau livre sur Istanbul (1), Orhan Pamuk évoque le hüzün, la mélancolie turque. On la retrouve bien souvent dans le roman de Mario Levi et on s’y laisse prendre, comme lecteur. Monsieur Jak, Madame Perla, Olga comme Monsieur Rober, tous mènent une existence fragile en ce XXe siècle tourmenté, dans une cité qui est certes loin de l’Histoire et de ses violences, mais jamais complètement à l’écart. On trouve dans ce roman les échos atténués de la Première Guerre mondiale, des révolutions et des totalitarismes, d’Auschwitz et d’un génocide antérieur, mais les dates, les faits précis sont souvent des traces fugaces, des indices, un propos ou une lettre, un souvenir ou une cicatrice. Nesim qui a quitté Istanbul pour Biarritz, croyant y trouver un refuge, la possibilité de vivre autrement, de construire ailleurs, finira avec les siens dans le brouillard de Silésie. On tentera de cacher son sort aux siens, aussi longtemps que possible, en vain.
Mais on ne saurait résumer cette somme à la présence insidieuse de l’Histoire. Istanbul était un conte tisse les liens entre des êtres, les liens les plus ordinaires, et donc les plus essentiels : le désir, la perte de celui ou de celle qu’on aime, le chagrin, les joies les plus communes, les existences contrariées, c’est la matière de ce roman. On vient de partout à Istanbul, et on quitte la ville, aussi : Londres, Haïfa, Paris, mais aussi Vienne et Saint-Pétersbourg sont les villes qui brillent comme des étoiles. On en rêve ou on y a connu des souffrances, on les regrette ou les oublie. Le lecteur ne sait pas tout, pas davantage que le narrateur qui essaie de combler des vides, sans toujours y parvenir. Ce goût pour l’inachevé qui nous constitue, on le perçoit dès les premières pages, à travers la présentation des divers personnages. Le lecteur soucieux de précision, rationaliste méticuleux, attendrait un arbre généalogique ; il découvre une évocation poétique, comme dans ce portrait d’Ükran : « Elle rêvait toujours de quitter son petit appartement sombre pour aller vers le soleil. Son histoire aurait pu être le récit d’un fait divers banal dans les pages d’un quotidien ». Poésie disions-nous, mais de cette poésie issue du quotidien, de l’insignifiant qui prend sens et forme et transforme une existence en destinée. L’écriture de Levi transfigure ces êtres si simples, si ordinaires, que nous aurions pu côtoyer. Personne ne se distingue dans ce roman et, pour définir ce monde, on pourrait reprendre le propos de Sikelianos repris par Pamuk : « Ici, aucun ton n’est dominant. Quoiqu’on entende, c’est le son du monde entier. » Istanbul est l’une des incarnations du cosmopolitisme. C’est pourquoi, parmi les « sons » qu’on entend dans ce roman, les paroles des uns et des autres en judéo-espagnol jouent un rôle majeur. Cette langue, portée par ceux que l’Inquisition avait exclus est aussi celle des communautés grecques (Salonique est en arrière-plan dans le roman), bulgares, voire italiennes. Levi a choisi de placer les propos en judéo-espagnol avant leur traduction, comme Daniel Mendelsohn l’avait fait pour le yiddish, dans Les Disparus. Partir de la langue qui se perd est une façon de la sauver de l’oubli, d’amener le lecteur au cœur, par ce détour.
Si le roman de Levi est cosmopolite, c’est aussi parce qu’il est ancré dans la communauté juive si forte et présente dans la cité turque. L’Alliance israélite universelle est l’école qui a formé les élites du pays quand elles ne fréquentaient pas Galatasaray. Les synagogues étaient nombreuses et on y pratiquait un judaïsme tolérant, ouvert sur l’étranger et sur la modernité. On le retrouve à travers les personnages, et dans les rituels qui rythment la vie du croyant : Roch Hachanah, Pourim, Pessah, fêtes familiales lors desquelles on se rassemble autour d’une recette ou d’un menu sont des moments-clés pour les protagonistes comme pour le narrateur. La sensualité d’un plat épicé renvoie à celle d’une femme qui attire ou trouble. La nourriture est également fragment d’un monde qui disparaît ; les derniers effluves s’envolent et ne subsiste que le souvenir.
Istanbul était un conte se savoure comme l’un de ces plats évoqués. Mais il se lit aussi comme on « lit » la ville. On se perd, on se repère aux titres des contes comme on le fait aux noms de rues et qu’importe si la flânerie ne mène pas quelque part ; l’essentiel est d’avoir fait le chemin. C’est un roman qu’on peut lire au hasard, comme on prend une conversation de café au vol. Peut-être vaut-il mieux l’ouvrir de cette façon, sans chercher la route la plus droite. On n’en goûtera que mieux la profondeur, derrière l’anodin.
- Istanbul. Souvenirs d’une ville, Gallimard, 2007.

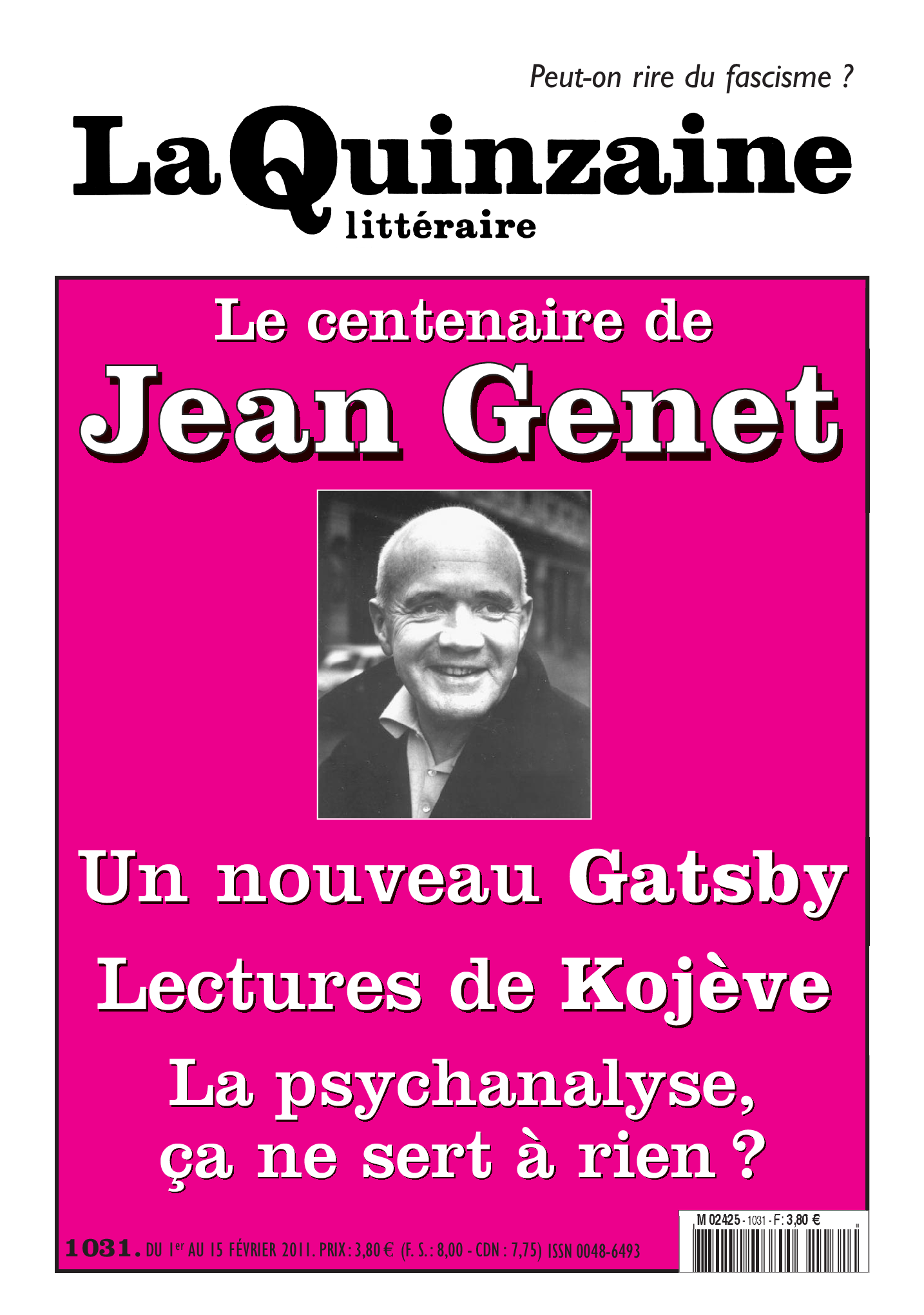

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)