L’ouvrage se donne comme le récit rêveur d’une rencontre, à la fois réelle et largement fantasmatique, source de l’écriture et entièrement recréée par elle. De cette rencontre à l’occasion de l’anniversaire de l’artiste, l’écrivain fait un matériau qu’il recompose à sa guise. La page blanche y joue le rôle inspirant du noir pour l’artiste.
Ce livre est un défi à la tradition des textes d’écrivains consacrés à la peinture, qui se sont multipliés depuis plus de deux siècles. Après la longue pratique des ekphrasis (description d’objets et de scènes comme s’il s’agissait d’oeuvres d’art), remontant à Homère et Virgile, et fréquente au XVIIe siècle, Diderot a été le premier à donner une légitimité littéraire à la critique picturale, en rédigeant ses Salons pour la « Correspondance littéraire » de Grimm. Son exemple a inspiré un nombre considérable d’écrivains férus de peinture au XIXe siècle : Balzac, Gautier, Baudelaire, Les Goncourt, Zola, Huysmans… L’époque invente la « transposition d’art », mise à l’honneur par Baudelaire, et remarquablement prolongée par Proust, alors que simultanément s’est imposé le « roman d’artiste ». Ce genre romanesque fait de celui-ci le héros – souvent malheureux – de l’intrigue, et permet à l’auteur de mettre en abîme les affres de la création, son ambition d’absolu, et le tourment sans résolution de l’artiste.
Un écrivain des XXe et XXIe siècles hérite donc d’une tradition générique qui lui offre des perspectives parfaitement balisées pour parler d’un peintre. Christian Bobin a choisi une voie radicalement différente : « Je me moque de la peinture », affirme-t-il en ouverture, « je me moque de tout ce qui appartient à un genre et lentement s’étiole dans cette appartenance. » Son texte est donc en dégagement de ce qui constitue habituellement l’histoire de l’art, et assure l’inscription d’une oeuvre dans un style ou une continuité thématique. Il cherche « le surgissement d’une présence, l’excès du réel qui ruine toute définition. »
L’écrivain ne se place donc pas frontalement face aux œuvres, il refuse la position statique du spectateur ou du critique. Les œuvres de Soulages traversent seulement son texte, comme des souvenirs ou des présences erratiques, privées des contours rassurants d’un titre et d’une date : seulement des appels énigmatiques, vacillants ou fantomatiques, qui interrogent le regard par la densité du noir qui les habite, et le font plonger dans une profonde méditation. Celle-ci n’est jamais qu’ amorcée, portée par les étapes contingentes du voyage en train de l’auteur pour rejoindre la ville où réside l’artiste, ce train qui « (le) crachera comme un pépin sur le quai de la gare de Sète ». Comme dans La Modification de Michel Butor, le voyage dans l’espace et le temps n’est que l’occasion et la métaphore d’un voyage intérieur, ponctué de rêveries et réflexions qui s’appellent par simple contiguïté. En cela le livre, rhapsodique, est fidèle à la position esthétique alléguée au début : il échappe à toute identification générique.
La rêverie sur le « noir » revient comme un leitmotiv, donnant une structure spiralée à un ouvrage fait d’une succession de courts chapitres. Le « noir » assure le retrait des œuvres par rapport à l’hypertrophie du regard que sollicitent les musées et collections : les œuvres de Soulages ne « mangent » en effet « que du noir avec un filet de lumière ». Alors qu’il y a « trop à voir » dans ce monde dit ‘moderne’ », Soulages « radicalise, simplifie, détruit par son travail les images médusantes ». En cela il nous rend à « l’impersonnel de la vie, la muraille muette de la première seconde de l’univers », avec ces noirs et leurs « échappées de silence » qui sont les « saute de courroie de la lumière ». D’ailleurs qu’est-ce que la poésie sinon « le noir du langage, sur lequel passent les griffes de la lumière » ?
Ce voyage dans l’énigme mystérieuse de l’obscur lumineux de la peinture de Soulages s’entrelace avec des thèmes essentiels et constants chez Christian Bobin. La figure tutélaire et émouvante du père apparaît plusieurs fois, toujours associée à une simplicité bienveillante et attentive, gage de la capacité exceptionnelle de l’écrivain à saisir l’appel poétique des choses les plus simples : « Mon père (…) avait cette grâce d’être toujours à côté du soleil ». Le « noir », Bobin en a d’ailleurs tôt fait l’expérience dans son Creusot natal, où les « vrais aristocrates étaient ces ouvriers veillant dans leur jardin sur un feu de tomates », tandis que « des planches de noir s’appuyaient les unes sur les autres, laissant entrevoir un autre monde ».
En contrepoint de ces souvenirs d’enfance, apparaît la pauvreté insigne de la vie socialisée que ne traverse pas l’éclair de la grâce : « la vanité de la parole, l’hypocrisie de nos silences, le tremblement de nos intérêts », alors que « les mendiants roumains sont mille fois moins brutaux que les publicitaires ». Contre la soif d’avoir qui caractérise le temps présent, à l’image de « la politesse des milieux de l’art (…) impitoyable comme celle des milieux d’affaires », Bobin affirme la nécessité de la dépossession, de l’accès par l’oeuvre à un tout autre horizon (« Le cœur – cette force en nous qui n’est pas nous »). C’est pourquoi par deux fois revient le nom de Pascal avec qui, contrairement à Valéry « l’ennuyeux » connu pour le « Cimetière marin » inspiré par Sète, « soudain plus rien que l’essentiel ». Qu’est-ce que créer en effet ? C’est « tout faire pour sentir encore et encore cette brise de l’invisible à nos tempes, cette proximité d’une fraîcheur surnaturelle » : façon de « tenir face à la mitraille du néant », et de « cracher son âme, exprimer son jus, diviniser la vie en la soulevant au-dessus de nous mêmes ».
Couronnant en permanence, explicitement ou implicitement, ses réflexions, « Dieu » apparaît comme toujours chez Bobin, point d’espérance pour une âme assoiffée d’absolu ; mais il est apparemment irréductible à une quelconque religion, ce « Dieu qui n’existe pas d’exister trop », tout en étant « l’unique bien des pauvres ». Le mot peut renvoyer au vide du réel, au rien, ou à un sentiment de profusion, à une présence tactile ou à un au-delà de la mort : le texte, par ses entrelacs et ses apparentes contradictions, semble témoigner d’un sentiment du sacré sans transcendance : comme une promesse d’aube, une irradiation lumineuse inscrite dans le présent, l’ouverture à une expérience à la fois charnelle et spirituelle : « Mon âme s’arrache à elle-même comme fait le geai qui gicle les bras du chêne et file dans la nuit du plein jour. »
Comme à son habitude, Bobin séduit – autant qu’il peut irriter parfois – par un goût irrépressible de la formule, dont la fermeté concise s’impose souvent au détriment de la continuité de la pensée. Avec une parole aux accents prophétiques ou incatatoires, il impose au lecteur la force séductrice d’une rhétorique qui s’appuie sur un jeu d’assertions paradoxales : « Les honneurs sont un poing américain qui vous étend pour de bon » ; « Le vent est la poussière de la lumière ».
Mélange de rouerie et de candeur, traversées par une légèreté mystérieuse qui accepte de céder à la facilité de certaines images convenues, et puisant dans un dictionnaire assez restreint – le cœur, l’amour, la lumière… – les textes de Bobin dégagent un charme entêtant, où un souffle d’âme fait vaciller les certitudes : « Nos plus grandes intensités ne supportent pas les preuves. »
Daniel Bergez
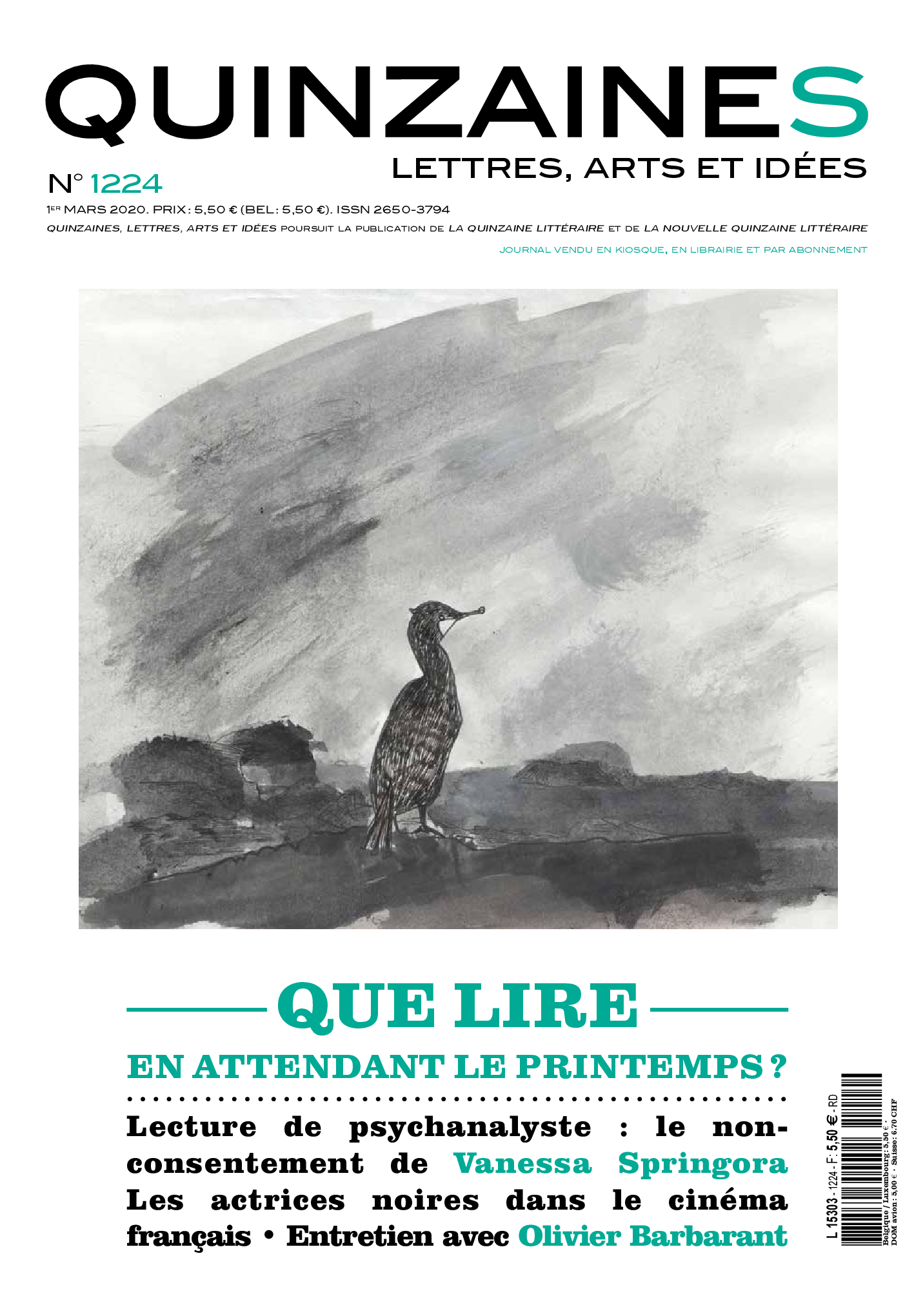

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)