Des publications nouvelles saluent l’événement : en avril dernier, Thierry Laget publiait dans la collection « Blanche » Proust, Prix Goncourt. Une émeute littéraire. Le livre résulte d’un travail approfondi de recherche sur des documents inédits, dont certains sont offerts au public. Ils permettent de prendre la mesure du scandale qu’a représenté pour beaucoup l’attribution de ce prix, qu’on croyait devoir revenir à Roland Dorgelès pour Les Croix de bois. Les insultes et menaces pleuvent, venant notamment de ceux qui ont fait la guerre et qui brocardent ce jeune écrivain qui vit dans l’opulence et n’a pas connu l’horreur des tranchées. Et que dire de cette plongée dans un passé personnel, mondain et révolu, alors que l’urgence est à reconstruire le temps présent sur les ruines du conflit mondial ?
En novembre, une autre publication saluera ce centenaire : Marcel Proust. Croquis d’une épopée de Jean-Yves Tadié, qui a dirigé la monumentale et aujourd’hui incontournable édition de la Recherche dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». Cette « épopée » est celle du long compagnonnage de l’universitaire avec son auteur de prédilection. Enchaînant « promenades », « variations » et « découvertes », selon les mots de l’auteur, le livre recueille les fruits de dix années de critique consacrée à Proust. Des personnages du roman se mêlent à une voisine du boulevard Haussmann, à un prince monégasque, à l’évocation des jardins ou de Romain Rolland… C’est l’histoire d’une amitié exemplaire tirée de la fréquentation des textes : « Ami, on l’est peut-être plus quand on ne connaît que l’œuvre que lorsque l’on ne connaît que l’homme. »
C’est aussi l’ensemble d’À la recherche du temps perdu qui est réédité par Gallimard en collection de poche : de Du côté de chez Swann au Temps retrouvé, les sept tomes de l’œuvre reparaissent dans la collection « Folio classique », avec de superbes couvertures demandées à Pierre Alechinsky. Un sort particulier a été réservé à À l’ombre des jeunes filles en fleurs, qui paraît de surcroît en édition spéciale sous étui, en tirage limité, et comportant un livret reprenant les « bonnes pages » du livre de Thierry Laget.
Voilà l’occasion de redécouvrir Proust, loin des polémiques qui ont accompagné la publication de ses œuvres. Aragon affirmait, en 1920, dans Littérature (organe des futurs surréalistes), que Proust, certes « un jeune homme plein de talent », n’était qu’un « snob laborieux ». L’examen des manuscrits de l’écrivain confirme certes l’épithète, validé tout autant par cette écriture qui n’en a jamais fini de se surcharger de précisions, corrections, réflexions incidentes, pour suivre au plus près la vérité traquée – et reconstruite – par la mémoire. Quant au snobisme de Proust, comment ne pas en faire le constat à travers les milieux qu’il dépeint et qu’il a assidûment fréquentés ? Dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs, les portraits de Norpoix et de Cottard plongent le lecteur dans l’univers suranné des petites vanités sociales attachées à ce que Pascal nommait les « grandeurs d’établissement ». Mais Proust a l’amusement et le détachement d’un moraliste – au sens du XVIIe siècle : un observateur sagace et jamais dupe de la comédie sociale, doué d’une capacité exceptionnelle d’analyse de tous ses rouages, visibles et invisibles. Les spectacles de la mondanité font d’ailleurs de Proust, en dépit du sérieux dont on l’accable excessivement dans la définition de sa quête, l’un des auteurs les plus drôles de son temps face au théâtre du monde, dont il montre et démonte la machinerie.
Aragon ne pouvait naturellement connaître le Contre Sainte-Beuve, recueil d’essais critiques et théoriques sur la littérature que Proust projetait de publier mais qui ne parut que de façon posthume : l’auteur de la Recherche y contestait de manière argumentée l’approche biographique des œuvres, infiniment réductrice et niant l’autonomie esthétique qui fait la réussite d’une œuvre. À relire À l’ombre des jeunes filles en fleurs, l’irréductibilité du travail proustien éclate de façon toujours aussi surprenante. Cette écriture est une longue dérive narrative – qui peut faire penser à Ulysse de Joyce –, charriant dans un flux presque intarissable souvenirs, pensées, tableaux, parfois sommairement enchaînés mais toujours reliés par ce que Proust nommait les « anneaux d’un beau style ». L’œuvre progresse ainsi, au niveau de la phrase mais tout autant des volumes, en mouvements spiralés par des reprises lancinantes de thèmes et de motifs, quand bien même chaque scène apparaît dans une nouveauté singulière. De la sorte, le texte est parfaitement homogénéisé dans une même coulée narrative qui le porte de bout en bout et éclaté en séquences presque autonomes (qui font la fortune des recueils de morceaux choisis). Proust jette ainsi le pont entre le continuum épique – fondateur de tout récit – et la dispersion caractéristique de l’esthétique moderne.
Entre retours et avancées, le texte d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs accorde une large place, étonnante même par son insistance, à la métamorphose des êtres, tout à la fois eux-mêmes et pris entre de multiples identités. C’est dès l’ouverture du livre que le narrateur nous présente un « nouveau Swann » et un « nouveau Cottard ». Cette métamorphose se produit sous le double effet du temps et des incertitudes de la perception, puisque les êtres n’existent que dans le champ d’une sensibilité qui les construit tout autant qu’elle les saisit. L’expérience amoureuse le marque plus particulièrement, notamment avec Albertine, dont le narrateur note : « […] la jeune fille de la plage avait été fabriquée par moi » – d’où la conséquence, qui fait écho aux désillusions de Swann avec Odette : « On se fiance par procuration, et on se croit obligé d’épouser ensuite la personne interposée. » Le narrateur lui-même n’échappe pas à ces processus de transformation continue de l’identité : « […] je devrais donner un nom différent à chacun des moi qui dans la suite pensa à Albertine ».
La même loi de retours et de métamorphoses joue, dans ce volume, pour les épisodes dits de « mémoire involontaire » qui font encore aujourd’hui le succès de Du côté de chez Swann. Comme dans ce premier volume, la mémoire peut ici être violemment et soudainement ébranlée par une lointaine réminiscence. Mais l’épisode de la « petite madeleine » ne se reproduit qu’incomplètement : devant les arbres d’Hudimesnil, « mon esprit sentait qu’ils recouvraient quelque chose sur quoi il n’avait pas prise » ; « Comme des ombres ils semblaient me demander de les emmener avec moi, de les rendre à la vie. » L’émotion sensible d’un retour dans le passé ne débouche donc pas sur une identification heureuse. De même, lorsque le narrateur revoit la baie d’aubépine, « touché au cœur par un doux souvenir d’enfance », il se trouve bientôt dépité de voir que toutes les fleurs sont parties, comme les jeunes filles qu’il a aimées. Cette désillusion d’une ressaisie impossible du passé est anticipée dans ce volume par l’épisode de la Berma (l’actrice Sarah Bernhardt), qui confronte à l’émotion tant attendue et espérée par le jeune homme la platitude d’une prestation décevante. Comme pour Balbec et Venise, il attendait de sa découverte « la révélation de vérités appartenant à un monde plus réel que celui de ma vie contingente ». Or la représentation des actes II et V de Phèdre donne d’abord lieu à une méprise digne d’un théâtre de boulevard, avant que ne paraisse effectivement l’actrice, au prix d’une terrible déception : « Je ne pouvais même pas […] distinguer dans sa diction et dans son jeu des intonations intelligentes, de beaux gestes. »
Anticipant la fin de la Recherche, qui verra le narrateur répondre à la nécessité ultime de la création artistique, À l’ombre des jeunes filles en fleurs est ponctué de réflexions sur l’art. On sait que Proust comparait son œuvre à une cathédrale dont les deux piliers (le début et la fin) se répondaient. On entend de fait ici la conviction que formulera Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Cette promesse passe par la distinction entre l’écrit et l’oral : alors que la voix de l’écrivain Bergotte paraît altérée et qu’elle « sort d’un masque », comme pour tout un chacun, le style écrit de Bergotte, ce que le narrateur nomme « le Bergotte », « était avant tout quelque élément précieux et vrai, caché au cœur de chaque chose, puis extrait d’elle par ce grand écrivain grâce à son génie ». Au prix d’un déplacement fréquent chez les écrivains de l’époque, cette foi en la littérature se formule surtout à propos de la peinture, dans des pages lumineuses consacrées à Elstir. Visitant son atelier, le narrateur comprend que l’artiste veut rendre la vérité de la sensation sans le secours déformant de l’intelligence, ce qui permet d’« habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontière fixe, de démarcation absolue, entre la terre et l’océan ». C’est de la sorte qu’il peut « fixer sur sa toile, l’imperceptible reflux de l’eau, la pulsation d’une minute heureuse ». La transgression des limites rationnelles du monde perçu par Elstir explicite visuellement le rôle essentiel que Proust accorde à la comparaison, chargée d’établir des jonctions éclairantes entre éléments logiquement dissemblables. L’idée, ici seulement sous-jacente, sera fermement explicitée dans Le Temps retrouvé : « […] la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport […] et les enfermera dans les anneaux nécessaires d’un beau style. »
Certains passages sont, dans ce volume, l’illustration éclatante de cette démarche littéraire. Telle cette vision de la mer depuis le grand hôtel de Balbec : « […] je retournais près de la fenêtre jeter encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux et sur les sommets neigeux de ses vagues en pierre d’émeraude çà et là polie et translucide, lesquelles avec une placide violence et un froncement léonin laissaient s’accomplir et dévaler l’écoulement de leurs pentes auxquelles le soleil ajoutait un sourire sans visage. » Même somptuosité imaginative, mais avec un total changement de registre, dans les dernières et magnifiques lignes du livre : « Et tandis que Françoise ôtait les épingles des impostes, détachait les étoffes, tirait les rideaux, le jour d’été qu’elle découvrait semblait aussi mort, aussi immémorial qu’une somptueuse et millénaire momie que notre vieille servante n’eût fait que précautionneusement désemmailloter de tous ses linges, avant de la faire apparaître, embaumée dans sa robe d’or. »
Daniel Bergez
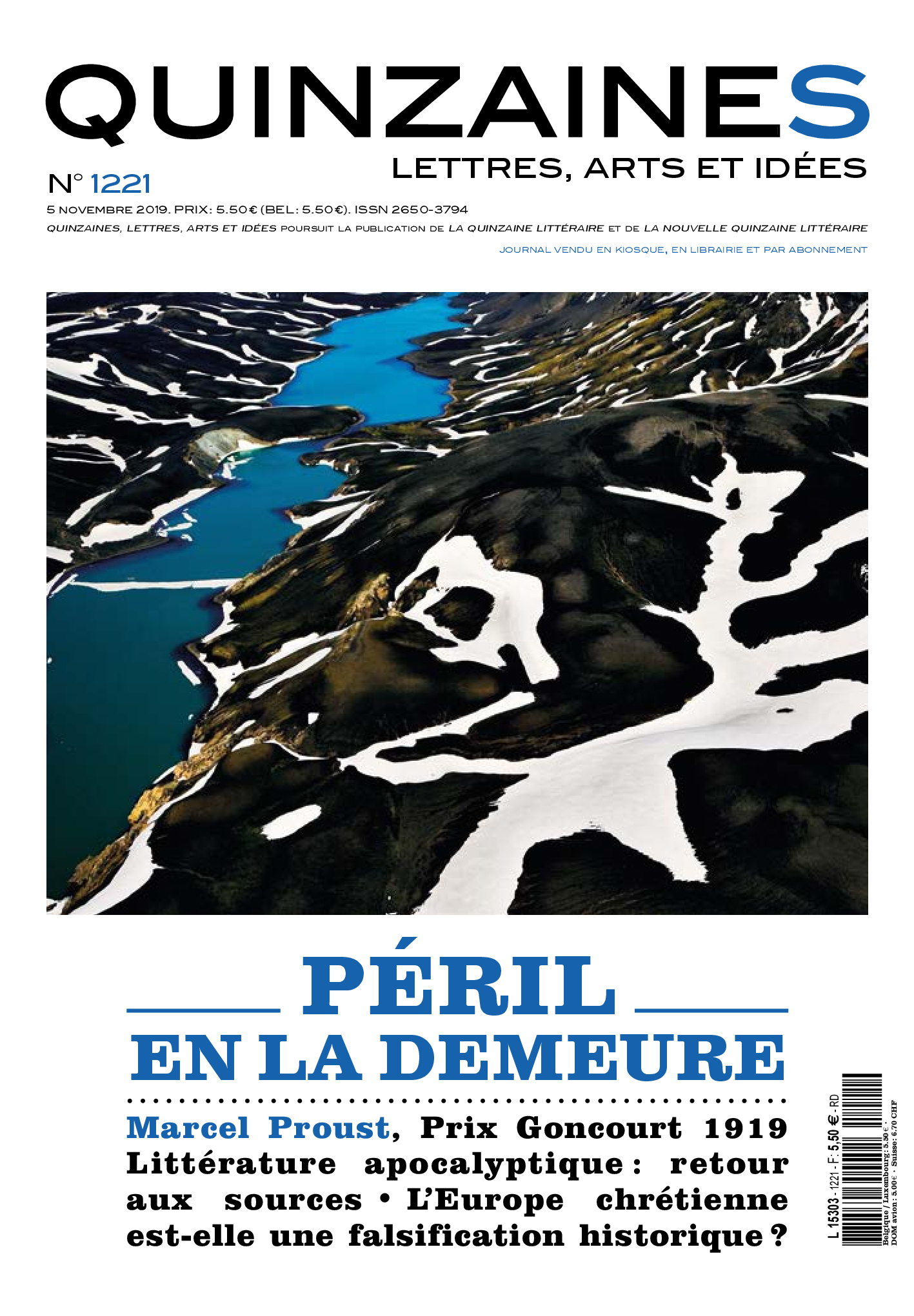

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)