Commençons par les ressemblances : le narrateur est un chevelu, de ceux que Monsieur Poirier, alias Julien Gracq, n’aime guère, non parce qu’il est réactionnaire, mais parce que ces cheveux longs de hippies lui disent qu’ils ne sont pas du même monde que lui. Rouaud est chevelu comme Chateaubriand, son maître, son modèle a dû l’être. On nage en plein romantisme ; un certain optimisme est de mise. La jeunesse d’alors peut connaître des soucis matériels, elle a vite fait de trouver le petit boulot qui lui sauve la mise. L’utopie est vivace et ces années que raconte Rouaud sont celles des communautés, des intellectuels qui « s’établissent » dans les usines de Saint-Nazaire (où il a pu rencontrer Jean Rolin qui évoque ces années dans L’Organisation), du sexe « libéré », des ouvrières de Lip et des étés sur le Larzac. On n’oublie jamais de lancer un slogan révolutionnaire, « un sésame pour ne pas être seul, un bon de participation à l’air du temps ». On voit donc le narrateur sortant de l’internat dans lequel il vient de passer quelques années qu’il a racontées dans Le Monde à peu près, entrer en faculté de Lettres, filière de choix pour qui avait « des incompétences à faire valoir », échapper au service militaire grâce à sa myopie et surtout à l’indulgence extrême d’un médecin aussi peu convaincu que lui, et survivre pour mener cette « vie poétique » qui donne son sous-titre au récit. Le « 1 » qui l’accompagne laisse penser que l’on en saura plus sur « les années de non-être » passées par Rouaud jusqu’à ses trente-huit ans et la soudaine révélation du jeune écrivain, primé par le Goncourt pour son premier roman. Non-être puisqu’une caisse de retraite quelconque n’a pu reconstituer la carrière professionnelle de Rouaud qui jusque-là n’avait pas reçu beaucoup de fiches de paie, et qui n’existait donc pas sur ce plan-là.
Ce plan, celui du métier, de l’emploi, le narrateur et personnage principal a décidé de ne pas s’en soucier plus que ça. Le récit débute par une citation de Thoreau, l’auteur américain de Walden, écologiste avant la lettre, qui a réfléchi sur le sujet : « sur la question de savoir comment gagner sa vie honnêtement, on n’a presque rien écrit qui puisse retenir l’attention ». Rouaud comble ce manque, à sa façon. Le rôle des livres est de remplir des lacunes, de combler des manques et ce récit le fait. Il pose le cadre – les si heureuses années soixante-dix – et raconte des années de débrouille, toujours honnêtes. Rouaud a en effet été à bonne école, faute d’avoir reçu de son père le « mode d’emploi ». Sa mère, qui tenait en Loire-Inférieure un commerce de quincaillerie-vaisselle, etc. dont il est question dans Pour vos cadeaux (nom de la boutique), lui a transmis le goût du travail bien fait, le sens des valeurs, une certaine droiture qui n’est pas non plus sans rapport avec le carcan catholique et chouan de ce coin de presque Vendée. Interne à Saint-Nazaire dont les manifestations ouvrières valent « Grasse et ses parfums », il retrouve son clocher d’église et ses mœurs rigoristes en fin de semaine. Son bourg a même éprouvé de fortes sympathies vichystes pendant l’Occupation, sentiments non partagés par Joseph, le père de Rouaud engagé très tôt dans la Résistance, comme un oncle Georges, assez pittoresque dont les faits d’arme et l’héritage moral légué aux cousins de Jean Rouaud, donnent lieu à des pages savoureuses. Ces valeurs familiales, Rouaud les incarne dans le moindre de ses petits boulots. Il distribue des prospectus dans les boîtes aux lettres sans jeter un papier dans le caniveau ; il vend des glaces sur la plage et ne se fait pas de crédit ou de ristourne quand il puise dans son stock pour étancher sa soif ou sa gourmandise.
Rouaud ne partage pas toutes les illusions de l’époque et la foi n’est pas vraiment son genre. Certes, il a fréquenté l’église, mais on sent bien qu’il n’y a pas plus cru qu’aux rites auxquels se livrent les babas de son temps. La méditation transcendantale, le retour à la terre façon khmer vert (on n’employait pas encore l’expression), la lecture de Savoir revivre, un ouvrage de référence qui montrait combien tout ce qui est blanc nous pollue, du sucre à la farine industrielle et à l’Occident colonisateur, ce n’est pas vraiment sa tasse de thé. Rouaud reste « en périphérie ». Cela vaut aussi dans sa relation avec les femmes. La nudité n’est alors plus taboue, le corps est un bien commun, comme tout ce qui existe dans la maison. On squatte, on emprunte ou on vole sans trop se poser de question. La propriété c’est le vol, répète-t-on. Il n’adhère pas, garde le bouton du col fermé, reste en retrait. Myope, il « traverse la vie à tâtons ». Rêveur, il est en décalage ; il ne comprend jamais rien aux propos à « teneur idéologique » et s’ennuie ferme avec les gratteurs de guitare ou percussionnistes improvisés qui mériteraient le sort du barde dans Astérix, quand vient l’heure du banquet.
En fait, la littérature et l’art l’occupent déjà sans qu’il y paraisse et les premières pages du récit le montrent bien. Trois noms comptent : Chateaubriand dont il a si souvent été question, Chardin et Cassavetes. Si l’on voulait jouer avec le sous-titre de ce récit, on placerait une virgule entre la vie et poétique. C’est une poétique que nous lisons, au sens où par quelques rappels Rouaud indique comment on retrouve dans son premier roman ou les suivants des traces de Love Streams du cinéaste américain. Les jeunes ouvriers de Saint-Nazaire qui allaient flamber en Suisse, après y avoir gagné quelques billets sont les échos français des héros magnifiques de Cassavetes. Et le « flux d’amour » devient flux de larmes dans Les Champs d’honneur.
Le mémorialiste de Saint-Malo et de la Vallée aux Loups inspire la phrase de Rouaud. Contre le style moderne, réduite à « sujet, verbe et complément en option », ils partagent le goût de la métaphore qu’on ne saurait sacrifier, des longues périodes et des envolées lyriques. À cet égard, le romancier de Loire-Inférieure est fidèle à son modèle : son art de décrire le travail à l’usine, ou de raconter un hold-up dans une station service, enchaînant les participes présents sont des exemples pour enrichir les verbiers (1). Mais c’est de Chardin que Rouaud est le plus proche. La poétique du peintre et celle du romancier sont voisines. Dans la hiérarchie des genres, en vigueur au XVIIIe siècle, le peintre choisit ce qui est le moins valorisé, le plus humble, la nature morte : « L’art se moque de ce qui brille. » Le myope Rouaud ferme les yeux comme l’homme aux bésicles, pour « trouver des beautés à sa vieille tante Marie, confite en dévotion, toute sèche et rabougrie. »
Pour qui est né dans les mêmes années que le narrateur de ce récit, et qui avait donc à peu près vingt ans dans les années soixante-dix, ce livre est une histoire partagée. On a cru aux mêmes utopies ou on s’en est tenu proche, on a connu les mêmes peurs en faisant de l’auto-stop (on interdit à ses enfants d’en faire, désormais), on a rêvé d’une vie meilleure, poétique si possible. La fin des communautés, le retour à une société de consommation qui se frottait les mains à l’idée de nous vendre tout ce qu’elle avait en réserve ne nous a pas réjouis. Lire Rouaud, comme regarder une toile de Chardin, c’est se sentir en fraternité, dans une forme de simplicité, de légèreté qui n’est pas pour rien dans le plaisir de la lecture.
1. Verbier, Michel Volkovitch, éditions Maurice Nadeau, une mine pour les amateurs de Coups de langue, également chez Maurice Nadeau.
Norbert Czarny
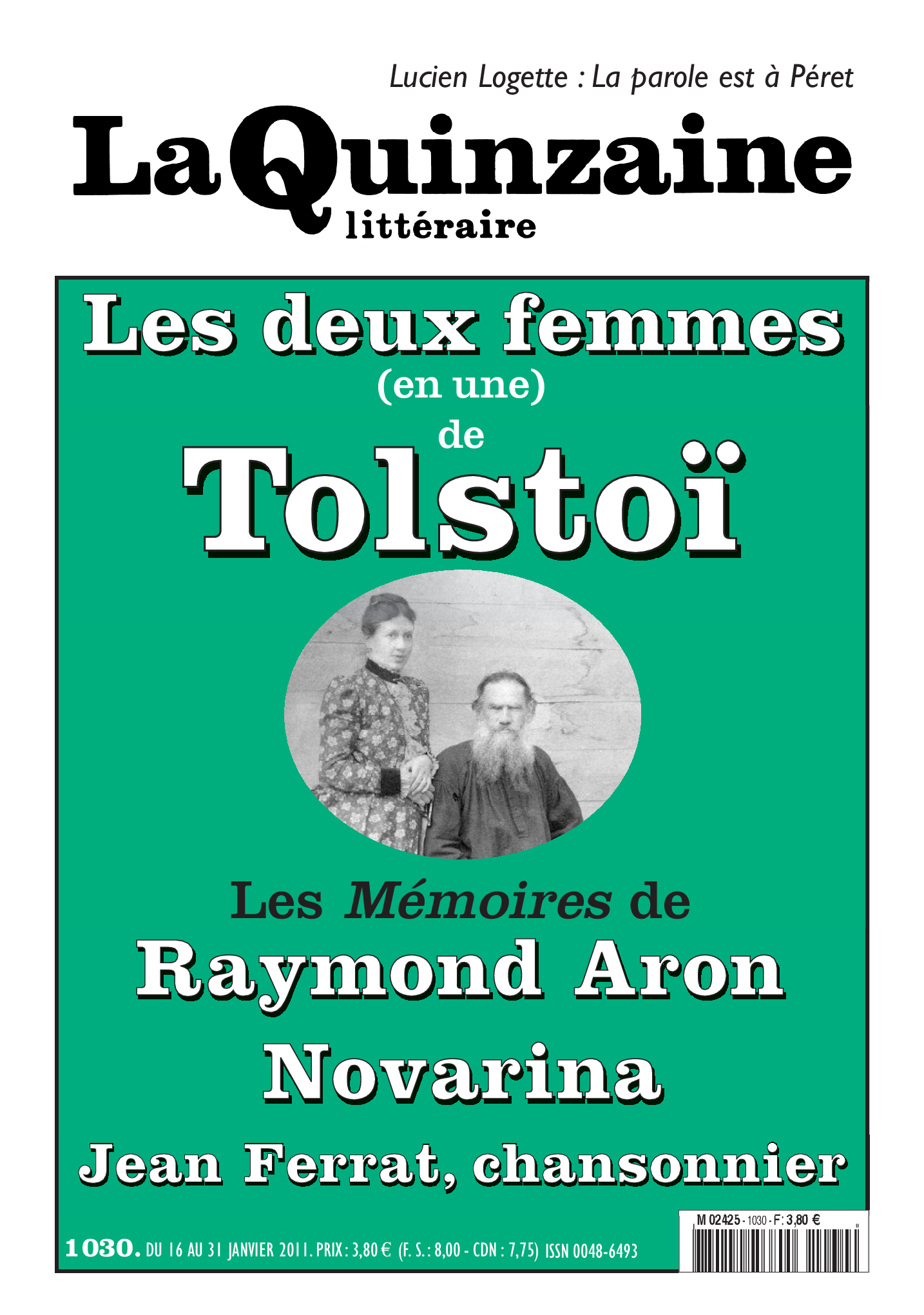

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)