Ce Supplément à la vie de Barbara Loden est de ces textes hybrides qui donnent à penser, et qui émeuvent. Le prétexte de ce qui ressemble à une enquête est une notice pour un dictionnaire du cinéma. La narratrice qui doit être bien proche de l’auteur, voire coïncider avec elle, se voit confier une tâche apparemment facile. Mais dès le début du récit, on comprend qu’il n’en ira pas ainsi. Elle se documente sur les États-Unis, sur le cinéma-vérité et l’émigration polonaise, sur les mines de charbon et l’invention des bigoudis ou l’émergence de la pin-up. Comme elle l’écrit : « J’avais le sentiment de maîtriser un énorme chantier dont j’extrairais une miniature de la modernité réduite à sa plus simple complexité : une femme raconte sa propre histoire à travers celle d’une autre. » La femme qui raconte est Barbara Loden, jeune comédienne de théâtre qui a rencontré et aimé Elia Kazan quand il était déjà un homme mûr. La relation entre Barbara Loden et le cinéaste ressemble par certains aspects à celle qui a uni Arthur Miller et Marylin Monroe. Loden a d’ailleurs interprété le rôle de Monroe dans The Fall, mis en scène par Kazan. Puis de grands rôles lui ont échappé : sa doublure sur scène, Faye Dunaway, a joué dans L’Arrangement, l’un des grands films à teneur autobiographique que Kazan avait tiré de son roman. Alors elle s’est lancée, a écrit, réalisé et interprété Wanda. Elle seule pouvait jouer ce rôle, considérait-elle, quand on l’interrogeait sur ce film mythique. Certains films, uniques, réalisés dans des conditions surprenantes acquièrent aussitôt cette dimension légendaire.
La notice de dictionnaire prend donc une autre envergure, devient quête et enquête, comme c’était déjà le cas dans L’Exposition, le précédent récit de Nathalie Léger. Ne pouvant se contenter des sources écrites, elle se rend aux États-Unis, poursuit son investigation en Pennsylvanie, sur les traces de Wanda, cherche sa route avec un GPS mais n’a-t-elle pas ainsi perdu tous ses repères ? Elle interroge un ancien champion de base-ball, devenu écrivain, elle retrouve cette Amérique ivre d’une certaine religiosité spectaculaire et kitsch, elle retrouve les lieux du film : « […] on sait que ce bar en Pennsylvanie est à l’à-pic exact du malheur, pas un malheur plein d’emphase, pas un malheur grandiose agrafé à l’Histoire, non, un malheur fade qui a l’odeur d’un tissu à carreaux pendu aux fenêtres d’un café de province ».
Et puis on rencontre assez vite la mère de la narratrice. Très présente – elle donne un tour à la fois amusant et grave au texte. Amusant d’abord parce que les deux femmes regardent Wanda ensemble et que la mère interroge sa fille, discute avec elle, surprise de l’intérêt qu’elle éprouve pour cette histoire. Elle préférerait parler d’autre chose mais joue un rôle trop important pour que sa narratrice de fille change de sujet. La mère – par ses questions et remarques – est celle qui fait avancer l’enquête, met en relief la singularité du film et de son auteur. Elle éclaire d’une autre lumière ce récit, dont l’un des charmes est aussi de reposer sur des ruptures, des changements d’angle, des sortes de sautes d’images, comme avec les vieilles pellicules dont le raccord tient mal. Mais la présence de la mère a un autre sens : quittée par son mari, elle a failli basculer. Folie ? Suicide ? Les deux étaient possibles et le récit d’une errance dans Cap 3000, un de ces hideux centres commerciaux construits sur la Côte d’Azur dans les années soixante-dix, la montre vacillante, opaque et transparente à la fois. Elle marche comme une « femme de médecin » à travers les galeries marchandes, et nul ne se doute, la croisant, qu’elle pourrait s’effondrer. De cette expérience, elle fait le récit à sa fille pendant qu’elles regardent Wanda, en une sorte d’aveu retardé, dans une longue phrase toute en incises, comme si elle se retrouvait dans le labyrinthe de Cap 3000 et du passé. On la retrouvera à la toute fin du récit. Sa vie, au fond, n’est pas très éloignée de celle de Wanda.
Les féministes n’aimaient pas cette héroïne apparemment soumise, indifférente à ce que les hommes ou l’homme qui l’accompagne fait d’elle. Wanda prend appui sur un authentique fait divers que la narratrice retrouve, après de fastidieuses recherches dans les archives. La « vraie » Wanda avait été arrêtée à l’issue d’un braquage manqué et elle avait remercié le juge qui la condamnait à vingt ans de prison : « On ne saura jamais d’où vient la blessure qui condamne Wanda à la désolation, on ne saura jamais quelle ancienne trahison ou quel abandon lointain l’ont plongée dans ce désarroi sans aspérités et sans partage, on ne saura pas non plus de quelle perte, de quelle absence, elle ne peut se consoler, on la prend comme on se prend soi-même, dans l’aveuglement et l’ignorance, et l’impossibilité de mettre un nom sur la tristesse d’exister. Son visage, le visage de Wanda, fermé, triste, obstiné. » Barbara Loden qui aurait pu se révolter à maintes reprises contre le sort qui lui était fait, partage ce sort, accepte son destin. Ses dernières paroles, que nous ne dévoilerons pas, résument une existence assez triste par certains côtés. Et parlant de ces femmes, de la façon unique dont Marguerite Duras avait su les comprendre, la narratrice s’inscrit dans une chaîne, se pose en héritière sans que justement la pose y soit.
Ce qui frappe dans ce beau récit, ce sont les échos que l’on y entend et les références jamais gratuites à des artistes que la narratrice cite ou reprend à sa façon : Godard, Fred Wiseman, Sebald et Perec sont de ceux-là. D’abord pour des raisons de méthode. Mener une enquête, rechercher des traces, c’est d’abord questionner qui ne veut pas toujours l’être. Le fils de Barbara Loden, qui possède les manuscrits et notes de la cinéaste, détient tous les éléments de réponse, refuse de voir la narratrice. Wiseman qui rend sa caméra transparente lui conseille de faire de même. Avec Perec elle se pose la question de l’exhaustivité : « j’hésite entre ne rien savoir et tout savoir, n’écrire qu’à la condition de tout ignorer ou n’écrire qu’à la condition de ne rien omettre ». Le texte qu’on lit, à la fois composite et parfaitement tenu, conduisant le lecteur là où il veut quand il veut tient à cette imperfection qui serait la loi du portrait, selon l’article de l’Encyclopédie que la narratrice cite. C’est un récit, une sorte de poème aussi, tant la langue y est travaillée, sonore, et un essai sur la fiction qui s’élabore. Les pistes qui s’ouvrent à la lecture sont nombreuses, aussi nombreuses que les courts paragraphes constituant ce texte comme autant de carrefours dans lesquels chacun choisira son chemin, sans jamais le regretter.
Norbert Czarny
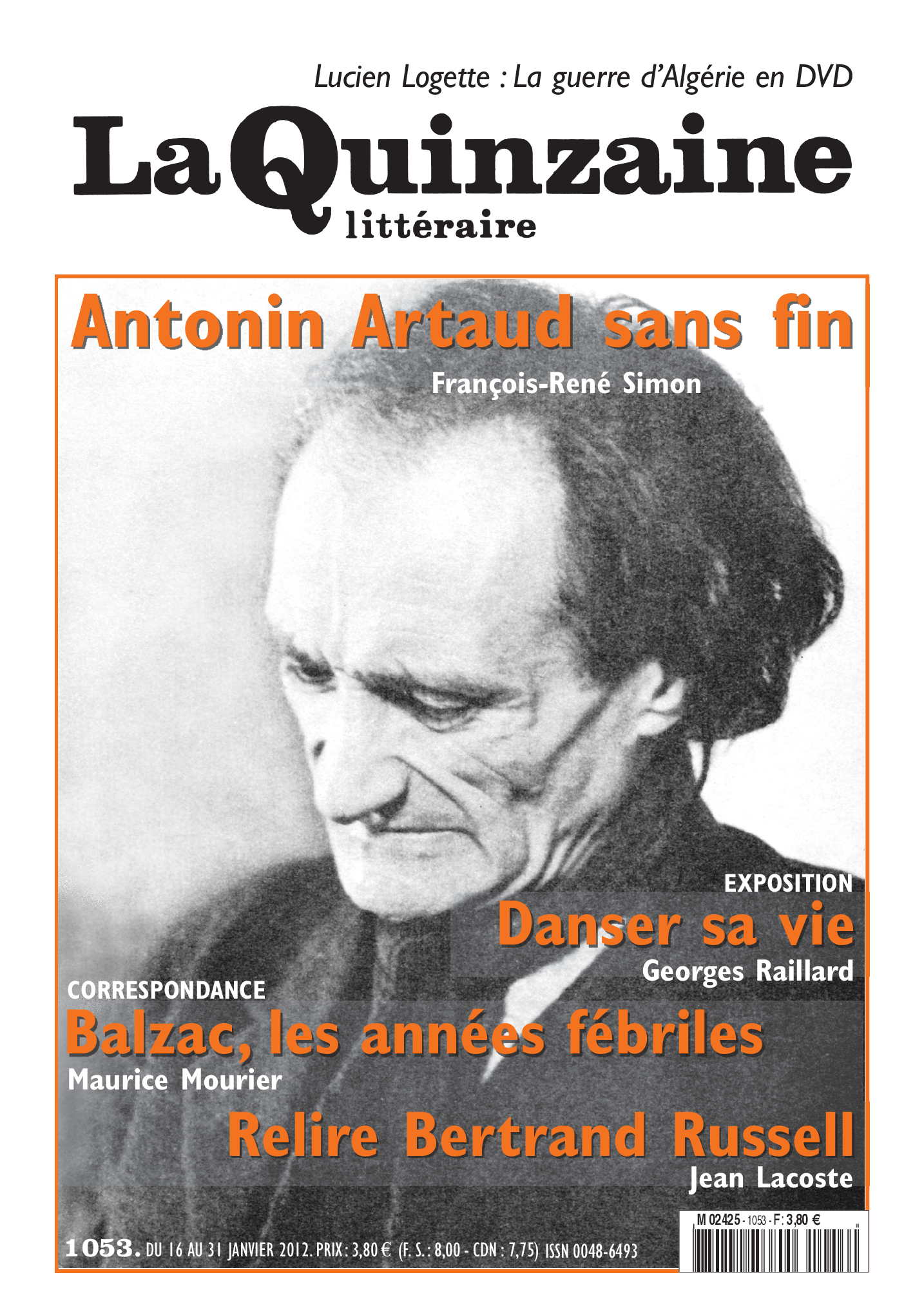

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)