Aller et venir est le lot du narrateur et de son ami Wladek. Ils n’iront jamais jusqu’à la place Taksim, qui donne son titre au roman, mais Stasiuk a l’art des titres qui désorientent. Nos deux personnages habitent une ville sans nom, à l’abandon : « Seuls les gens qui n’ont plus de forces ne partent pas. Ils ne vont nulle part et s’occupent des restes. » Le narrateur se déplace à bord de son vieux Ducato, qu’il répare et nettoie quand il le peut, pour tenir le choc sur les routes et chemins de montagne. Il fait les marchés dans cette zone des Carpates, entre Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Ukraine. Une zone dont la véritable malédiction tient à « l’indétermination ». Mot à prendre à tous les sens : les frontières n’existent plus, les États délaissent ces régions. Toutes les bourgades dépérissent. On y vit de rien, petits business ou allocations.
Wladek est à sa façon un Don Quichotte. Il rêve de commerce fécond, aimerait habiller « la Moldavie et la Macédoine avec des fringues de Londres » : « Il suffisait que deux ou trois femmes arrivent pour qu’un déclic se fasse en lui et mette en branle le mécanisme, la combinaison de chimie et de physique, la formule d’abstraction et de biologie, la très étrange synthèse d’énergie et de mélancolie qui le faisait se lever le matin, aller dans la ville de Szolnok, à la gare Keleti, à Istanbul, se perdre dans l’univers du commerce et dans le délire sur sa flotte dont les proues élancées fendaient les eaux du Danube et de la Tisza. Il soulevait de la poussière et les chiens lui aboyaient dessus. » Wladek est une sorte de barde qui raconte les temps héroïques, quand on réunissait le conseil de famille avant d’acheter une paire de godasses. Parler le fait vivre. Le narrateur, quant à lui, très proche du Stasiuk de La Route de Babadag (1) cherche la paix : « Je voulais que tout reste ainsi pour toujours. […] Surtout pas de changement. Ils (les habitants) ne voulaient pas payer quelque chose qu’ils n’avaient pas commandé. Ils flairaient l’entourloupe et ils auraient préféré l’égalité à la liberté. » Mais quand le petit commerce ne fonctionne plus, que les fringues délavées n’intéressent plus la dernière villageoise, les deux hommes se trouvent forcés de survivre grâce à d’autres commerces, transport de clandestins, « neuf ou d’occasion ». Et Wladek est prêt à s’y livrer pour peu que son argent libère du joug paternel Eva, la jolie caissière du parc d’attraction dont il est amoureux.
Stasiuk est un écrivain d’atmosphères. L’intrigue importe peu dans ce roman. On est pris dès la première page par cet univers qu’il connaît bien pour l’avoir souvent traversé et décrit dans ses précédents livres parus chez Christian Bourgois (2). Cette partie d’Europe laissée à l’écart meurt peu à peu, ou plutôt le vide laissé par les occupants soviétiques n’est jamais remplacé par quelque chose de permanent, de consistant : « Resto, resto disco, bordel, bordel resto, bordel disco […] », nul ne reste. Ce qui demeure, c’est la méfiance ou la haine, entre les populations locales et les « basanés », clandestins pakistanais ou Tsiganes. Rester derrière sa fenêtre et « haïr » reste la principale occupation. Cette haine se manifeste par brusques bouffées quand un Chinois se fait agresser dans la plus grande indifférence, ou qu’une brute affronte au fouet une bande de gamins tsiganes. Et il vaut mieux ne pas parler hongrois dans certaines bourgades slovaques, ou être né à « Draculand », le pays du sinistre cordonnier Ceaucescu. La Roumanie apparaît comme le comble de la misère.
Ce monde sans grâce, Stasiuk le fait pourtant aimer. Son écriture transforme le plomb en or, fait du « Tonnelet », obscure gargote où l’on s’ennuie ferme une sorte d’antre magique dans lequel un bocal de saindoux de blaireau est censé faire des miracles. Les Carpates sont à la fois Babel et le dépotoir du monde nouveau. Une caverne d’Ali Baba remplie de pneus qui équiperaient l’Europe entière, de chapkas en poils de chat, de fausses baskets chinoises. Un endroit pour des lascars de la trempe de Potok : « il importait des camions entiers de pornographie animale pour les sex-shops et des avions pleins d’articles de dévotion sud-coréens pour les boutiques paroissiales. Il achetait aux Russes de l’uranium et des femmes, il envoyait l’un et les autres en Turquie, en Perse, chez Khadafi ou que sais-je encore. » On se demande comment tout marche mais on devine assez vite que quelques puissants roulant en 4x4, accompagnés de gardes du corps ont rempli le vide apparent. Stasiuk est le reporter en mission permanente dans cette région ignorée qui souffre d’avoir tout perdu depuis si longtemps. ❘
- QL n° 945.
- Voir par exemple Les Contes de Galicie, QL n° 888, ou Fado, QL n° 989.

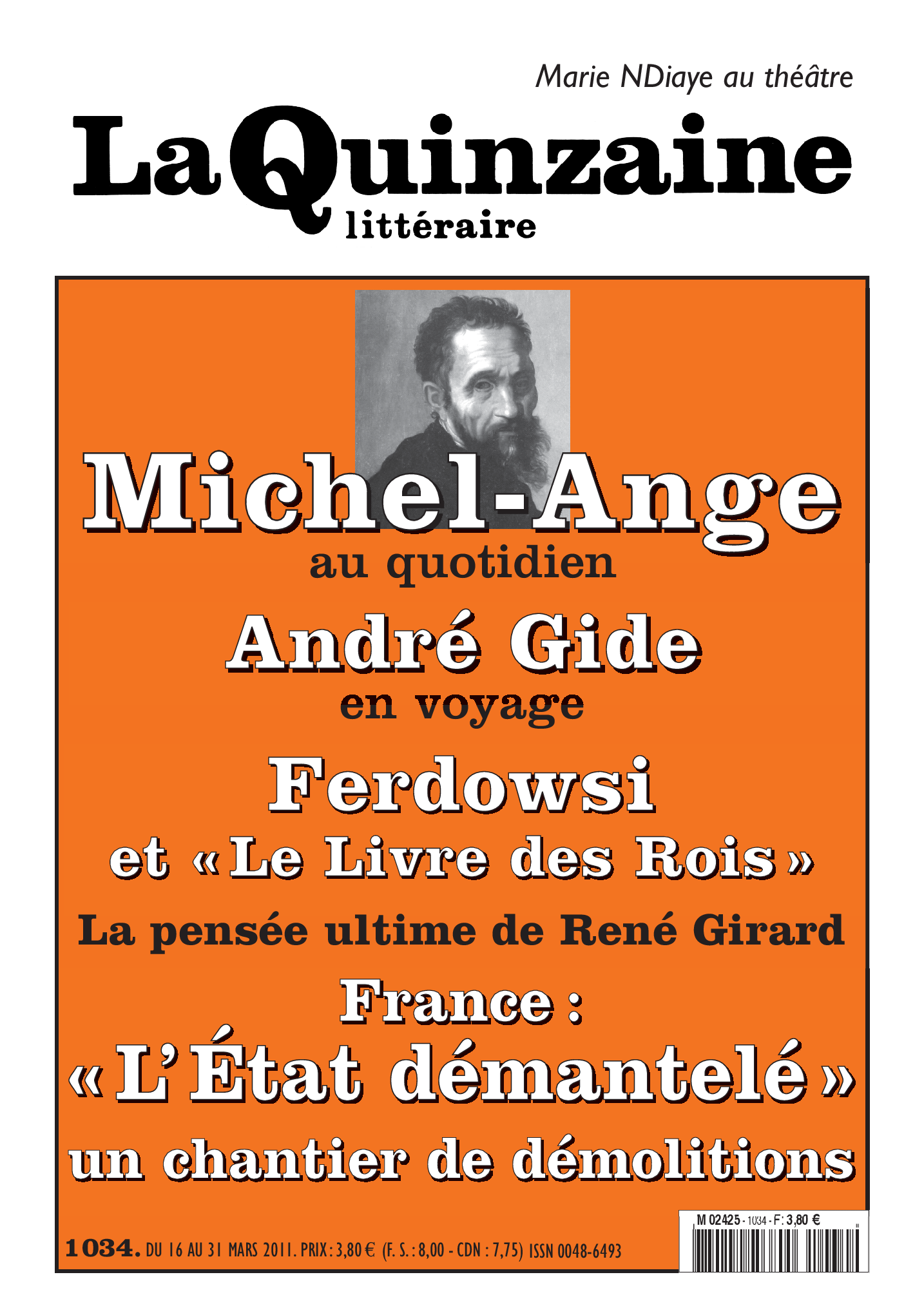

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)