On ne sait au juste quelle voix parle pour s’adresser au jeune frère d’un homme assassiné pour rien ou presque : une canette de bière. Les soixante pages qu’on lit d’un seul tenant sont une seule phrase commençant par un « et » qui suppose un autre début. Ces soixante pages denses, bouleversantes, sont le résultat d’un choc que Mauvignier rapporte dans la revue Décapage (1). Il y dispose de quarante pages pour présenter son travail, évoquer son univers. Un jour, donc, il a lu ce fait divers qu’on se rappelle peut-être : quatre vigiles d’une grande surface lyonnaise avaient battu à mort un homme qui avait bu, sans payer, une canette de bière.
De ce fait divers, Mauvignier tire une fiction politique et poétique. Politique : l’adjectif peut surprendre si l’on songe en termes réducteurs au spectacle pitoyable que des élus nous offrent ou à l’énonciation si commune de bons sentiments respectueux des droits de l’homme. Ce texte est politique en ce qu’il montre ce que devient un homme dans « un monde avec des vigiles et des gens qui s’ignorent ». Le pauvre qu’on a roué de coups revient à la vie grâce aux mots du narrateur. Celui-ci, écrivant, imaginant, s’étant peut-être documenté (on en doute : les romanciers se contentent d’être des visionnaires), lui a rendu une place dans le monde et dans la cité en particulier. Il n’a pas de nom et ce que l’on sait de son visage, de son corps est hélas ce que les assassins en ont fait : chair tuméfiée, corps rétracté par la douleur. Mais cet homme existe et on l’a tous vu. Il faisait la manche près de la gare Montparnasse ou errait dans quelque supermarché, regardant les chariots remplis de victuailles. Et surtout, il aimait, était aimé. De sa famille sans doute, mais aussi de femmes ou d’hommes avec qui il avait fait l’amour. Enfin, et cela donne toute sa dimension à ce texte, il rêvait. Il aurait voulu voyager, et même si ce n’était pas possible, l’envie suffisait à le faire exister, continuer de marcher. Il avait donc tout pour être heureux.
Politique aussi, la violence (et la lâcheté) des agresseurs. Ils se servent des mots « refus d’obtempérer » pour masquer le meurtre en acte de légitime défense. Ils intimident, harcèlent et frappent, persuadés que nul ne s’offusquera de leur violence envers un petit voleur, errant, peut-être gibier de garde à vue. Ce sont à l’évidence des assassins mais le narrateur montre bien tout ce qui aurait pu les unir à leur victime : une même salle de classe, un voisinage sur le palier des Bleuets, une équipe de foot qu’on supporte ensemble. Pourquoi sombrent-ils dans la haine ? Il est à craindre que nous connaissions la réponse depuis trop longtemps ; un autre est de trop, son visage vous reste étranger.
Texte politique, Ce que j’appelle oubli est aussi un texte poétique, comme tout ce qu’écrit Mauvignier. La notion de genre est pour lui éditoriale. Cela aide les libraires et bibliothécaires à ranger ses livres. Mais on entend ce texte, on le conçoit proféré, jeté dans un espace, face au public. Le premier choc littéraire de Mauvignier, apprend-on encore dans Décapage, c’est Artaud. Et dans ce texte d’une seule coulée, qui se termine avec le verbe « murmurer », on retrouve quelque chose du poète. Ceci étant, ce n’est pas seulement du côté d’Artaud que ce texte penche. Le ressassement, les variations de langue brassant le parlé et l’écrit, le mot jeté comme un cri et l’image qui illumine donnent son relief et sa spécificité à ce texte. On se rappelle Apprendre à finir entre malheur ordinaire et tragédie racinienne.
Enfin, et là est peut-être l’essentiel, ce texte prend toute sa dimension, devient comme une forme vivante quand on l’envisage du point de vue des temps. Il y a le présent du crime, les quelques passés ouvrant des fenêtres sur les moments de bonheur, des joies simples, l’évocation si émouvante de la mère faisant des recommandations à ses fils. Il y a le futur de la honte et de l’humiliation pour ceux qui se croyaient invulnérables, et l’absence de futur pour la victime, tout ce qui ne sera pas. Il y a, enfin et surtout, le conditionnel passé, mode de ce qui aurait pu et dû être pour ce pauvre garçon : un rendez-vous galant, des voyages, des espoirs pour plus tard. On n’oubliera pas cette humble silhouette qui nous rappelle celles qu’on trouve parfois chez Victor Hugo, celles d’enfants assassinés et de pauvres filles humiliées.
- Décapage, mars 2011, La Table Ronde.

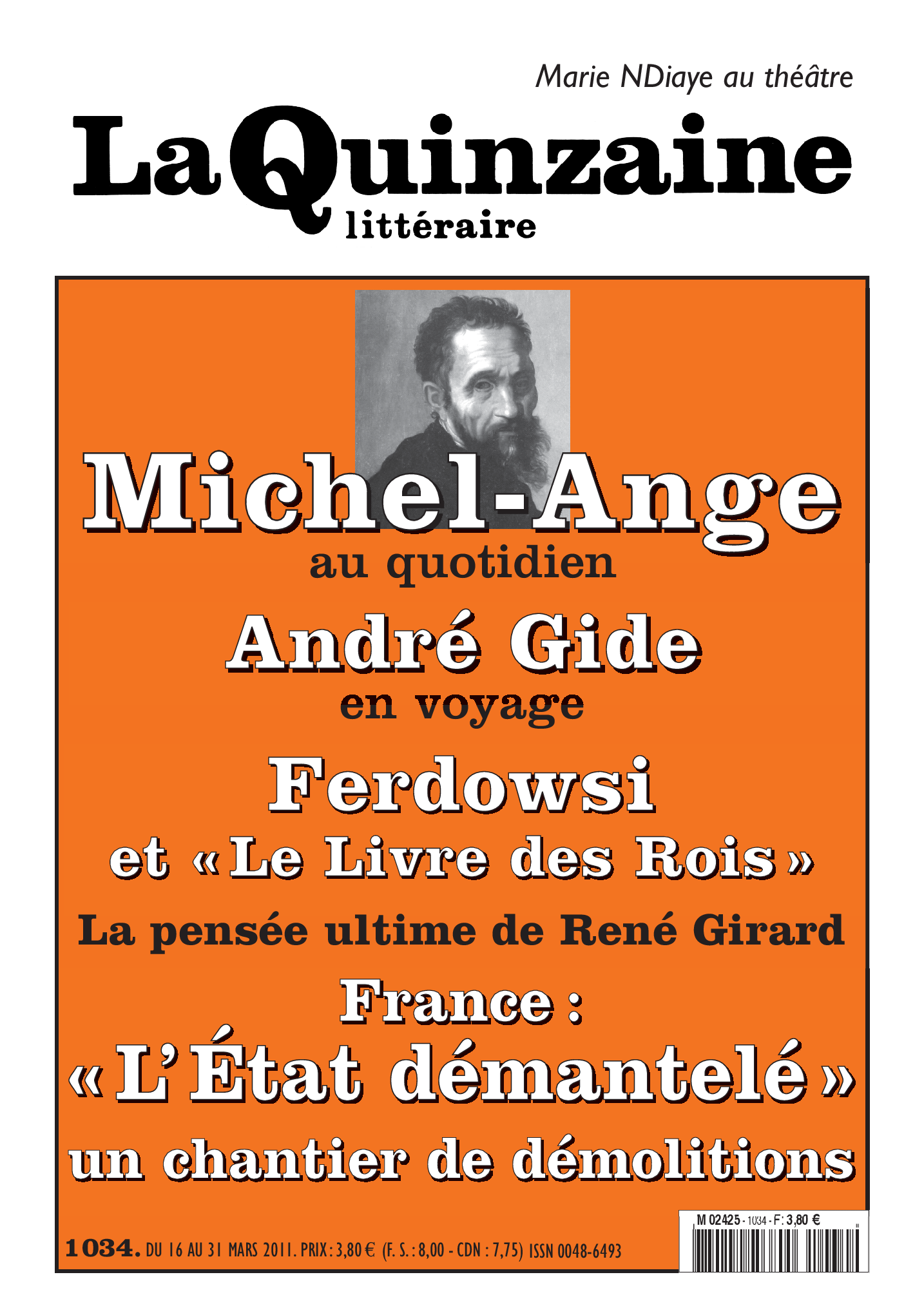

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)