La langue de Lobo Antunes est une offrande imparfaite, un recours bancal, une manière d’exorciser les démons du monde, de se ressaisir d’une réalité mouvante, toujours inconnue, hybride, elle aussi imparfaite, monstrueusement discontinue. Le langage semble chez lui toujours entretissé, mêlant des voix éperdues et déformées, toujours mobile, ressassant, reconduisant comme à l’infini la même angoisse, la même lutte, la même perte. Il conforme une répétition à chaque roman plus puissante, légèrement décalée, reconstituant dans son cours même le désordre des douleurs et des angoisses d’êtres égarés, enfermés dans un univers qui les exclut, irrémédiablement seuls, cherchant toujours un souffle qui échappe ou se perd dans l’immensité du tohu-bohu d’un univers obscurci.
Il semble vouloir atteindre au « plus profond, là où nous nous trouvons réellement, dissimulés à nous-mêmes, une boule de ténèbres ». L’entreprise démesurée à laquelle il s’attache fait s’essayer le poète à toutes les réalités, tous les corps, toutes les vérités, au terrifiant mélange incessant de la folie, de la joie, de la tristesse et de l’énergie fondamentale du discours. C’est une sorte d’exorcisme infini du bien et du mal, une quête de tendresse pour regagner les formes mêmes de son identité et du monde. Les êtres qui peuplent ses romans achoppent à leur durée, à un passé infâme qui les hante, à la perte de l’innocence et de leur propre matière, s’enfermant dans un ressassement stérile, éternellement reconduit et parfois impossible, puisque « ce qu’on a été n’existe plus et ce qui existe est mort ».
La conscience n’advient ici que dans la reprise, l’entrecroisement, cette manière de flux qui donne aux voix de la multitude de narrateurs une unité, qui confère au perdu, ce que nous regrettons ou ne pouvons porter, une possibilité d’exister une fois encore, de se rejouer, dans le lieu même de la parole, dans son moment décomposé, d’attendrir l’horreur du monde et d’amoindrir sa violence extrême, en la disant. Dans ce roman, il s’agit de comprendre et d’organiser une succession de monologues qui pourrait durer à l’infini autour de l’enquête d’un policier vieillissant et déprimé qui cherche à trouver et éliminer une bande de jeunes Noirs et métis qui commettent des exactions brutales et survivent dans le chaos d’« un quartier de constructions clandestines de la périphérie de Lisbonne, plus précisément au nord-ouest de la ville », se débattant dans « un tourbillon de misère » indescriptible. S’adjoignent, au gré des interrogatoires et des investigations, les voix d’une multitude d’êtres qui prennent en charge une part du malheur du monde – une vieille prostituée, ruine humaine qui finira par vivre avec l’un des jeunes délinquants, le beau-père de l’un de ses jeunes acolytes qui ressasse l’acte monstrueux de son propre géniteur, s’interrogeant, comme presque tous les autres personnages, sur les distinctions raciales et le poids du métissage, la pauvreté et l’enfermement continuel qu’ils subissent, un délinquant pathétique, une femme qui s’est échappée de ce lieu désolé pour se faire épouser par un Blanc, les jeunes eux-mêmes, les pauvres hères qui, successivement, semblent se répondre sans se reconnaître…
Mon nom est légion s’apparente à une symphonie grandiose qui fait s’entrechoquer les voix d’êtres délaissés, ceux que la vie semble réprouver et repousser dans les limbes terrifiantes du rien et de l’innommé, faisant d’eux d’impressionnantes figures de la relégation. En une langue à la fois terrifiante et enthousiasmante, il nous plonge à la source même d’une fulgurante violence qui semble noyer le monde et ceux qui s’y débattent. Dans ce roman polymorphe, il semble faire s’affronter le barbare et le civilisé, les gestes les plus brutaux avec la suavité affreusement triste d’une parole qui se cherche toujours, comme entravée par son corps même, défaisant sa durée en la reconduisant toujours plus avant, comme un aveugle tâtonnerait dans la nuit absolue. Comme au détour, il écrit : « les yeux aveugles et cependant voyant, des lettres une à une sans lien entre elles, lourdes, dures, terribles », comme résumant le cheminement qui le pousse à modifier la langue, à la tourner en quelque sorte. Il y a chez lui quelque chose de la furie et de l’éclat, du fracas et de la mélancolie, de l’indémêlable complexité de la survie qui ne trouve un exécutoire dans sa profération toujours déplacée. La langue de Lobo Antunes n’est pas complexe ou illisible comme on le dit trop souvent, elle ancre plutôt un timbre qui perturbe notre voix intérieure, la renvoyant jusqu’à des limites qu’il repousse à chaque livre, faisant entrer en contact le disparate – les tons, les temps, les narrateurs – avec la continuité mélodique de voix qui semblent se pourchasser sans fin (1).
C’est un roman de la jeunesse et de l’énergie, de ce qui se refuse aux enfants, de ce que Lobo Antunes recherche au plus profond de lui, dans l’énorme désordre de ce qu’il voit ou ressent, de la matière même du réel. Ici, il aborde à nouveau les territoires de l’Afrique – ceux qui augurent Le Cul de Judas, Fado Alexandrino ou Bonsoir les choses d’ici-bas (2) –, déplacés au cœur même du Portugal, nous conviant à nous interroger sur la tension extrême qui retient les Blancs et les Noirs, l’impossibilité de retrouver des origines ou la matrice de ce que nous sommes, de considérer l’autre, ces jeunes Africains en perdition qui ne peuvent être nulle part, ni ici, ni là-bas, à qui l’humanité est presque retirée, poussés à l’extrémité de la violence absolue puisque c’est « la seule chose que le monde leur donne », que « même pour dire je t’aime, ils tuent » (3). Mon nom est légion opère une manière d’exorcisme de la violence qui existe, s’apparentant à une déclaration d’amour contradictoire qui l’utilise pour mieux la contredire. C’est une longue mélopée, déclinée sur des tons différents, qui affirme l’amour et la tendresse, une sorte de compassion fondatrice, celle qui pourrait nous faire dire, ou lui faire dire : « et une fois que ce sera passé m’asseoir à vos côtés le front entre les mains je ne dis pas pour pleurer, pourquoi pleurer, aucune raison de pleurer, le front caché derrière mes mains pour ne pas me voir moi-même ».
1. Le nouveau traducteur a su faire sentir les décalages entre les locuteurs et la brutalité de la langue de l’écrivain qui fait que nous ne savons plus vraiment qui parle et quand, que l’on se perd dans la matière même de son écriture.
2. Les deux premiers sont édités chez Métailié, le troisième chez Christian Bourgois.
3. Ces deux dernières citations reprennent ce que Lobo Antunes disait récemment lors d’une rencontre publique.

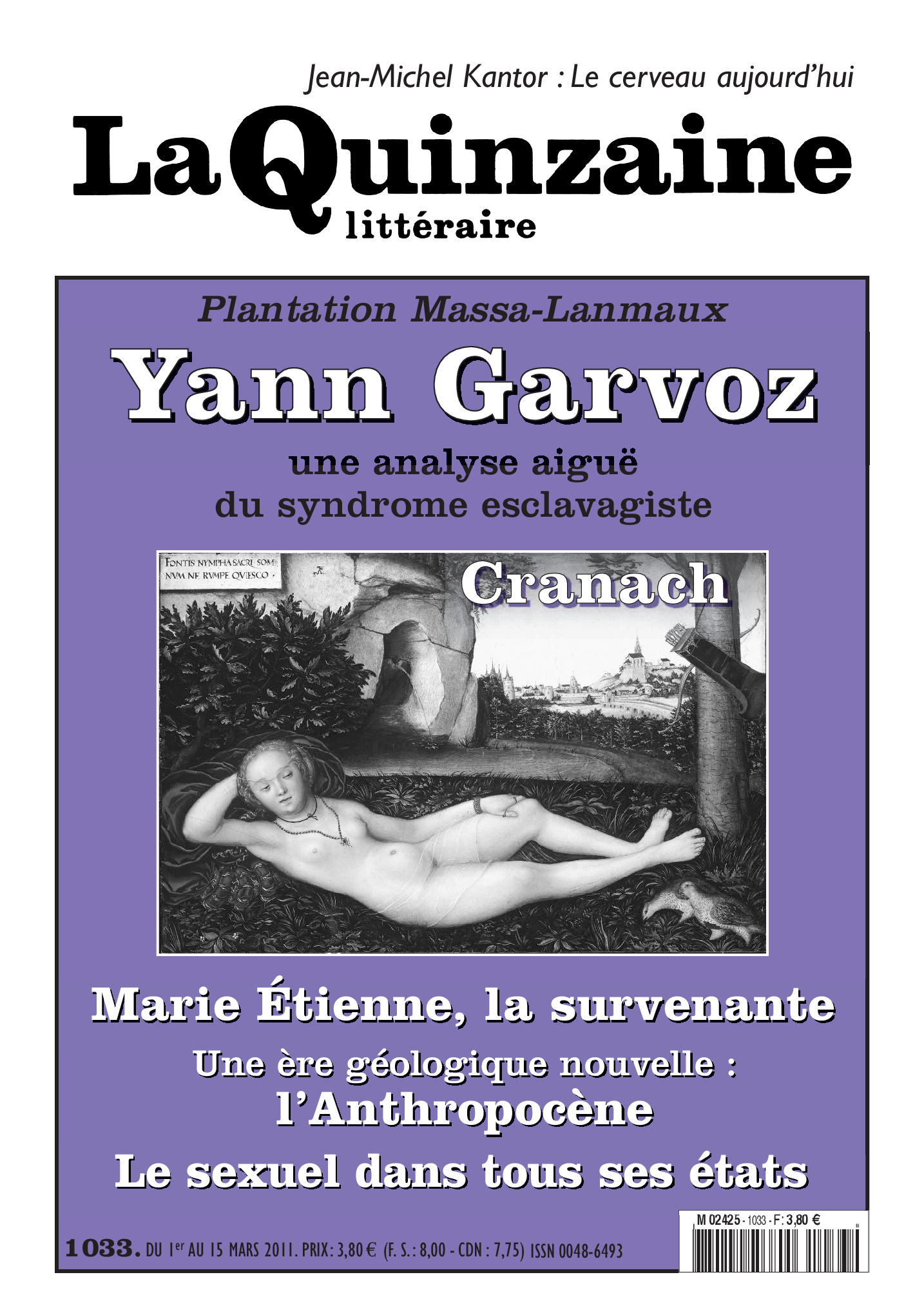

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)