Chambres, chambrées, dortoirs, salles communes. On est là, soumis au regard des autres, cherchant vainement une intimité. Un objet, un livre, un souvenir quelconque, une pensée ou un rêve parfois, permet de rester soi-même ou de le redevenir.
On laissera de côté la situation extrême connue par le déporté ou prisonnier d’un Goulag qui sauve sa journée par quelques paroles échangées avec un compagnon, dans le lieu de misère et d’humiliation. L’interné sera lui-même, le temps d’un poème récité, d’une plaisanterie entendue autrefois, ailleurs, le temps d’une confidence au compagnon allongé près de lui.
La salle commune de l’hôpital, ce sont quelques vagues images qu’on a préféré enfouir. Des malades, une odeur, des allées et venues d’infirmières, les échos qui se mêlent, la douleur de l’un, les soins pénibles pour l’autre… Je me rappelle la chambre que partageait, avec une vieille femme égarée, ma grand-mère dévorée par le cancer. Le sexe soudain découvert de cette étrangère, la gêne et l’envie d’effacer l’image, blotti contre ma grand-mère qui pleurait, si heureuse de nos retrouvailles.
La chambrée en caserne appelle d’autres souvenirs. Ceux qui dormaient là avaient souvent connu les dortoirs des internats en Lorraine et en Bretagne. La vie commune dans ce régiment d’Alsace n’était qu’un prolongement rigolard et égrillard d’une jeunesse passée dans de sinistres salles de classe, égayées par un chahut, des blagues douteuses, un de ces concours dont les adolescents ont le secret. Pour celui qui n’avait jamais connu cela, sinon enfant en colonie de vacances, c’était comme des rites exotiques, lointains. Je m’en absentais en m’absorbant dans la lecture ou la correspondance. J’avais quelque chose de ce professeur érudit plongé dans son « vieux Pindare », dans La Grande Illusion.
Du dortoir de pensionnat, je garde les images qu’en donnent les films. Mais je n’en préserve qu’une ici. Sans doute parce qu’elle condense mes peurs, mes inquiétudes, l’idée que je me fais du lieu. Dans Au revoir les enfants, c’est l’endroit dans lequel Bonnet, l’enfant juif, trouve refuge et en même temps connaît le danger. Les pères l’ont amené là ; les autres enfants risquent à tout instant de savoir qui il est. Cela ne manque pas d’arriver, d’ailleurs, avec Julien, son rival et compagnon qui découvre son identité. Mais lui connaît la faiblesse de ce chef en puissance : Julien souffre d’énurésie ; il n’est jamais tranquille la nuit. Dans ce dortoir glacial, le sommeil des uns et des autres est peuplé de songes et de secrets. La chambre est le lieu de tous les dangers, celui dans lequel on avoue ses faiblesses, observé ou entendu par les autres, jamais seul.
Et pourtant quand j’y pense, cette chambre commune qui nous oblige à subir les autres n’est pas la plus effrayante. Celle dans laquelle on reste confiné, dans laquelle on ne doit ni être vu, ni être entendu, dans laquelle on se fait tout petit parfois au sens propre du mot est terrifiante. Otage à Bagdad, Florence Aubenas dormait dans un réduit. Natascha Kampusch, séquestrée dans une cache souterraine en Autriche subit un sort voisin. Les faits-divers sont remplis d’histoires semblables, des chambres devenues cachots ou oubliettes.
Ce qu’en font les artistes nous intéresse plus encore. Le cinéma de Polanski est l’histoire, déclinée dans tous les registres ou genres, d’un enfant qui a subi l’enfermement du ghetto. On rit dans Le Bal des vampires, où pour échapper aux dents acérés du comte il faut tout fermer dans la chambre. Les trous de serrure permettent à Alfred, disciple du professeur Abronsius, de découvrir les charmes au bain de la fille de l’aubergiste. Tout est affaire de chambre dont les portes se ferment et s’ouvrent. Dans Oliver Twist, l’enfant acheté par le croque-mort est oublié près des cercueils, sous une table. Sa chambre est un réduit comparable à celui dans lequel dort Cosette, chez ces bons Thénardier. Mais la chambre devenue cercueil, lieu du silence obligatoire, on la voit dans Le Pianiste. Une fenêtre donne sur les rues enneigées de Varsovie et il y a un piano devant. Mais Vladislav n’en joue pas ; il arrête ses doigts fébriles bien au-dessus des touches noires et blanches. Il entend résonner la musique de Chopin ; c’est tout ce qu’il aime, qu’il sait jouer, qui le ramène aux temps heureux. Entendre la musique le sauve de la mort lente, ou du suicide que serait le martèlement des touches.
Des chambres, on en compte beaucoup chez Polanski, le claustrophobe désormais enfermé dans son chalet suisse (1). Il écrivait avec Gérard Brach, agoraphobe et claustrophobe à la fois. Belle machine à angoisse.
Et puis la chambre est l’endroit des interdits, des secrets, du dévoilement. Les enfants devinent ou comprennent ce qui se trame derrière cette porte fermée, la chambre des parents qu’évoque Brigitte Giraud dans un beau roman portant ce titre.
C’est aussi un lieu magique, fascinant pour le jeune Hugo qui passe ses nuits dans le réduit que lui a aménagé Mariana, dans La Chambre de Mariana d’Aharon Appelfeld. Le réduit, la chambre, l’enfant voyeur à son insu, ce sont des motifs permanents dans l’œuvre de l’écrivain israélien, des motifs inscrits dans son existence, comme pour Polanski. Caché dans son réduit, Hugo est enfermé mais voit tout et découvre ce que les adultes tiennent le plus secret puisque Mariana se prostitue. Elle boit, reçoit des coups et se fait insulter. Mais elle a promis à la mère de sauver la vie d’Hugo et elle tient cette promesse au péril de sa vie. Une nuit, alors que les nazis et leurs sbires fouillent le village, Hugo demande ce qu’il doit faire. « Rien » répond Mariana. « Fais comme si tu n’existais pas. » Il ne parvient plus à lire, à faire les exercices de maths qui devraient lui permettre d’oublier son sort, mais sa cachette est un « endroit protecteur », une « source de visions enchantées ». Il perd un peu le sens de la réalité, vit entre rêves et images, et découvre l’intimité d’une femme qui, pour le réconforter ou lui marquer son affection, le fait dormir contre elle quand le danger s’éloigne et qu’il peut pénétrer dans la chambre de Mariana, décor théâtral autant que lieu dans lequel elle gagne sa vie. Mais l’enfant y grandit, y devint adulte et connaît, de façon paradoxale, le bonheur au milieu de la tourmente.
La chambre, c’est enfin la chambre désertée, vidée de ses habitants, celle qui reste sans vie. Celle qu’habitaient des êtres désormais disparus. Plus de regard insidieux, plus de silence imposé, plus rien sinon l’absence, douloureuse. Dans un beau texte d’Espèces d’espaces, Perec énumère les verbes qui traduisent le déménagement. Il termine sur ces trois verbes,
Balayer
Fermer
Partir.
Et dans cet inventaire, on entend à la fois l’ordinaire, la banalité d’un déménagement, et la tristesse du lieu soudain désert. Quelque chose qui dure et ne nous quitte plus.
- Entretemps Polanski a été libéré.

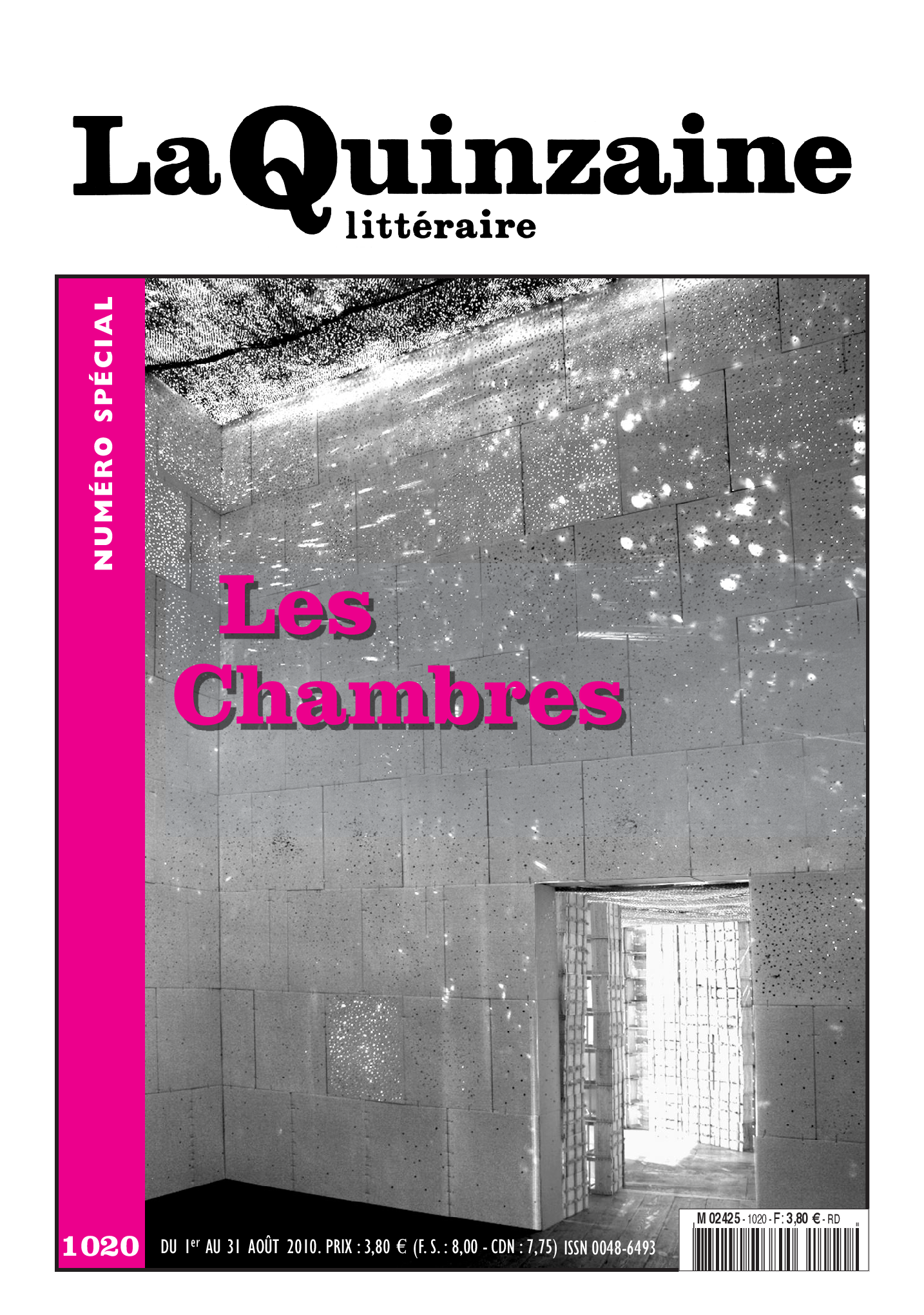

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)