Velimir Mladenović : Le roman explore le sentiment de déracinement sur plusieurs générations. Diriez-vous que Aziza est aussi une tentative de « raccommoder » les absences et les silences transmis dans votre famille ?
Valérie Clo : Le départ « obligé » de ma famille vers la France pendant la guerre d’Algérie n’était pas raconté et cela m’a questionnée. Cela a sans doute constitué le départ de l’écriture de ce livre. J’ai cherché à comprendre pourquoi. Bien sûr, je percevais que ma famille venait d’ailleurs mais c’est comme si cet ailleurs n’était pas célébré, comme s’il était indicible ou honteux. Rien n’était dit de ce départ précipité, ni de ce qu’ils ont été obligés d’abandonner, de leurs peurs, de l’inconnu qu’ils ont dû traverser, de leur nostalgie et de leur appréhension à tout reconstruire dans un pays qui était le leur mais qu’ils ne connaissaient pas. Je crois que j’avais besoin de mettre du sens et de « la chair » sur cette histoire pour me la réapproprier, comprendre aussi certaines de mes peurs, de mes blocages, de mes hontes et aussi de mes manques. Le mot raccommoder me va bien. Il sonne comme un soin, comme un assemblage de pièces éparses pour redonner du sens. Pour moi, c’est vertigineux de penser que ma famille pendant des siècles vivait de l’autre côté de la Méditerranée et qu’avec mes cousins nous sommes les premiers de notre lignée à être nés sur le sol français. Ce n’est pas anodin, ça laisse des traces. J’ai eu besoin de célébrer, de mettre à l’honneur cet ailleurs.
V. M. : La langue tient une place importante dans votre récit, notamment avec les mots en constantinois. Comment avez-vous travaillé cette dimension linguistique pour en faire un fil émotionnel du texte ?
V. C. : Je voulais que les mots que j’avais entendus enfant tiennent une place primordiale : ils racontent une autre culture. Ils sont le témoin, la preuve de cet ailleurs, ils font partie de mes racines. Cette langue, ces mots vivaient en moi depuis mon enfance alors même que j’ignorais leur signification et leur orthographe. J’aimais bien les prononcer à haute voix. J’ai dû faire appel à un spécialiste pour vérifier leur signification et l’orthographe. J’ai été très émue lorsque j’ai découvert leur orthographe exacte. Je n’avais donc pas rêvé, ils existaient bien, ils racontaient une époque, un pays. J’aime bien quand ma mère ou mes tantes les emploient en les mélangeant au français parce qu’elles n’arrivent pas à trouver un équivalent dans la langue française, ça me touche chaque fois. La langue, c’est aussi la langue du texte, j’en prends soin, j’essaie de la rendre vive, percutante et pleine d’émotion.
V. M. : À travers la découverte du carnet de cuisine, on sent une volonté de redonner voix à votre grand-mère. Avez-vous envisagé Aziza comme une forme d’hommage ou de réparation mémorielle ?
V. C. : Lorsque j’ai commencé à écrire ce texte, j’avais dans l’idée de parler du déracinement, des origines orientales de ma famille ; et la figure de ma grand-mère maternelle s’est imposée avec beaucoup de force. Je me suis aperçue alors du rôle essentiel qu’elle avait joué dans mon enfance et mon adolescence, de son impact dans ma vie de femme, de ce qu’elle m’avait transmis consciemment et inconsciemment. J’ai compris ses douleurs, ce qu’elle avait dû traverser et taire. J’ai trouvé qu’incontestablement, elle était une héroïne. À travers ce carnet j’ai eu besoin de lui redonner la parole. Ce livre m’a permis de lui rendre un vibrant hommage et d’honorer son besoin de liberté.
V. M. : Le personnage de la mère semble tiraillé entre rejet et nostalgie du passé. Comment avez-vous abordé l’ambivalence entre désir d'effacement et transmission de l’histoire familiale ?
V. C. : Ma mère est arrivée à l’âge de quinze ans en France, elle semblait contente de débarquer dans ce pays moderne où tout semblait possible et plus facile surtout pour les femmes. Elle incarnait le désir d’intégration que souhaitaient mes grands-parents. Elle n’avait sans doute pas conscience de ce que sa famille avait traversé, dû abandonner, comme d’autres familles de Constantine. La préoccupation, à ce moment-là, était de s’intégrer, de ressembler aux français de France, de se fondre dans la masse, de gommer les différences, l’accent, la peau mate, les cheveux bouclés... Je me suis aperçue de son ambivalence en la questionnant sur son enfance. Elle semblait avoir du mal à mettre en mots ses souvenirs. Elle se souvenait bien de leur arrivée en France mais très peu de leur départ ou de leur vie d’avant. Je me suis alors demandé si ce n’était pas ça, le traumatisme : ne pas arriver à mettre des mots sur une souffrance ou un manque.
V. M. : La Méditerranée est omniprésente, aussi bien physiquement que symboliquement. Pourriez-vous nous parler de ce rapport à la mer : est-elle pour vous un lieu de mémoire, une frontière ou un espoir ?
V. C. : Effectivement, la Méditerranée est très importante dans ma vie. À bien des égards. D’abord, elle représente les paysages de mon enfance puisque j’ai grandi en bord de mer dans le Var. Elle me fascine et me ressource, elle me manque lorsque je m’en éloigne. Je pense à sa beauté, à sa densité lorsque je voyage et j’ai toujours hâte de la retrouver. En écrivant Aziza, je me suis aperçue qu’elle était bien plus encore et qu’elle avait une importance dans mon histoire familiale, puisque mes ancêtres ont habité de l’autre côté et qu’ils ont dû la traverser pour construire une nouvelle vie. Je me suis souvenue comme ma grand-mère aimait la regarder. Est-ce qu’à ce moment-là elle pensait à sa vie là-bas ? Elle est comme un trait d’union entre deux pays. Elle est à la fois une mémoire, un espoir, un ancrage, un repère et mes racines. Des racines mouvantes certes mais des racines tout de même. Elle me tient lieu de terre.
V. M. : La ville de Constantine semble hanter le texte à travers les souvenirs, les objets, les recettes, les mots. Quelle place cette ville occupe-t-elle dans votre imaginaire personnel et dans la mémoire familiale que vous transmettez dans Aziza ? Est-elle pour vous un décor, un personnage ou un mythe fondateur ?
V. C. : Avant d’écrire ce texte, c’est comme si Constantine n’existait pas. Je ne savais même pas où la situer avec exactitude. C’est l’écriture qui m’a conduit à elle, j’ai fait des recherches, j’ai lu des témoignages, j’ai regardé des photos et elle a pris forme sous mes mots, elle est devenue concrète. Cela m’a enrichie de savoir où ma famille avait vécu, je me sentais plus complète. J’ai tenté de la faire revivre en décrivant sa situation, comment elle avait été construite tout en hauteur, encerclée de ponts suspendus, la faire revivre aussi à travers le langage, les objets, la danse, la musique, lui redonner corps. Maintenant lorsque j’y pense, elle me paraît familière, la magie de l’écriture !
V. M. : Comment le roman Aziza interroge-t-il la place de l’Autre – notamment celle de l’immigré ou de l’étranger – dans la société française contemporaine, et quels mécanismes de rejet ou d’intégration met-il en lumière ?
V. C. : Aziza, c’est le vrai prénom de ma grand-mère j’ai appris qu’elle s’appelait ainsi lorsque Daniel Balavoine a chanté en 1985 « L’Aziza ». Ma grand-mère se faisait appeler Louise, prénom qu’elle avait choisi en arrivant en France pour, avait-elle dit, « ne pas se faire se remarquer ». Sa volonté était de s’intégrer, quitte à effacer son identité. C’était d’autant plus facile pour elle qu’elle ressemblait davantage à une européenne qu’à une orientale contrairement à d’autres membres de ma famille. L’histoire de ce prénom dans ma famille représente tout le questionnement du livre : comment se construire et grandir si on a honte de ses origines ou si on les efface ? Elles nous constituent qu’on le veuille ou pas. L’idéal serait de pouvoir s’intégrer tout en conservant son identité, sa culture, sa singularité sans être stigmatisé. Cela devrait être un plus, plutôt qu’un moins, une richesse plutôt qu’un fardeau. Il faudrait ajouter plutôt qu’effacer. Il me semble que c’est la diversité de toutes les cultures et origines qui font la beauté et la grandeur de notre pays.
[Née en 1970, Valérie Clo a grandi dans le Var. Après Papa bis en 2000, elle a publié plusieurs romans aux éditions Buchet Chastel.]
Velimir Mladenović

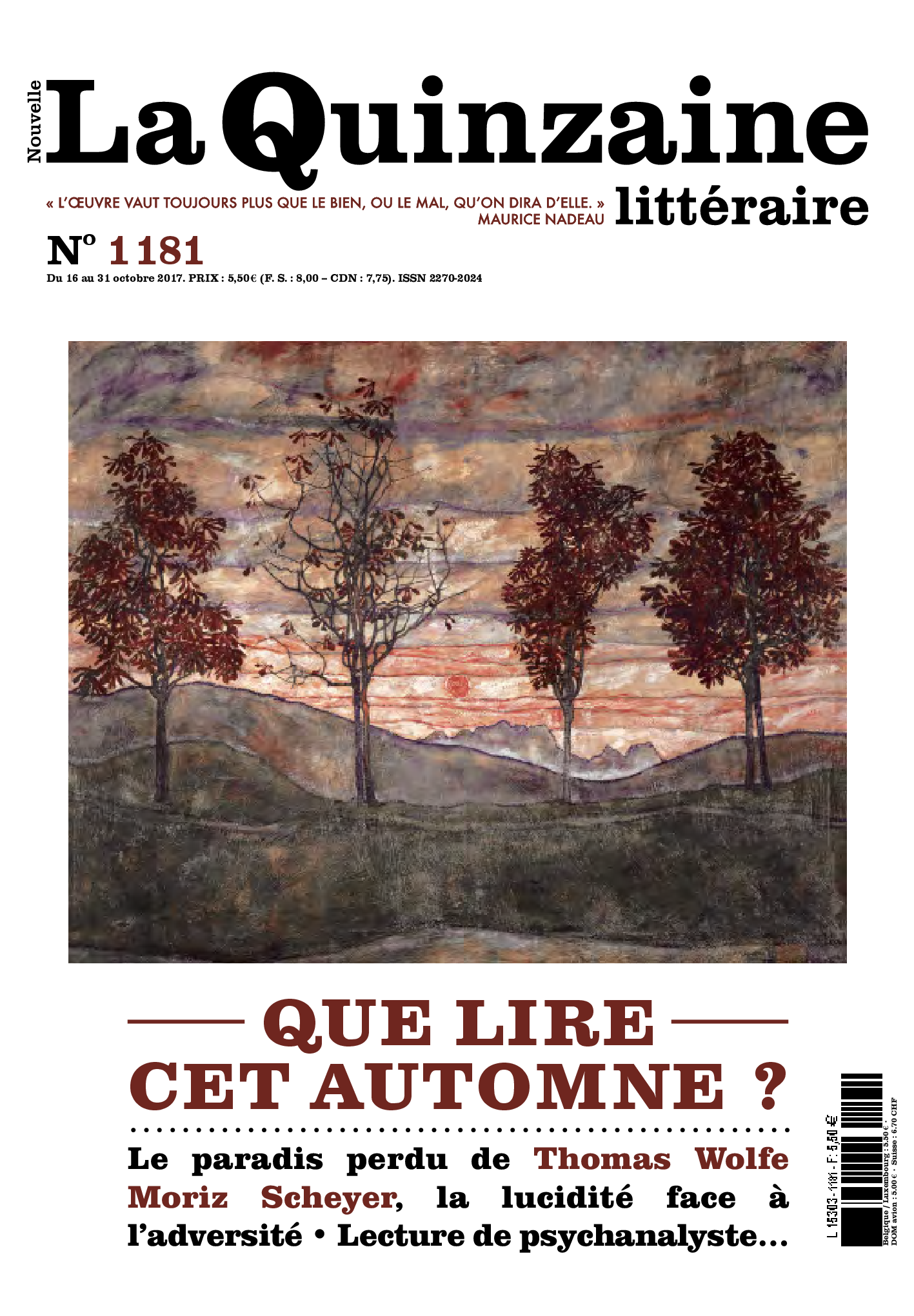
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)