Comment l’idée est-elle venue à Edmund, lointain rejeton de la lignée par sa grand-mère Elisabeth, mariée en 1926 à Paris avec Hendrick De Waal, membre de l’Église réformée de Hollande, de raconter l’histoire chaotique des Ephrussi, celle de leur splendeur puis, sous les coups du nazisme, de leur chute et de leur misère ? De nationalité anglaise, céramiste renommé, il n’obéit pas à un « devoir de mémoire », contrairement à ce qu’il est naturel de supposer quand on ouvre son livre. On est frappé au contraire, dans son Introduction, par la volonté affirmée de ne pas céder à la nostalgie et de refuser tout attendrissement sur le sort d’une famille, la sienne, si intimement liée à l’assassinat de la Mitteleuropa.
Edmund De Waal, en effet, est un artiste. C’est à l’occasion d’un stage de poterie au Japon, patrie de la céramique populaire mingei, une des plus élégantes et sobres du monde, qu’il rencontre pour la première fois l’objet qui va motiver sa longue étude. Dans le salon de son grand-oncle Ignace, dit Iggie, il peut admirer une extraordinaire collection de 264 netsuke, ces petites merveilles qui, à partir du XVIe siècle servaient aux Japonais aisés de fermoirs permettant d’attacher divers accessoires utiles (boîtes de médicaments, bourses, blagues à tabac) à la large ceinture du costume traditionnel, tant masculin que féminin, qui ne comporte pas de poches. Façonné en toutes sortes de matières (bois, ivoire, métal, bambou), le netsuke, création artisanale devant allier le poli d’une forme sans aspérité à la miniaturisation du thème, devint très vite, entre les mains d’un peuple obsédé de perfection formelle, un véritable objet d’art fabriqué souvent par des sculpteurs et des peintres. Au moment de la Révolution de Meiji (1868), devenu sans emploi avec l’introduction au Japon du hideux costume occidental, il fut relancé par la vogue européenne du japonisme, si vivace à la fin du siècle.
Ces netsuke aux sujets variés (animaux, plantes, personnages anthropomorphes, bibelots érotiques), Iggie les avait hérités de sa mère Emmy née Schey, via leur récupération par sa grande sœur Élisabeth après la guerre, mais grâce à la probe fidélité de la femme de chambre d’Emmy, Anna. Celle-ci, aryenne, les avait cachés sous son matelas après l’Anschluss du 15 mars 1938, qui marque le début de la fin pour la branche autrichienne des Ephrussi. Iggie, arrivé à Tokyo dans les bagages de l’armée américaine d’occupation après avoir participé comme GI à la campagne de Normandie, devait les léguer à Jiro Sugiyama, le compagnon de quarante ans de vie commune, et Jiro, à sa mort, les laisser à l’artiste auteur du livre.
Or l’épopée des netsuke, revenus dans leur pays d’origine après un étonnant tour du monde, puis exilés à nouveau en Angleterre dans l’atelier de leur possesseur actuel, va fasciner ce dernier au point de le lancer sur leur trace et d’essayer de les replacer physiquement dans les contextes divers qui furent les leurs, ressuscitant ainsi de manière originale les êtres attachants qui les hébergèrent, et le parfum de l’époque où vécurent ces disparus. Il y a dans cette fixation sur des objets chargés d’affects, imbibés de souvenirs, quelque chose de mystérieusement enfantin, quelque chose d’aussi troublant qu’un de ces contes où Andersen suit avec une attention visuelle maniaque la trajectoire terrestre d’une aiguille à coudre ou d’un soldat de plomb. D’où le charme secret du livre.
Voici donc la belle époque de l’apparition des netsuke. Ils sont acquis un par un, avec quelle dévotion de collectionneur ! par notre Charles Ephrussi, notre parce qu’il vit à Paris dans le palais bâti juste après la Commune, rue de Monceau, sur les terrains jadis achetés par les frères Pereire et sur lesquels ont fait également édifier de somptueuses demeures d’autres membres éminents de la haute finance juive, les Camondo, Cernuschi, Cattaui, et bien sûr les Rothschild. Plusieurs Ephrussi habitent conjointement l’hôtel particulier. Charles est le dilettante, il ne fait pas d’affaires mais se forge très tôt une réputation justifiée de critique d’art, côtoie la bonne société du faubourg Saint-Germain et mène, comme nombre d’Ephrussi, une existence sexuelle très libre avec sa maîtresse Louise Cahen d’Anvers. À l’image de ses parents il conserve la nationalité russe mais n’a aucune pratique religieuse. Fréquentant les peintres, son goût très sûr le porte vers les Impressionnistes et il aidera notamment Renoir et Degas en leur obtenant des commandes, ce dont les deux ingrats le récompensèrent bien mal en donnant libre cours à leur antisémitisme latent au moment de l’affaire Dreyfus.
Mais l’achat des netsuke que Charles dispute, chez l’importateur Sichel, à Edmond de Goncourt, autre collectionneur – et antisémite larvé – correspond à la période mondaine sans nuages de Charles, bientôt propriétaire de La Gazette des Arts, où il écrivait depuis des années, puis logé avenue d’Iéna enfin chez lui et plus superbement encore que rue Monceau. Jules Laforgue sera un temps son secrétaire, il est un des hommes les plus en vue, les plus intelligents de Paris, et le modèle avéré de Swann. En vieillissant, ses goûts artistiques changent. Il se passionne désormais, vingt ans avant André Breton, pour Gustave Moreau et finit par offrir en cadeau de noces (1899) au jeune couple formé par son cousin viennois Viktor von Ephrussi et la ravissante Emmy Schey von Koromla, sa collection de netsuke, qui surpasse alors celle d’Edmond de Goncourt en nombre et en qualité. Puis Charles meurt, jeune encore, à cinquante-six ans, comme Swann dont il avait toujours eu la santé fragile. Et le rideau se ferme sur l’épisode parisien, dans l’ensemble radieux, pour s’ouvrir sur la séquence viennoise.
Les netsuke sont alors installés dans le boudoir d’Emmy, que sa dame de compagnie Anna (dont le nom de famille reste inconnu) aide à changer trois fois par jour les tenues à la mode qui viennent de Paris. L’atmosphère du palais Ephrussi, qui domine le Ring de son imposante et arrogante architecture, va rester délicieusement schnitzlérienne – et par conséquent ophulsienne – presque jusqu’en 1933. Viktor, personnage triste qui n’aime que les livres, latins surtout, et remplit ses fonctions de banquier avec répugnance, s’ennuie dans son bureau cependant que sa délicieuse épouse (la photo d’elle en Marie-Antoinette qui figure page 195 montre une femme d’une grande beauté et d’une non moins grande assurance) donne naissance à deux filles (dont Élisabeth en 1899) et deux fils (dont Iggie, en 1906) et collectionne les amants. Les vacances se passent à Kövesces, où l’on monte à cheval, où l’on se baigne dans le grand lac qui fait partie du domaine. À Vienne, le dimanche, les enfants ont le droit de jouer avec les netsuke dans la chambre de maman.Tout ce petit monde étudie assez mollement, sauf Élisabeth qui a une volonté de fer, deviendra poétesse (elle correspondra avec Rilke), juriste, et se battra pour arracher ses parents à la Gestapo quand la fête sera finie.
Car tout s’effondre d’un coup en 1938. Mauvais banquier, Viktor n’a pas écouté ses parents suisses qui le priaient instamment de rapatrier ses avoirs quand il en était encore temps. Le palais du Ring est dévasté, pillé par les brutes du nouveau Reich. D’abord séquestrés, les propriétaires dépouillés se réfugient à Kövesces, Emmy y meurt le 12 octobre, probablement suicidée. Élisabeth sauve son père et ses frères (sa sœur Gisela vit depuis longtemps au Mexique où elle a épousé le banquier Alfredo Bauer, d’une famille juive qui, elle, est de stricte orthodoxie), les emmène à Londres. Iggie conduira en 1944, sur le front normand, une jeep nommée Elizabeth (avec un z, la photo de la page 316 en fait foi).
Tel est ce livre sans pathos ni haine, ni pardon intempestif, qui ne donne pas dans l’hagiographie, ne cache pas son antipathie pour tel ancêtre, son haut-le-cœur devant la mentalité de parvenu de tel autre. Edmund De Waal a gagné son pari. Ses morts sont bien vivants, ressuscités d’une famille qui a perdu certains de ses proches à Auschwitz. D’un bout à l’autre de son enquête, ne se départant guère d’un understatement tout britannique, il s’efforce de rester matter of fact, de ne jamais se laisser gagner par l’émotion. Mais pour nous qui le lisons et admirons sa dignité de survivant, l’émotion est là, palpable. Car les s inanimés de l’oncle Iggie ont une âme, discrète et tendre, et qui nous touche.
Maurice Mourier
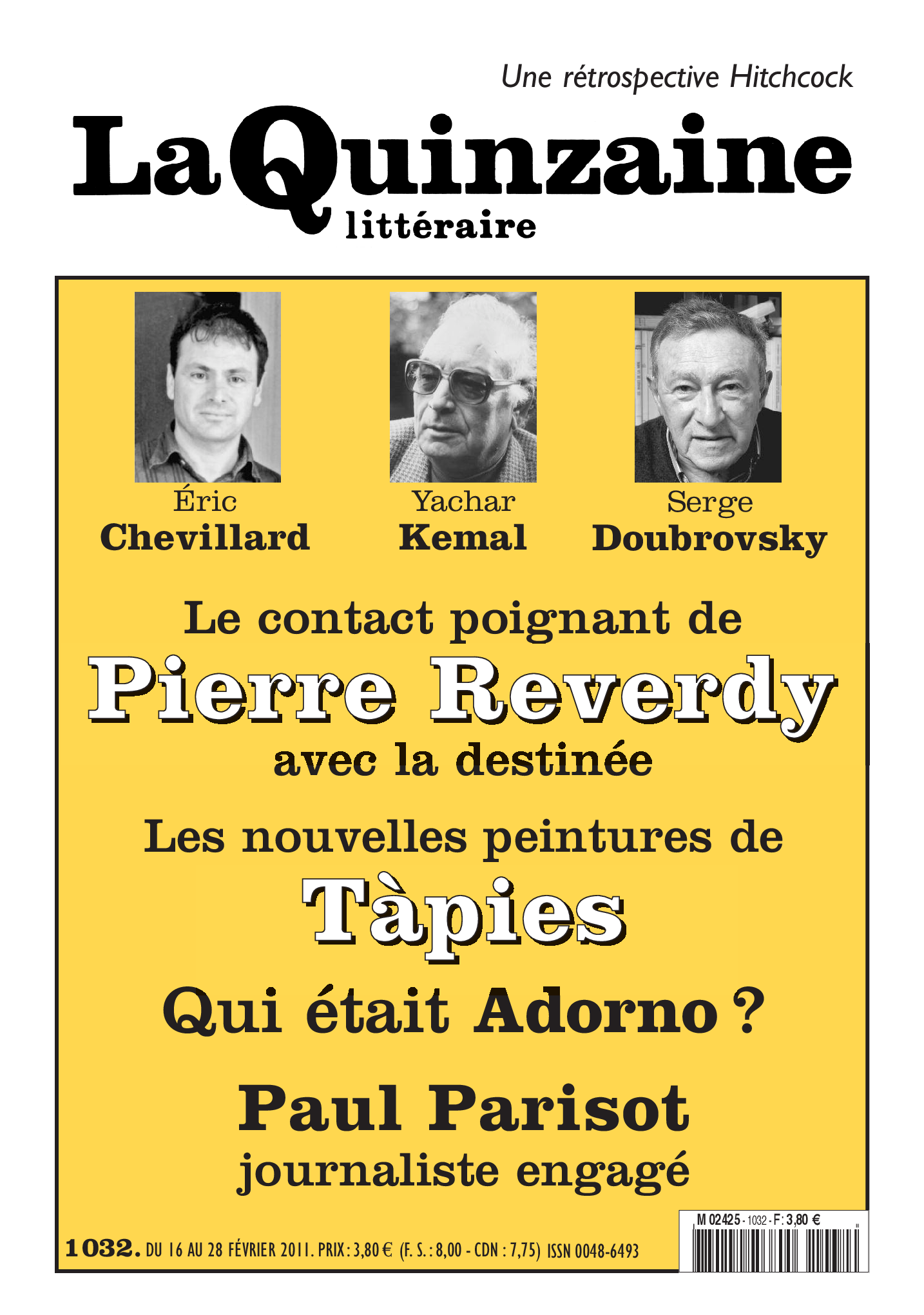

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)