Peter, galeriste de quarante-quatre ans, et son épouse Rebecca, éditrice, forment un couple de New-Yorkais aisés parfaitement archétypique, à la limite de la caricature. Alors que leur fille a quitté le foyer, ils hébergent Ethan, le très jeune frère de Rebecca surnommé « Mizzy », ancien toxicomane au charme troublant et à l’inconséquence toute proportionnelle. De cette intrusion surgira une manière de chaos intime qui bouleverse l’existence d’un homme tâtonnant dans sa propre vie, toujours en équilibre entre son existence confortable et ses troubles intérieurs, le poussant à tout remettre en cause, « prêt, à la plus petite incitation, à détruire sa vie », s’échapper.
Plutôt que de faire se rejouer simplement une trame rebattue, vaguement nigaude et pour le moins convenue, Cunningham brosse le portrait, directement et en creux, d’« un homme désespéré » qui, semblant se briser sur l’écueil d’un autre mystifié tout autant par lui-même, bascule dans un univers qui se conçoit selon le mode du renversement, d’une confrontation avec l’autre et les projections à partir desquelles nous le concevons, sans cesse reporté, plongeant comme aux sources mêmes de notre identité propre et de notre rapport au monde. Voici le parcours qu’effectue Peter après avoir retrouvé ce jeune homme, « enfant fantôme » arrivé très tard à qui on a laissé une liberté peut-être trop grande, manière de « démon familier » au physique puissant et engourdi à la fois « de ces Sébastien pâmés de la Renaissance », accablé d’un « certain air désincarné », perçu comme « un fantasme né de son imagination, la version rêvée de lui-même révélée aux autres ».
Fasciné par cet être qui appelle une forme de transgression urgente, Peter s’abîme, non pas comme on le penserait d’évidence dans une simple fascination éphébophile qui le submergerait, mais dans un renversement de l’ordre des images de sa mémoire, lui révélant qu’« il est excité par le souvenir d’avoir été jeune », par ce qui se perd dans le temps, dans le trouble qu’il y a à retrouver des traces anciennes, que l’on croyait perdues, dans la pureté d’une présence immédiate et concrète. Ainsi, ce sont les images, apurées par la durée, de sa femme, de son frère, mort du sida dans les années quatre-vingt, les pures manifestations de la grâce qu’il attache à ses désirs enfantins, qui le poussent à confronter sa vie à l’idéalité qu’il poursuit toujours, perpétuellement insatisfait, troublé par une manière d’inadéquation permanente. Cunningham ne donne pas dans le vaudeville bourgeois, dans la petitesse de l’analyse nombriliste d’un intime exhibé, dans le roman de la crise de la quarantaine, mais donne à voir, l’inscrivant avec plus ou moins de bonheur dans une réflexion sociologique sur le marché de l’art contemporain, ce qu’est l’amour de la beauté, la manière dont les hommes peuvent s’en saisir et à quels objets ils rattachent leurs désirs empêchés.
Crépuscule est un roman tout entier déceptif. Il fait se renverser les termes qui le constituent et les repousse toujours ou les nie, faisant des rebours de ce qui semble évident la matière même d’une réflexion beaucoup plus compliquée et riche qu’il n’y paraît. Nous n’insisterons pas sur la dimension psychologique de ce roman que l’on pourrait relier à une tradition américaine qui ne disparaît pas – d’Henry James et Edith Wharton jusqu’à Yates ou Ford –, pour redire simplement le lien qui noue ensemble le sentiment et l’argent, l’implacabilité de la socialité. Contrairement à ce qui s’écrit un peu partout, ce n’est pas cette dimension de l’analyse psychologique des personnages qui prévaut ici, mais bien au contraire les mécanismes de projection qui les portent, leur intrication compliquée qui se joue savamment. Cunningham procède effectivement par détours, par apposition, par un jeu de correspondances entre de pures images de l’art – Rodin, Giotto, Manet, Koenig, Fitzgerald, Mann… – et l’émoi singulier de Peter, la manière dont ces éléments se télescopent pour ne laisser aux êtres que d’étranges traces surimprimées à leur mémoire défaite, les faisant lutter avec eux-mêmes et leurs propres illusions.
Le roman répond, les rassemblant, aux enjeux que développaient les deux romans les plus importants de Cunningham (1), faisant comme entrer en écho la dimension savante et virtuose d’un récit qui entrelace des strates narratives différentes, faisant du mimétisme l’une des forces de la littérature, et celle, plus charnelle, plus clairement autobiographique, d’une intimité avec une génération en souffrance, sacrifiée à la maladie, et la mémoire d’amours longtemps tues. Toutes les questions qui hantent l’univers de Cunningham sont une fois encore reprises – la sexualité, la fraternité, la famille, la filiation, l’argent, les illusions sociales, la mort, l’envie,le sentiment d’infériorité… Mais, au-delà de cette forme de synthèse, de ce que Peter (et Cunningham à travers lui) nomme le « synchronisme », c’est de la nature de la beauté qu’il s’agit dans ce récit aux apparences simples et néanmoins trompeuses (2), de ce qui nous lie à son saisissement et son expression, de ce qu’elle rend nécessaire de dire, des moyens qu’elle trouve pour s’incarner. Ainsi, Peter ne tombe nullement amoureux d’Ethan et confie, avec une fragilité et une simplicité qui sembleraient naïves : « Je suis tombé amoureux (…) de la beauté elle-même. » Peter s’essaie, tout le temps du roman, tout le temps sans doute de sa vie entière, à rechercher l’« aveuglante beauté (qui) s’apprête à se manifester et, comme la fureur de Dieu, à tout aspirer sur son passage, nous laissant orphelins », à croire possible la fulgurance véritable qui nous extrairait de nous-mêmes et de notre subjectivité. La fin du roman, d’une évidence qui en déroutera beaucoup, ne fait rien d’autre que de nous rappeler l’échec irrémédiable et la résignation qui nous guettent. Cunningham semble nous dire, finalement, que la beauté, son saisissement vital, le déploiement amoureux véritable, sont impossibles, et que seule demeure la fascination.
- Nous pensons à : La Maison du bout du monde (Belfond, 2000) ; Les Heures (Belfond, 2003, QL n° 770).
- La traduction renforce cette impression en laissant croire à une langue très simple, presque aplatie. Il est vrai que l’anglais de Cunningham, comme celui de Colum McCann, est particulièrement difficile à rendre dans tout ce qu’il a
d’élégant, d’affiné et de sonore. Notons que le récit semble parfois en déséquilibre, moins
abouti, mais beaucoup plus convaincant que Le Livre des jours.

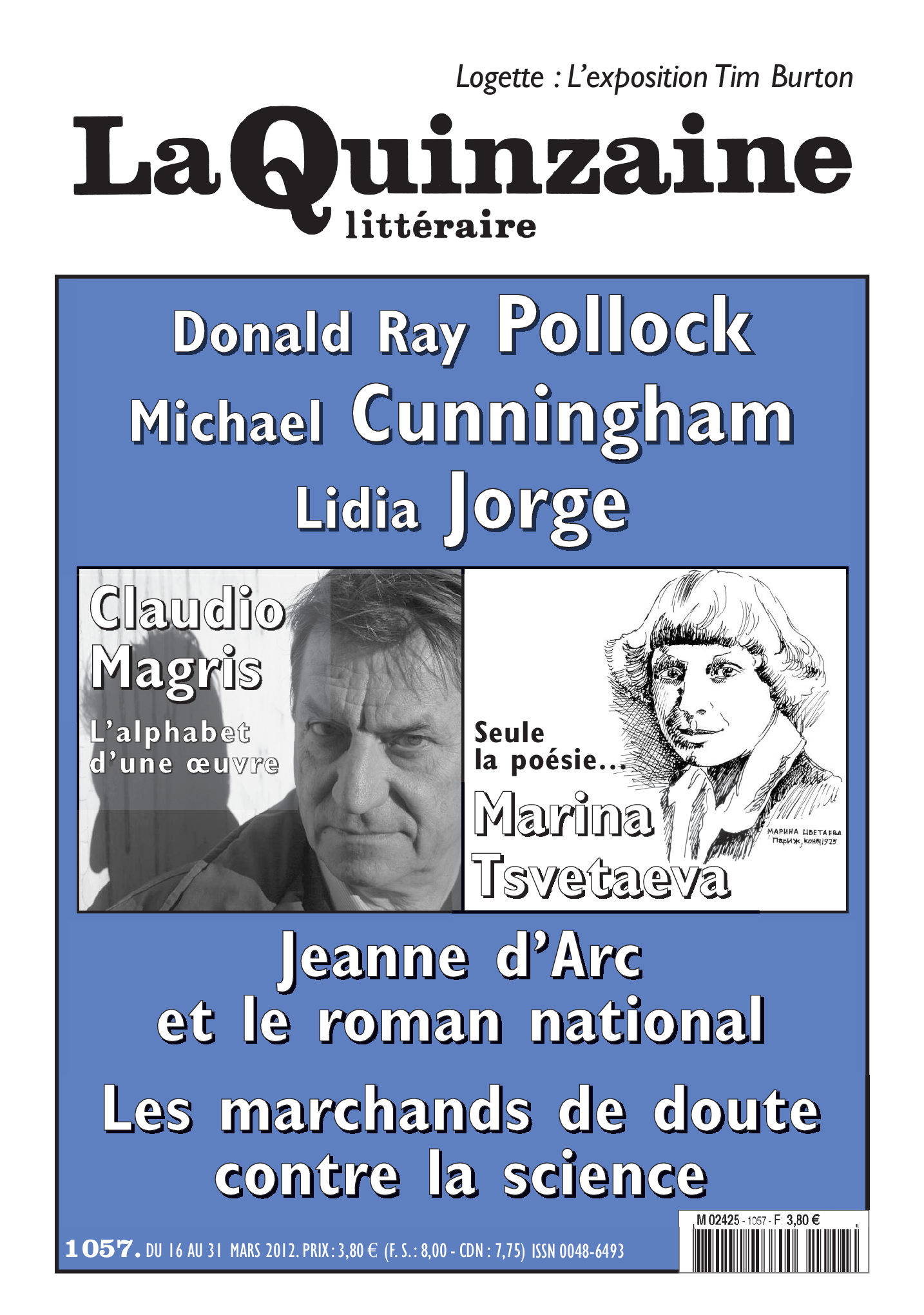

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)