L’Allemagne est devenue sa propre mémoire, c’est ce dont témoigne le présent livre d’Alban Lefranc : puissant, intense et d’une violence cristalline, il mène au cœur de cette extraordinaire tension qui fit éclater la société allemande à la fin des années soixante du siècle dernier.
À cette époque, tout juste vingt ans après la fin de l’hitlérisme, le procès de Francfort, où furent jugés de 1963 à 1965 les bourreaux d’Auschwitz, mit soudainement fin au silence qui avait lourdement pesé sur la RFA d’Adenauer, dans laquelle personne n’avait rien su ni rien vu. Ce fut un événement majeur qui, d’un coup, jeta la conscience allemande dans un face-à-face avec le crime absolu. Son reflet renversé le plus révélateur en fut la célèbre affaire Baader/Meinhof.
Alban Lefranc, dans une langue à la fois poétique et rigoureuse, non seulement restitue l’histoire de la bande à Baader, mais en figure le corps et oblige le lecteur à se confronter au malaise essentiel, à l’obsession de la vérité, aux sensations toujours coupables de ces jeunes gens perdus, à jamais marqués par le nazisme de la génération précédente. Presque à leur insu, ils se jettent dans le crime avec une sorte de délectation hallucinée, voués par instinct à l’horreur au milieu d’une Allemagne nouvelle. « Partout en Allemagne occidentale, des ouvriers laissaient la chaîne de montage poursuivre son pèlerinage vers la marchandise idéale, des apprentis philosophes abandonnaient Kant à la rumination trottinante des professeurs, des écolières empoisonnaient leurs parents pour fuir plus vite vers les quartiers essentiels où le point culminant du temps avait été atteint. » Ce roman pénètre à l’intérieur de cette mémoire souterraine informulée qui traverse l’histoire allemande et la voue tout au long du XXe siècle aux pires consentements à la mise à mort de peuples entiers.
Ainsi, une description très parlante de Tübingen montre comme il est facile de basculer du calme poétique dans l’exaltation de la brutalité. Or, pendant ces années soixante où la mémoire éclate, elle s’incarne dans les descendants, comme ce Bernward Vesper, fils d’un écrivain nazi bien connu et qui ne peut surmonter un tel héritage de culpabilité. Cette culpabilité est aussi à l’origine des dérives de la bande à Baader, dont le livre d’Alban Lefranc fait l’historique à sa façon. Il mêle une série de sensations, de réflexions – on songe à l’animal du terrier de Kafka – qui constituent une sorte de trame de fond : ces passages imprimés en italique sont comme la matière poétique du livre.
Le fils doit d’abord tenter de se dégager de cette langue nazie qui enferme encore l’Allemagne dans le crime, une Allemagne débarrassée en apparence seulement de la gangue du consentement subi ; « une langue avait remplacé l’autre, sans coup férir. Le nazisme avait été vaincu par les armes, mais la bataille des arguments n’avait jamais commencé ». Dans la RFA de cette époque, il n’existait encore aucune réflexion approfondie sur cette langue nazie qui se prolongeait dans le quotidien.
Il ne lui restera comme issue que le suicide ; c’est aussi une manière de suicide qui conduira Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof et Andreas Baader à sombrer dans le terrorisme, c’est-à-dire dans ce qu’ils prétendaient dénoncer. L’Allemagne de l’argent qu’ils combattent est la leur. Quoi qu’ils fassent, ils n’échappent pas à leur destin, qui symbolise l’emmêlement d’un apaisement apparent et d’une violence meurtrière sous-jacente. « La voix des morts envahissait la vie », dit l’auteur, comme en un leitmotiv.
L’échec et l’égarement dans la traversée d’un temps où se heurtent le monde de l’enthousiasme et celui du profit quotidien sont des thèmes fondamentaux de l’existence allemande de ce temps-là. Les figures marginales en constituent la substance, souvent hantée par la destruction, comme c’est le cas dans ce livre, qui rend compte de l’intérieur de ce permanent naufrage. « L’enfer, beaucoup plus simplement, commence dès aujourd’hui, dans la dévastation quotidienne quand on n’est plus capable d’aimer, devenu un mort parmi les déjà morts. »
Georges-Arthur Goldschmidt
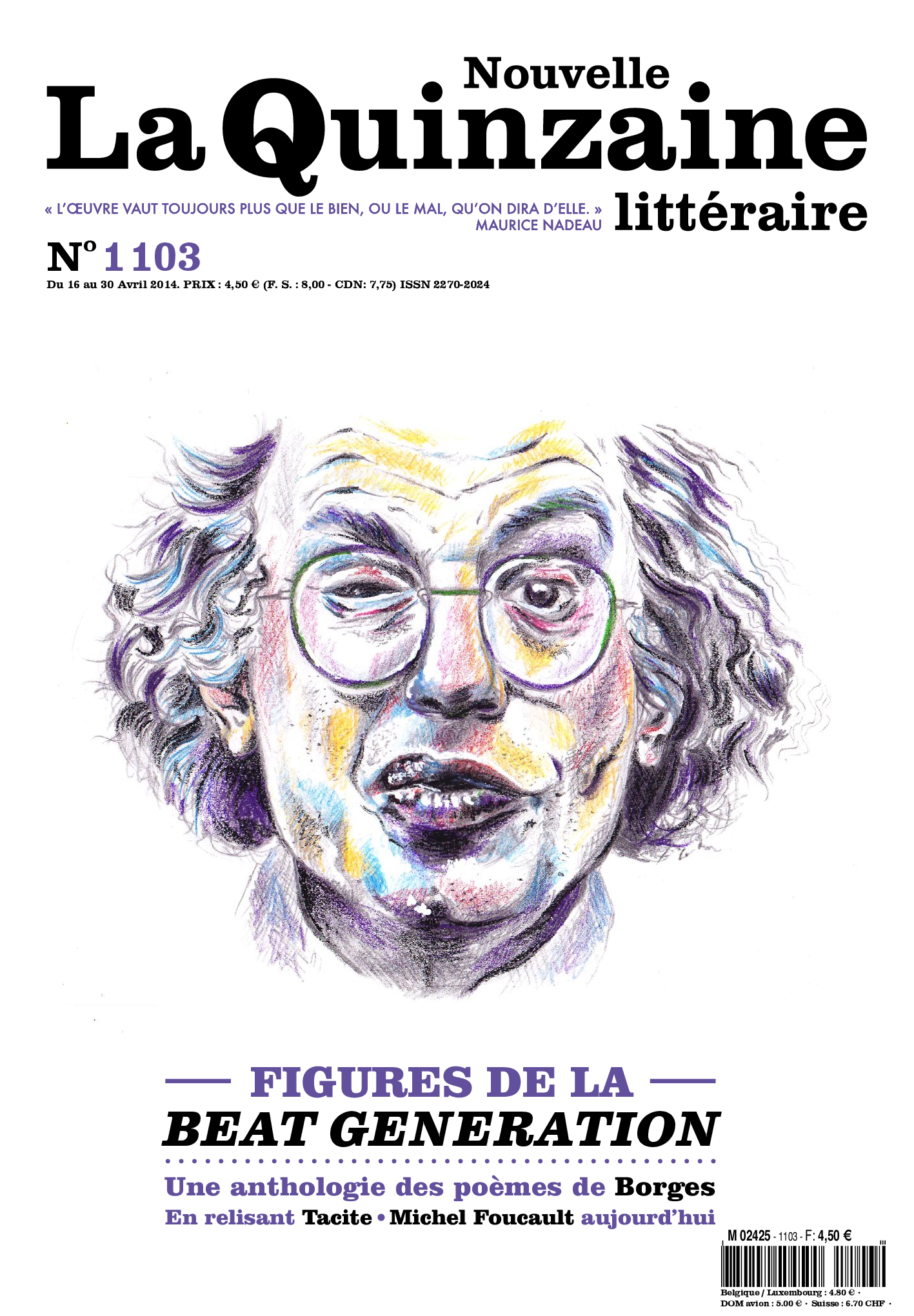

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)