Ce volume contient : Colline, Le Chant du monde, Pour saluer Melville, Un roi sans divertissement, Mort d'un personnage, Faust au village, Le Moulin de Pologne, L’Homme qui plantait des arbres, Ennemonde et autres caractères, L’Iris de Suse.
« Un sommet de la littérature universelle » : telle est l’expression de Pierre Michon pour qualifier Un roi sans divertissement (Le roi vient quand il veut. Propos sur la littérature, Albin Michel, 2016). Si l’éloge est un peu...

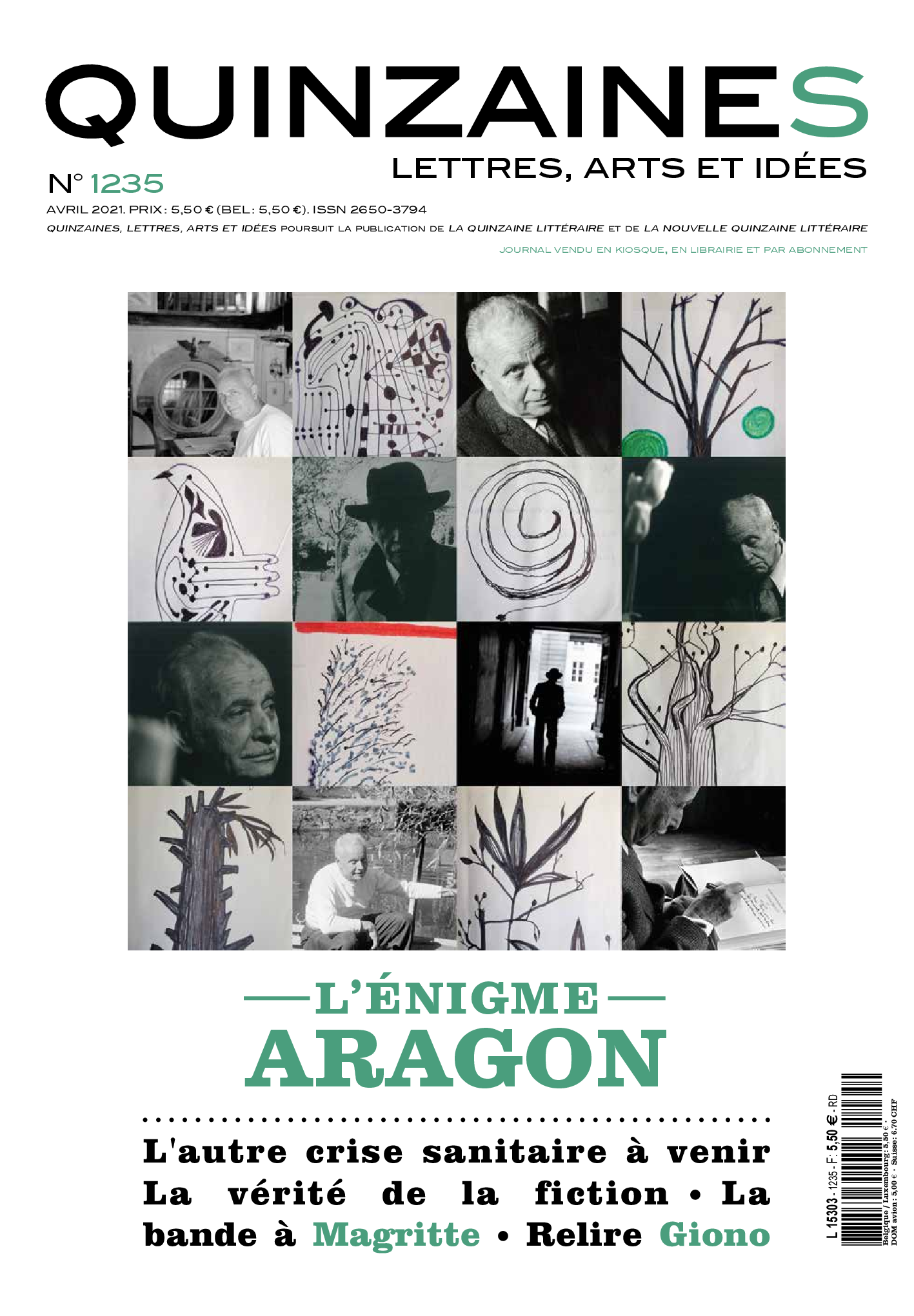

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)